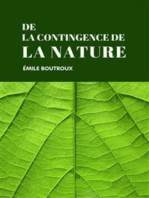Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Weil, Simone - Sur La Science (1966)
Enviado por
rebecca.geo1789Título original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Weil, Simone - Sur La Science (1966)
Enviado por
rebecca.geo1789Direitos autorais:
Formatos disponíveis
Simone Weil (1909-1943)
Philosophe franaise
(1966)
Sur la science
[crits publis entre 1932 et 1942.]
Un document produit en version numrique par Gemma Paquet, bnvole, Professeure retraite du Cgep de Chicoutimi Courriel: mgpaquet@videotron.ca Dans le cadre de la collection: "Les classiques des sciences sociales" Site web: http://classiques.uqac.ca/ Une bibliothque fonde et dirige par Jean-Marie Tremblay, sociologue Une collection dveloppe en collaboration avec la Bibliothque Paul-mile-Boulet de l'Universit du Qubec Chicoutimi Site web: http://bibliotheque.uqac.ca/
Simone Weil, Sur la science (1966)
Cette dition lectronique a t ralise par Gemma Paquet, bnvole, professeure la retraite du Cgep de Chicoutimi partir de :
Simone Weil (1909-1943)
Sur la science
Paris: ditions Gallimard, 1966, 285 pp. Collection : Espoir.
[crits publis entre 1932 et 1942.]
Polices de caractres utilise : Pour le texte: Times New Roman, 14 points. Pour les citations : Times New Roman, 12 points. Pour les notes de bas de page : Times New Roman, 12 points. dition lectronique ralise avec le traitement de textes Microsoft Word 2004 pour Macintosh. Mise en page sur papier format LETTRE (US letter), 8.5 x 11)
dition numrique ralise le 3 mai 2007 Chicoutimi, Ville de Saguenay, province de Qubec, Canada.
Simone Weil, Sur la science (1966)
Oeuvres de Simone Weil
L'enracinement. [Texte disponible dans Les Classiques des sciences sociales. JMT.] La connaissance surnaturelle. Lettre un religieux. La condition ouvrire. [Texte disponible dans Les Classiques des sciences sociales. JMT.] La source grecque. Oppression et libert. [Texte disponible dans Les Classiques des sciences sociales. JMT.] Venise sauve. crits de Londres et dernires lettres. crits historiques et politiques. [Texte disponible dans Les Classiques des sciences sociales. JMT.] Penses sans ordre concernant l'amour de Dieu.
Simone Weil, Sur la science (1966)
Simone Weil (1909-1943)
Philosophe franaise
Sur la science
[crits publis entre 1932 et 1942.]
Paris: ditions Gallimard, 1966, 285 pp. Collection: Espoir.
Simone Weil, Sur la science (1966)
Table des matires
Prsentation du livre (Quatrime de couverture) Note de lditeur Science et perception dans Descartes Introduction Premire partie Deuxime partie Conclusion 1932-1942 Lettre un camarade L'enseignement des mathmatiques Rponse une lettre d'Alain Lettre un tudiant La Science et nous L'avenir de la science Rflexions propos de la thorie des quanta Extraits de lettres et de brouillons de lettres A. W. (Janvier-avril 1940) I. II. II bis. III. III bis. III ter. Extrait de lettre Extrait de lettre Brouillon d'une partie de la lettre prcdente Extrait d'un brouillon de lettre Variante d'une partie du texte prcdent Autre variante du mme texte
Extraits de lettres A. W. (Marseille, 1941-1942) Fragments (Sciences) Rverie propos de la science grecque propos de la mcanique ondulatoire Fragment Du Fondement d'une science nouvelle Du Fondement d'une science nouvelle (variante)
Simone Weil, Sur la science (1966)
Sur la science [crits publis entre 1932 et 1942.]
Prsentation du livre
(Quatrime de couverture)
Retour la table des matires
ESPOIR Ce premier volume d'essais, lettres et fragments, indits de Simone Weil, est tout entier orient vers les mathmatiques et la science. Voici la succession des chapitres : Science et perception dans Descartes - Lettre un camarade - Lettre X - L'enseignement des mathmatiques - Rflexion propos de la thorie des quanta : L'avenir de la science. propos de la mcanique ondulatoire - Fragments (Sciences) : Du fondement d'une science nouvelle. Rverie propos de la science grecque. Comment les Grecs ont cr la science - Extraits de lettres et de brouillons de lettres A.W, - La science et nous.
Simone Weil, Sur la science (1966)
Sur la science [crits publis entre 1932 et 1942.]
Note de lditeur
Retour la table des matires
Ce premier volume des Essais, lettres et fragments contient des crits de Simone Weil qui se rapportent plus spcialement aux sciences. On y trouvera d'abord sa thse de diplme d'tudes suprieures, crite en 1929-1930 et intitule : Science et perception dans Descartes. Les deux textes suivants, une bauche de lettre et une bauche d'article, ont t retrouvs parmi ses papiers. Ils concernent l'un et l'autre l'enseignement historique des sciences, particulirement des mathmatiques. Le contenu de ces deux textes montre qu'ils furent crits en 1932, quand elle tait professeur au Puy, ou pendant les vacances d't qui ont suivi cette premire anne d'enseignement. On trouvera ensuite une autre bauche de lettre, galement retrouve parmi les papiers de Simone Weil. C'est probablement l'esquisse d'une rponse une lettre d'Alain, comme on le voit par le passage o sont mentionns les Entretiens au bord de la mer et par celui o il est question d'un plan de travail. Alain avait crit Simone Weil, en janvier 1935, aprs avoir lu les Rflexions sur les causes de la libert et de l'oppression sociale, une lettre o il lui disait entre autres : Pourrez~vous former un plan de travail ? Un large extrait de cette lettre d'Alain est cit dans la Note de l'diteur qui se trouve en tte du recueil Oppression et libert (Gallimard, 1955).
Simone Weil, Sur la science (1966)
Le fragment suivant est tir d'une lettre crite te un tudiant en 1937. Vient ensuite un texte long et important, intitul La Science et nous. Il fut crit Marseille, dans les premiers mois de1941, comme le montre un passage d'une lettre de Simone Weil un ami, date du 30 mai 1941 J'ai commenc un long travail sur la science contemporaine, classique (de la Renaissance plus de trente grandes pages jai t interrompue par d'autres proccupations. L'article concernant l'ouvrage collectif L'Avenir de la science a t publi Marseille, dans les Cahiers du Sud, no 245, avril 1942, sous le pseudonyme anagrammatique d'mile Novis. Il ne peut tre antrieur novembre 1941, l'impression de l'Avenir de la science n'ayant t acheve que le 28 octobre 1941. Il est suivi d'un autre article, Rflexions propos de la thorie des quanta, qui fut publi dans la mme revue, no 51, dcembre 1942, sous le mme pseudonyme. Il concerne le livre de Max Planck, Initiations la physique, qui avait paru en traduction franaise en fvrier 1941. Des passages concernant les sciences ont t extraits des lettres et des brouillons de lettres de Simone Weil son frre Andr Weil. Ces textes ont t crits, les uns Paris, de janvier avril 1940, les autres Marseille, en 1941-1542. On a group la fin plusieurs fragments de date incertaine : Rverie propos de la science grecque, propos de la mcanique ondulatoire, un fragment sans titre et Du Fondement d'une science nouvelle. Les pages intitules Rverie propos de la science grecque sont parallles certaines pages de La Science et nous, dont elles constituent une variante.
Simone Weil, Sur la science (1966)
Sur la science [crits publis entre 1932 et 1942.]
Science et perception dans Descartes (1929-1930)
1
Introduction
Retour la table des matires
L'humanit a commenc, comme chaque homme commence, par ne possder aucune connaissance, hors la conscience de soi et la perception du monde. Cela lui suffisait, comme cela suffit encore aux peuples sauvages, ou, parmi nous, aux travailleurs ignorants, pour savoir se diriger dans la nature et parmi les hommes autant qu'il tait ncessaire pour vivre. Pourquoi dsirer plus ? Il semble que l'humanit n'aurait jamais d sortir de cette heureuse ignorance, ni, pour citer Jean-Jacques, se dpraver au point de se mettre mditer. Mais cette ignorance, c'est un fait qu'autant : que nous pouvons savoir jamais l'humanit n'a eu proprement en sortir, car jamais elle ne s'y est renferme. Ce qui explique que la recherche de la vrit ait pu et puisse prsenter quelque intrt, c'est que l'homme commence, non pas par l'ignorance, mais par l'erreur. C'est ainsi que les hommes, borns l'interprtation immdiate des sensations, ne s'en sont jamais conten1
Dieu est toujours gomtre. (Parole attribue Platon.)
Simone Weil, Sur la science (1966) 10
ts ; toujours ils ont pressenti une connaissance plus haute, plus sre, privilge de quelques initis. Ils ont cru que la pense errante, livre aux impressions des sens et des passions, n'tait pas la pense vritable ; ils ont cru trouver la pense suprieure en quelques hommes qui leur semblrent divins, et dont ils firent leurs prtres et leurs rois. Mais n'ayant aucune ide de ce que pouvait tre cette manire de penser suprieure la leur, comme en effet ils n'auraient pu la concevoir que s'ils l'avaient possde, ils divinisrent en leurs prtres, sous le nom de religion, les plus fantastiques croyances. Ainsi ce juste pressentiment d'une connaissance plus sre et plus leve que celle qui dpend des sens fit qu'ils renoncrent chacun soi, se soumirent une autorit, et reconnurent pour suprieurs ceux qui n'avaient d'autre avantage sur eux que de remplacer une pense incertaine par une pense folle. Ce fut le plus grand moment de l'histoire, comme c'est un grand moment dans chaque vie, que l'apparition du gomtre Thals, qui renat pour chaque gnration d'coliers. L'humanit n'avait fait jusque-l qu'prouver et conjecturer ; du moment o Thals, tant rest, selon la parole de Hugo, quatre ans immobile, inventa la gomtrie, elle sut. Cette rvolution, la premire des rvolutions, la seule, dtruisit l'empire des prtres. Mais comment le dtruisit-elle ? Que nous a-telle apport la place ? Nous a-t-elle donn cet autre monde, ce royaume de la pense vritable, que les hommes ont toujours pressenti travers tant de superstitions insenses ? A-t-elle remplac les prtres tyranniques, qui rgnaient au moyen des prestiges de la religion, par de vrais prtres, exerant une autorit lgitime parce qu'ils ont vritablement entre dans le monde intelligible ? Devons-nous nous soumettre aveuglment ces savants qui voient pour nous, comme nous nous soumettions aveuglment des prtres eux-mmes aveugles, si le manque de talent ou de loisir nous empche d'entrer dans leurs rangs ? Ou cette rvolution a-t-elle au contraire remplac l'ingalit par l'galit, en nous apprenant que le royaume de la pense pure est le monde sensible lui-mme, que cette connaissance quasi divine qu'ont pressentie les religions n'est qu'une chimre, ou plutt qu'elle n'est autre que la pense commune ? Rien n'est plus difficile, et en mme temps rien n'est plus important savoir pour tout homme. Car il ne s'agit de rien de moins que de savoir si je dois soumettre la conduite de ma vie l'autorit des savants, ou aux seules lumires de
Simone Weil, Sur la science (1966) 11
ma propre raison ; ou plutt, car cette question-l, ce n'est qu' moi qu'il appartient de la dcider, si la science m'apportera la libert, ou des chanes lgitimes. C'est ce que le miracle gomtrique, considr en sa source, permet difficilement de dire. La lgende veut que Thals ait trouv le thorme fondamental de la mathmatique en comparant, pour mesurer les pyramides, le rapport des pyramides l'ombre des pyramides, de l'homme l'ombre de l'homme. Ici la science semblerait n'tre qu'une perception plus attentive. Mais ce n'est pas ainsi qu'en ont jug les Grecs. Platon sut bien dire que, si le gomtre s'aide de figures, ces figures ne sont pourtant pas l'objet de la gomtrie, mais seulement l'occasion de raisonner sur la droite en soi, le triangle en soi, le cercle en soi. Comme ivres de gomtrie, les philosophes de cette cole rabattirent, par opposition cet univers des ides dont un miracle leur donnait l'entre, l'ensemble des perceptions un tissu d'apparences, et dfendirent la recherche de la sagesse quiconque n'tait pas gomtre. La science grecque nous laisse donc incertains. Aussi bien vaut-il mieux consulter la science moderne ; car, si l'on excepte une astronomie assez rudimentaire, c'est la science moderne qu'il a t rserv d'amener la dcouverte de Thals, par la physique, sur le terrain o elle rivalise avec la perception, autrement dit jusqu'au monde sensible. Ici il n'y a plus aucune incertitude ; c'est bien un autre domaine de la pense que nous apporte la science. Thals lui-mme, s'il ressuscitait pour voir jusqu'o les hommes ont men ses rflexions, se sentirait, en comparaison de nos savants, un fils de la terre. Veut-il feuilleter un livre d'astronomie ? Il n'y sera pour ainsi dire pas question d'astres. Ce dont parlera le moins un trait de la capillarit ou de la chaleur, c'est de tubes troits et de liquides, ou de la question de savoir ce qu'est la chaleur ou par quel moyen elle se propage. Ceux qui veulent donner un modle mcanique des phnomnes physiques, comme les premiers astronomes ont reprsent par des machines le cours des astres, sont prsent mpriss. Thals, dans nos livres concernant la nature, esprerait trouver, dfaut des choses ou des modles mcaniques qui les imitent, des figures gomtriques ; il serait encore du. Il croirait son invention oublie, il ne verrait pas qu'elle est reine, mais sous forme d'algbre. La science, qui tait au temps des Grecs la science des nombres, des figures et des machines, ne semble plus consister qu'en la science des purs rapports. La pense commune sur
Simone Weil, Sur la science (1966) 12
laquelle il semble que Thals, s'il ne s'y bornait pas, du moins s'appuyait, est prsent clairement mprise. Les notions de sens commun, telles que l'espace trois dimensions, les postulats de la gomtrie euclidienne, sont laisses de ct ; certaines thories ne craignent mme pas de parler d'espace courbe, ou d'assimiler une vitesse mesurable une vitesse infinie. Les spculations concernant la nature de la matire se donnent libre cours, essayant d'interprter tel ou tel rsultat de notre physique sans s'inquiter le moins du monde de ce que peut tre pour les hommes du commun cette matire qu'ils sentent sous leurs mains. Bref tout ce qui est intuition est banni par les savants autant qu'il leur est possible, ils n'admettent plus dans la science que la forme abstraite du raisonnement, exprime dans un langage convenable au moyen des signes algbriques. Comme le raisonnement ne se produit au contraire chez le vulgaire qu'troitement li l'intuition, un abme spare le savant de l'ignorant. Les savants ont donc bien succd aux prtres des anciennes thocraties, avec cette diffrence qu'une domination usurpe est remplace par une autorit lgitime. Sans se rvolter contre cette autorit, on peut cependant l'examiner. L'on remarque aussitt des contradictions surprenantes. Voyons, par exemple, quelles sont les consquences de cet empire absolu exerc par la plus abstraite mathmatique sur la science. La science s'est purifie de ce qu'elle avait d'intuitif, nous l'avons remarqu, jusqu' ne plus concerner que des combinaisons de purs rapports. Mais il faut bien que ces rapports aient un contenu, et o le trouver, sinon dans l'exprience ? Aussi la physique ne fait-elle autre chose que d'exprimer, par des signes convenables, les rapports qui se trouvent entre les donnes de l'exprience. Autrement dit la physique peut tre considre comme consistant essentiellement en une expression mathmatique des faits. Au lieu d'tre reine de la science, la mathmatique n'est plus qu'un langage ; force de dominer, elle est rduite un rle servile. C'est pourquoi Poincar a pu dire, par exemple, que les gomtries euclidienne et non euclidienne ne diffrent que comme un systme de mesure d'un autre. Que doit-on penser, dit-il dans La Science et l'Hypothse, de cette question : la gomtrie euclidienne est-elle vraie ? Elle n'a aucun sens. Autant demander si le systme mtrique est vrai et si les anciennes mesures sont fausses ; si les coordonnes cartsiennes sont vraies et si les coordonnes polaires sont fausses. Une gomtrie ne peut tre plus vraie qu'une autre, elle peut
Simone Weil, Sur la science (1966) 13
seulement tre plus commode. Ainsi, selon le tmoignage du plus grand mathmaticien de notre sicle, la mathmatique n'est qu'un langage commode. Elle joue toujours, sous une forme ou sous une autre, le mme rle que nous lui voyons jouer dans les lois lmentaires de la physique, reprsentes par des courbes. L'exprience donne les points qui, sur le papier, reprsentent les mesures rellement faites ; le mathmaticien fournit seulement la courbe la plus simple qui comprenne tous ces points, de manire que les diverses expriences puissent tre ramenes une seule loi. Et c'est ce qu'a aussi reconnu Poincar. Toutes les lois, dit-il dans La Valeur de la Science, sont tires de l'exprience ; mais pour les noncer, il faut une langue spciale... Les mathmatiques fournissent au physicien la seule langue qu'il puisse parler. cette fonction, et celle d'indiquer au physicien des analogies entre les phnomnes par la ressemblance des formules qui les expriment, se borne, selon Poincar, le rle de l'analyse. C'est au point qu' en croire ceux qui sont comptents en la matire, les savants sont arrivs traduire l'exprience par des quations diffrentielles qu'ils se trouvent incapables de rapporter l'nergie ou la force, ou l'espace, ou n'importe quelle notion proprement physique. Ainsi cette science qui mprisait superbement l'intuition se trouve ramene traduire l'exprience dans le langage le plus gnral possible. Une autre contradiction concerne le rapport de la science et des applications. Les savants modernes, considrant, comme, semble-t-il, il leur convient de le faire, la connaissance comme le plus noble but qu'ils puissent se proposer, refusent de mditer en vue des applications industrielles, et proclament bien haut, avec Poincar, que, s'il ne peut y avoir de Science pour la Science, il ne saurait y avoir de Science. Mais c'est quoi semble mal convenir cette autre ide, que la question de savoir si telle thorie scientifique est vraie n'a aucun sens, et qu'elle n'est que plus ou moins commode. Au reste, la distance qui semblait se trouver entre le savant et l'ignorant se rduit ainsi une diffrence de degr, car la science se trouve tre, non plus vraie, mais plus commode que la perception. Ces contradictions ne sont-elles insolubles qu'en apparence ? Ou sont-elles un signe que les savants, en sparant comme ils font la pense scientifique de la pense commune, se rglent sur leurs propres prjugs plutt que sur la nature de la science ? Le meilleur moyen de le savoir est de prendre la science sa source et de chercher selon
Simone Weil, Sur la science (1966) 14
quels principes elle s'est constitue ; mais plutt qu' Thals, c'est, pour les raisons donnes plus haut, l'origine de la science moderne qu'il nous faut remonter, la double rvolution par laquelle la physique est devenue une application de la mathmatique et la gomtrie est devenue algbre, autrement dit Descartes.
Premire partie
Retour la table des matires
S'il a pu y avoir pour nous incertitude touchant la question de savoir si, dans sa source mme, la science a comme substitu au monde sensible un monde intelligible, cette incertitude ne semble pas devoir tre longue dissiper. Car si nous ouvrons les Mditations, nous lisons tout d'abord : Tout ce que j'ai reu jusqu' prsent pour le plus vrai et le plus assur, je l'ai appris des sens, ou par les sens ; or j'ai quelquefois prouv que ces sens taient trompeurs, et il est de la prudence de ne se fier jamais entirement ceux qui nous ont une fois tromps. En consquence de quoi, lorsque Descartes veut chercher la vrit, il ferme les yeux, il bouche ses oreilles, il efface mme de sa pense toutes les images des choses corporelles, ou du moins, parce qu' peine cela se peut-il faire, il les rfute comme vaines et comme fausses. Il est vrai que ceci concerne une recherche mtaphysique, et non mathmatique ; mais l'on sait que Descartes considrait sa doctrine mtaphysique comme le fondement de toutes ses penses. Ainsi la premire dmarche de Descartes pensant est de faire abstraction des sensations. Il est vrai que ce n'est l qu'une forme de son doute hyperbolique, et l'on pourrait croire que cette dfiance l'gard des sens n'est que provisoire, conformment la comparaison par laquelle Descartes explique ce qu'est pour lui le doute dans sa rponse aux septimes objections : Si forte haberet corbem pomis plenam, et vereretur ne aliqua ex pomis istis essent putrida, velletque ipsa auferre, ne reliqua corrumperent, quo pacto id faceret ? An non in primis omnia omnimo ex corbe rejiceret ? Ac deinde singula ordine perlustrans, ea sola quae agnosceret non esse corrupta, resumeret, atque in corbem
Simone Weil, Sur la science (1966) 15
reponeret, aliis relictis 2 (VIII, p. 481.) De fait la croyance aux tmoignages des sens n'est pas au nombre des penses que Descartes, aprs les avoir rejetes, reprend comme saines. L'objet de la physique cartsienne est au contraire de remplacer les choses que nous sentons par des choses que nous ne faisons que comprendre, au point de supposer, comme source des rayons solaires, un simple tourbillon. Le soleil mme est priv de sa lumire par l'esprit. Et voici en effet le dbut du Monde autrement intitul Trait de la Lumire : Me proposant de traiter ici de la Lumire, la premire chose dont je veux vous avertir est qu'il peut y avoir de la diffrence entre le sentiment que nous en avons, c'est--dire l'ide qui s'en forme en notre imagination par l'entremise de nos yeux, et ce qui est dans les objets qui produit en nous ce sentiment, c'est--dire ce qui est dans la flamme ou dans le soleil, qui s'appelle du nom de lumire. (IX, p. 3.) Ce qu'il montre par un exemple tir de l'exprience mme. L'attouchement est celui de tous nos sens que l'on estime le moins trompeur et le plus assur ; de sorte que, si je vous montre que l'attouchement mme nous fait concevoir plusieurs ides, qui ne ressemblent en aucune faon aux objets qui les produisent, je ne pense pas que vous deviez trouver trange, si je dis que la vue peut faire le semblable... Un gendarme revient d'une mle : pendant la chaleur du combat, il aurait pu tre bless sans s'en apercevoir ; mais maintenant qu'il commence se refroidir, il sent de la douleur, il croit tre bless : on appelle un chirurgien, on le visite, et l'on trouve enfin que ce qu'il sentait n'tait autre chose qu'une boucle ou une courroie qui, s'tant engage sous ses armes, le pressait et l'incommodait. Si son attouchement, en lui faisant sentir cette courroie, en et imprim l'image en sa pense, il n'aurait pas eu besoin d'un chirurgien pour l'avertir de ce qu'il sentait. (XI, p. 5.) Refusant donc de croire aux sens, c'est la seule raison que Descartes se fie, et l'on sait que son systme du monde est le triomphe de ce qu'on nomme la mthode a priori ; et cette mthode, il l'a applique
2
Si par hasard (quelqu'un) avait une corbeille pleine de fruits et qu'il lui semblt que quelques-uns de ces fruits fussent gts, et qu'il veuille les retirer, pour qu'ils ne pourrissent pas le reste, comment s'y prendrait-il ? Est-ce que d'abord il ne retirerait pas absolument tous les fruits de la corbeille ? Et ensuite, les examinant soigneusement un par un, ne reprendrait-il pas ceux-l seuls qu'il saurait ne pas tre abms, et ne les replacerait-il pas dans la corbeille, en abandonnant les autres ?
Simone Weil, Sur la science (1966) 16
avec une audace qui n'a eu, selon une parole connue, ni exemple ni imitateur ; car il va jusqu' dduire l'existence du ciel, de la terre et des lments. L'ordre que j'ai tenu en ceci, crit-il dans le Discours de a Mthode, a t tel. Premirement j'ai tch de trouver en gnral les Principes ou Premires Causes de tout ce qui est, ou qui peut tre dans le monde, sans rien considrer pour cet effet que Dieu seul qui l'a cr, ni les tirer d'ailleurs que de certaines semences de vrit qui sont naturellement en nos mes. Aprs cela j'ai examin quels taient les premiers et les plus ordinaires effets qu'on pouvait dduire de ces causes : et il me semble que par l j'ai trouv des Cieux, des Astres, une Terre et mme, sur la terre, de l'eau, de l'air, du feu, des minraux, et quelques autres telles choses qui sont les plus communes de toutes et les plus simples. (VI, p. 63.) Programme qui est rempli par les Principes avec ce commentaire presque insolent, qui se retrouve aussi dans la Correspondance : Les dmonstrations de tout ceci sont si certaines qu'encore que l'exprience nous semblerait faire voir le contraire, nous serions nanmoins obligs d'ajouter plus de foi notre raison qu' nos sens. (Principes, 11, 52.) De quoi l'on peut rapprocher ce passage d'une lettre Mersenne : Je me moque du Sr. Petit, et de ses paroles, et on n'a, ce me semble, pas plus sujet de l'couter, lorsqu'il promet de rfuter mes rfractions par l'exprience, que s'il voulait faire voir, avec quelque mauvaise querre, que les trois angles d'un triangle ne seraient pas gaux deux droits. (11, p. 497.) Ainsi la physique cartsienne est gomtrique ; mais la gomtrie cartsienne, son tour, est bien loin de cette gomtrie classique que Comte a si bien nomme spciale parce qu'elle est attache aux formes particulires. Ici, puisque nous considrons Descartes historiquement, il peut tre utile de considrer quelle forme ont prise ses ides chez les philosophes qui sont plus ou moins ses disciples. Or, la suite de la Gomtrie de 1637, Malebranche et Spinoza se sont accords distinguer, quoique diffremment, l'tendue intelligible de cette tendue qui est jete comme un manteau sur les choses et ne parle qu' l'imagination. Quoique Descartes n'ait pas t explicitement jusque-l, c'est lui qu'il faut faire honneur de cette vigoureuse ide. Non qu'il n'ait sembl la sous-entendre par endroits, comme dans le clbre passage du morceau de cire o Descartes dpouille l'tendue de ses vtements de couleurs, d'odeurs, de sons, mais plus encore dans les lignes suivantes, adresses Morus, o l'tendue semble dj,
Simone Weil, Sur la science (1966) 17
comme elle sera dans Spinoza, conue, non encore il est vrai comme indivisible, mais indpendamment des parties : Tangibilitas et impenetrabilitas in corpore est tantum ut in homine risibilitas, proprium quarto modo, juxta vulgares logicae leges, non vera et essentialis differentia, quam in extensione consistere contendo ; atque idcirco, ut homo non dfinitur animal risibile, sed rationale, ita corpus non definiri per impenetrabiJitatem, sed per extensionem. _Quod confirmatur ex eo quod tangibilitas et impenetrabilitas habeant relationem ad partes, et praesupponant conceptum divisionis vel terminationis, possumus autem concipere corpus continuum indeterminatae magnitudinis, sive indefinitum, in quo nihil praeter extensionem consideretur 3 . Nanmoins c'est dans la rvolution que fut, pour les mathmatiques, la Gomtrie de 1637 qu'clate surtout cette ide de la pure tendue, de l'tendue en soi, pour parler un langage platonicien. Les gomtres anciens raisonnaient, il est vrai, non pas sur le triangle ou le cercle qu'ils avaient devant les yeux, mais sur le triangle ou le cercle en gnral ; ils restaient pourtant comme colls au triangle ou au cercle. Comme leurs dmonstrations s'appuyaient sur l'intuition, elles gardaient toujours quelque chose de propre l'espce de figure qu'elles avaient pour objet. Quand Archimde eut mesur l'espace enferm par un segment de parabole, cette admirable dcouverte ne fut pourtant d'aucun secours pour les recherches analogues concernant, par exemple, l'ellipse ; car c'taient les proprits particulires de la parabole qui, au moyen d'une construction impraticable ou inutile pour toute autre figure, rendaient cette mesure possible. Descartes a compris le premier que l'unique objet de la science, ce sont des quantits mesurer, ou plutt les rapports qui dterminent cette mesure, rapports
3
Mais encore un coup, ce pouvoir d'tre touch, ou cette impntrabilit dans le corps, est seulement comme la facult de rire dans l'homme, le proprium quarto modo des rgles communes de la logique : mais ce n'est pas sa diffrence vritable et essentielle, qui, selon moi, consiste dans l'tendue ; et par consquent, comme on ne dfinit point l'homme un animal risible, mais raisonnable, on ne doit pas aussi dfinir le corps par son impntrabilit, mais par l'tendue, d'autant plus que la facult de toucher et l'impntrabilit ont relation des parties, et prsupposent dans notre esprit l'ide d'un corps divis ou termin, au lieu que nous pouvons fort bien concevoir un corps continu d'une grandeur indtermine ou indfinie, dans lequel on ne considre que l'tendue.
Simone Weil, Sur la science (1966) 18
qui, dans la gomtrie, se trouvent seulement comme envelopps dans les figures, de mme qu'ils peuvent l'tre, par exemple, dans les mouvements. C'est aprs cette intuition de gnie qu' partir de Descartes les gomtres cessrent de se condamner, comme avaient fait les gomtres grecs, ne faire correspondre une expression ayant un degr quelconque qu' une tendue ayant un nombre de dimensions correspondant, lignes pour les quantits simples, surfaces pour les produits de deux facteurs, volumes pour les produits de trois. En effet : Omnia eodem se habent modo, si considerentur tantum sub ratione dimensionis, ut hie et in Maihematicis disciplini., est faciendum... Cujus rei anidmadversio magnam Geometriae adfert lucem, quoniam in illa fere omnes male concipiunt tres species quantitatis : lineam, superficiem et corpus. Jam enim ante relatum est, lineam et superficiem non cadere sub conceptum ut vere distinctas a corpore, vel ab invicem ; si vero considerentur smpliciter, ut per intellectum abstractae, tunc non magis diversae sunt species quantitatis, quam animal et vivens in homine sunt diversae species substantiae 4 . (X, p. 448.) Les mathmatiques taient ainsi dlivres de la superstition par laquelle chaque figure avait comme sa quantit propre. Les figures rie furent plus ds lors que des donnes qui posaient des rapports de quantit ; il ne fallait plus qu'adapter les signes arithmtiques cette nouvelle espce de rapports ; mais dj Vite, en crant l'algbre, les avait adapts tous les rapports possibles. Les courbes elles-mmes furent dfinies par la loi, c'est--dire par la formule, qui les rapprochait ou les loignait, mesure qu'elles taient traces, d'une droite arbitrairement choisie. Bref, partir de 1637, l'essence du cercle, selon l'expression que devait employer Spinoza, n'tait plus circulaire. Toutes les figures furent comme dissoutes, la droite subsista seule et les gomtres cessrent, l'exemple de Descartes, de considrer d'autres thormes,
4
... Toutes ces choses sont quivalentes, si on les considre seulement sous le rapport de la dimension, comme on doit le faire ici et dans les sciences mathmatiques... Cette considration jette un grand jour sur la gomtrie, car la plupart des hommes ont le tort de concevoir dans cette science trois espces de quantits : la ligne, la surface et le corps. Il a dj t dit, en effet, que la ligne et la surface ne sont pas conues comme vraiment distinctes du corps, ou comme distinctes l'une de l'autre ; mais si on les considre simplement en tant qu'abstraites par l'entendement, elles ne sont pas plus, pour lors, des espces diffrentes de quantits que l'animal et l'tre vivant ne sont dans l'homme diffrentes espces de substances.
Simone Weil, Sur la science (1966) 19
sinon que les cts des triangles semblables ont semblable proportion entre eux, et que dans les triangles rectangles le carr de la base est gal aux deux carrs des cts... Car... si l'on tire d'autres lignes et qu'on se serve d'autres thormes... on ne voit point si bien ce qu'on fait, si ce n'est qu'on ait la dmonstration du thorme fort prsente l'esprit ; et en ce cas on trouve, quasi toujours, qu'il dpend de la considration de quelques triangles, qui sont ou rectangles ou semblables entre eux, et ainsi on retombe dans mon chemin (IV,p. 38) Au reste il est clair que l'initiative hardie, et aprs quelque temps presque universellement imite, par laquelle Fourier, dans ses clbres tudes sur la chaleur, ngligea l'intermdiaire de la mcanique pour appliquer directement l'analyse la physique, ne faisait que rpter, sur une autre matire, la Gomtrie de 1637. Ou plutt, cette Gomtrie n'tait qu'une des applications de ce principe gnral, appliqu aujourd'hui dans toutes les tudes qui le comportent, que les rapports entre les quantits sont le seul objet du savant. L'on peut mme penser que Descartes aurait devanc la science moderne en se servant de l'analyse pour la physique comme pour la gomtrie, s'il avait eu entre les mains un instrument assez labor. Il ne faut pas s'tonner que l'inventeur de cette vue hardie n'ait eu, comme nous l'avons remarqu, que mpris pour ce que Spinoza appellera la connaissance du premier genre. Pas plus que Spinoza il ne croit qu'on puisse tre sage sans philosopher, et nul n'a employ ce sujet des expressions plus fortes. C'est proprement avoir les yeux ferms, dit-il dans la prface des Principes, sans tcher jamais de les ouvrir, que de vivre sans philosopher... et enfin cette tude est plus ncessaire pour rgler nos murs, et nous conduire en cette vie, que n'est l'usage de nos yeux pour conduire nos pas. Enfin l'on ne s'tonnera pas que celui qui carte rsolument les ides qui se forment dans l'imagination par l'entremise de nos yeux , et dlivre la mathmatique du joug de l'intuition, ait, comme Spinoza, rabaiss l'imagination ne consister qu'en des mouvements du corps humain. C'est ce que montre un texte des Regulae : Concipiendum est... phantasiam esse veram partem corporis, et plus loin : ex bis intelligere licet, quomodo fieri possint omnes alio-
Simone Weil, Sur la science (1966) 20
rum animalium motus, quamvis in illis nulla prorsus rerum cognitio sed phantasia tantum pure corporea admittatur 5 (X, p. 414). Ainsi la science est comme purifie de la boue natale, si l'on peut ainsi parler, dont Thals et ses successeurs ne l'avaient pas entirement nettoye. Elle est ce que Platon avait pressenti : un ensemble d'ides. Et c'est ici l'occasion de saisir un autre aspect de la pense cartsienne l'aide d'un autre disciple de Descartes. Leibniz ; car si Leibniz a voulu btir, non seulement la connaissance humaine, mais mme la connaissance divine, qui, selon son systme, est la mme chose que le monde, avec des ides, c'est Descartes, encore qui doit tre considr comme l'inspirateur de cette doctrine. Dans les Mditations il se contentait, il est vrai, de remarquer l'existence en son esprit d'ides qui, disait-il, ne peuvent tre estimes un pur nant, et ne sont pas feintes par lui, mais ont leurs natures vraies et immuables. Mais dans les Regulae, uvre dont Leibniz possdait une copie, Descartes va bien plus loin en sa doctrine des ides simples, qu'il dfinit ainsi : Absolutum voco, quidquid in se continet naturam puram et simplicem, de qua est quaestio : ut omne id quod consideratur quasi independens, causa, simplex, universale, unum, aequale, simile, rectum, vel alia bujusmodi ; atque idem primum voco simplicissimum et facillimum, ut illo utamur in quaestionibus resolvendis 6 . (X, p. 381.) Et comment doit-on s'en servir ? C'est ce qu'on voit plus loin. Notandum paucas esse dumtaxat naturas puras et simplices, quas primo et per se, non dependenter ab allis ullis, sed vel in ipsis experimentis,vel lumine quodam in nobis insito, licet intueri ; atque has dicimus diligenter esse observandas : sunt enim eaeYem quas in unaquaque serie maxime simplices appellamus. Caeterae autem omnes non aliter percipi possunt, quamsi ex istis deducantur, idque vel immediate et
5
Il faut se reprsenter que cette imagination est une vritable partie du corps... (Par l) on peut comprendre comment peuvent s'accomplir tous les mouvements que font les animaux, bien qu'en eux on ne puisse admettre aucune connaissance des choses, mais seulement une imagination purement corporelle... J'appelle absolu tout ce qui contient en soi la nature pure et simple dont il est question : ainsi tout ce qui est considr comme indpendant, cause, simple, universel, un, gal, semblable, droit ou d'autres choses de ce genre ; et je l'appelle le plus simple et le plus facile, afin que nous nous en servions pour rsoudre les questions.
Simone Weil, Sur la science (1966) 21
proxime, vel non nisi per duas, aut tres aut plures conclusiones diversas 7 . (X, p. 383.) Et plus loin ce texte plus significatif encore - Colligitur tertio, omnem humanam scientiam in hoc uno consistere, ut distincte videamus, quomodo naturae istae simplices ad compositionem alia-rum rerum simul concurrant 8 . (X, p. 427.) Il suffit de pousser l'ide jusqu' ses dernires consquences pour retrouver Leibniz. Car si ces difices transparents faits d'ides simples arrivent, en s'levant, approcher de plus en plus la complication des choses existantes, devons-nous croire que l'abme qui spare malgr tout nos raisonnements du monde n'est pas d notre esprit born, plutt qu' la nature des ides ? D'o l'on arrive se reprsenter qu'en un entendement infini il doit tre vrai que Csar a pass le Rubicon, exactement comme il est vrai pour nous que deux et deux font quatre. S'il n'en est pas ainsi pour nous, c'est qu'il est besoin, pour connatre proprement parler un vnement, d'une analyse infinie. Quoiqu'il soit ais, dit Leibniz, de juger que le nombre de pieds du diamtre n'est pas enferm dans la notion de la sphre en gnral, il n'est pas si ais de juger si le voyage que j'ai dessein de faire est enferm dans ma notion ; autrement il nous serait aussi ais d'tre prophtes que d'tre gomtres. L'ide que nous pouvons nous faire de Descartes comme fondateur de la science moderne semble ainsi complte. La gomtrie classique tait encore comme colle la terre ; il l'en a dtache, il a t comme un second Thals par rapport Thals. Il a transport la connaissance de la nature du domaine des sens au domaine de la raison. Il a donc purifi notre pense d'imagination, et les savants modernes, qui ont appliqu l'analyse directement tous les objets susceptibles d'tre ainsi tudis, sont ses vrais successeurs. Poincar, en substituant aux
7
Il faut noter, deuximement, qu'il n'y a que peu de natures pures et simples, dont, de prime abord et par elles-mmes, nous puissions avoir l'intuition, indpendamment de toutes les autres, soit par des expriences, soit par cette lumire qui est en nous ; aussi disons-nous qu'il faut les observer avec soin ; car ce sont elles que nous appelons les plus simples dans chaque srie. Toutes les autres, au contraire, ne peuvent tre perues que si elles sont dduites de celles-ci, et cela soit immdiatement et prochainement, soit par l'intermdiaire de deux. trois ou plusieurs conclusions diffrentes... Il rsulte, troisimement, que toute science humaine ne consiste qu' voir distinctement comment ces natures simples concourent la composition des autres choses.
Simone Weil, Sur la science (1966) 22
preuves intuitives concernant l'addition et la multiplication des preuves analytiques, a fait preuve d'esprit cartsien. Ceux qui aprs Leibniz, esprent btir pour ainsi dire l'univers avec des ides, ou pensent du moins que l'univers en Dieu, ou bien, pour parler autrement, en soi, n'est pas bti autrement, ceux-l aussi procdent de Descartes. Il n'est pas jusqu' l'opposition, remarque plus haut, entre la commodit prise comme rgle de la science et le mpris des applications que l'on ne retrouve en Descartes. Car si dans sa jeunesse, lorsqu'il pense que les sciences ne servent qu'aux arts mcaniques, il juge que des fondements si fermes n'ont servi rien de bien relev, d'autre part il ne semble pas plus que Poincar exiger des thories scientifiques qu'elles soient vraies, mais seulement qu'elles soient commodes. C'est ainsi qu'il compare souvent ses thories aux ides des astronomes concernant l'quateur et l'cliptique, qui, bien que fausses, ont fond l'astronomie. C'est qu'il veut que l'ordre, essence de la science cartsienne, ne se conforme pas servilement la nature des choses, mais s'applique mme aux choses qui ne se suivent pas naturellement les unes les autres . Bref, la science moderne a t ds l'origine, quoique moins dveloppe, ce qu'elle est actuellement. La question que nous nous posions tout l'heure est rsolue. Il faut accepter la science telle qu'elle est, ou y renoncer. Il n'y aurait qu' en rester l, et il n'y aurait plus aucune question poser, si une lecture quelque peu attentive de Descartes ne suffisait pas pour rencontrer une foule de textes difficilement conciliables, semble-t-il, avec l'esquisse de la philosophie cartsienne prcdemment trace ; aussi allons-nous passer en revue quelques-uns de ces textes, que nous grouperons par ordre autant qu'il est possible, nous rservant de les commenter par la suite. Tout d'abord il n'est pas vrai que Descartes, en cultivant les sciences, en ddaigne les applications. Non seulement les dernires annes de sa vie ont t consacres tout entires la mdecine, qu'il considrait comme le seul moyen propre rendre le commun des hommes plus sages, en leur donnant la sant, mais, bien plus, ce n'est qu'en vue des applications qu'il a pris la peine de communiquer ses rflexions au public. Car, dit-il, tant qu'il n'tait arriv des rsultats satisfaisants que touchant les sciences spculatives ou la morale, il ne s'tait pas cru oblig de les publier. Mais, poursuit-il, sitt que j'ai eu acquis quelques notions gnrales touchant la physique, et que, commenant les prouver en diverses difficults particulires, j'ai remarqu jus-
Simone Weil, Sur la science (1966) 23
qu'o elles peuvent conduire, et combien elles diffrent des principes dont on s'est servi jusqu' prsent, j'ai cru que ne je pouvais les tenir caches sans pcher grandement contre la loi qui nous oblige procurer, autant qu'il est en nous, le bien gnral de tous les hommes. Car elles m'ont fait voir qu'il est possible de parvenir des connaissances qui soient fort utiles la vie, et qu'au lieu de cette philosophie spculative qu'on enseigne dans les coles, on en peut trouver une pratique, par laquelle connaissant la force et les actions du feu, de l'eau, de l'air, des astres, des cieux, et de tous les autres corps qui nous environnent, aussi distinctement que nous connaissons les divers mtiers de nos artisans, nous les pourrions employer en mme faon tous les usages auxquels ils sont propres, et ainsi nous rendre comme matres et possesseurs de la nature. (VI, p. 61.) En ces lignes, qui rendent pour ainsi dire le mme son que celles, non moins vigoureuses, o Proudhon osera dire plus tard que par les seules applications les spculations scientifiques mritent le noble nom de travaux , la science semble tre considre l'gard de la nature, non comme la satisfaction de notre curiosit, mais comme une prise de possession. Ce n'est pas que la science cartsienne ne serve aussi une fin qu'on peut considrer comme plus releve ; mais c'est la dernire qui nous viendrait aujourd'hui l'esprit, car cette fin consiste fonder la morale. Descartes l'crit expressment Chanut, propos des Principes : On peut dire que ce ne sont que des vrits de peu d'importance, touchant des matires de Physique qui semblent n'avoir rien de commun avec ce que doit savoir une Reine. Mais... ces vrits de Physique font partie des fondements de la plus haute et de la plus parfaite morale. (V, p. 290.) Et l'on ne peut souponner Descartes d'entendre cette liaison comme fit plus tard Comte, car il n'y a pas en son uvre trace de sociologie. Comment l'entendait-il ? C'est ce qu'il n'est pas facile de savoir. Mais ainsi prvenus nous serons moins tonns en remarquant que, si Descartes, comme Poincar, demande plutt la science de se conformer l'esprit qu'aux choses, il ne s'agit nullement pour lui de penser commodment, mais bien, c'est--dire en dirigeant la pense comme il faut. C'est pour cela, et non parce qu'elle n'est pas assez gnrale ou assez fconde, qu'il ne peut se contenter de la gomtrie classique, o il avait d'abord espr trouver de quoi satisfaire son dsir de savoir. Sed in neutra Scriptores, qui mihi abunde satisfecerint, tunc
Simone Weil, Sur la science (1966) 24
forte incidebant in manus,- nam plurima quidem in iisdem legebam circa numeros, quae subductis rationibus vera esse experiebar ; circa figuras vero, multa ipsismet oculis quodammodo exhibebant, et ex quibusdam consequentibus concludebant ; sed quare haec ita se habeant, et quomodo invenirentur, menti ipsi non satis videbantur ostendere 9 . (X, p- 375.) Et s'il essaie de retrouver l'analyse des gomtres grecs, il fait clairement entendre en ses Rponses aux Deuximes Objections en quoi consiste l'avantage d'une telle analyse. L'analyse montre la vraie voie par laquelle une chose a t mthodiquement invente, et fait voir comment les effets dpendent des causes ; en sorte que, si le lecteur la veut suivre, et jeter les yeux soigneusement sur tout ce qu'elle contient, il n'entendra pas moins parfaitement la chose ainsi dmontre, et ne la rendra pas moins sienne, que si lui-mme l'avait invente. (lX, p. 121.) quoi s'oppose la science telle qu'on l'enseigne : La synthse, au contraire, par une voie tout autre, et comme en examinant es causes par leurs effets (bien que la preuve qu'elle contient soit souvent aussi des effets par les causes), dmontre la vrit clairement ce qui est contenu en ses conclusions, et se sert d'une longue suite de dfinitions, de demandes, d'axiomes, de thormes et de problmes, afin que, si on lui nie quelques consquences, elle fasse voir comment elles sont contenues dans les antcdents, et qu'elle arrache le consentement du lecteur, tant obstin et opinitre qu'il puisse tre ; niais elle ne donne pas, comme l'autre, une entire satisfaction aux esprits de ceux qui dsirent d'apprendre, parce qu'elle n'enseigne pas la mthode par laquelle la chose a t invente. (lX, p. 12.2.) Aussi Descartes ne considre-t-il pas les rsultats comme ayant, pour celui qui veut s'instruire, la plus petite importance. L'on peut trouver la solution d'une question sans que ce soit science : Quae omnia distinguimus, nos qui rerum cognitionem evidentem et distinctam quaerimus, non autem Logistae, qui contenti sunt, si occurrat illis summa quaesita, etiamsi non anidmadvertant quomodo eadem depen-
Mais ni pour l'une ni pour l'autre je ne mettais la main sur des auteurs qui m'aient pleinement satisfait : je lisais bien chez eux beaucoup de choses touchant les nombres, qu'aprs avoir fait des calculs je reconnaissais vraies ; et mme touchant les figures ils me mettaient en quelque sorte sous les yeux bien des vrits, qu'ils tiraient de certains principes ; mais ils ne me paraissaient pas faire voir assez clairement l'esprit pourquoi il en est ainsi, et comment s'tait faite l'invention.
Simone Weil, Sur la science (1966) 25
deat ex datis, in quo tamen uno scientia proprie consistit 10 . (X p. 458.) Savoir qu'on ne peut savoir est science aussi bien : Rem quaesitam omnem humani ingenii captum excedere demonstrabit, ac proinde non se idcirco magis ignarum esse arbitrabitur, quia non minor scientia est hoc ipsum quam quodvis aliud Cognovisse 11 . (X, p. 400.) L'ordre est toute la science, et la mthode cartsienne - les Regulae le rptent sans cesse - ne concerne que l'ordre. Il n'y a de problmes que parce que souvent ce sont les lments le plus composs d'une srie qui nous sont donns, alors que les plus simples nous restent inconnus ; l'esprit doit alors procder selon sa dmarche propre, en parcourant ces lments, connus ou non, selon la srie. Ainsi, voulant rsoudre quelque problme, on doit d'abord le considrer comme dj fait, et donner des noms toutes les lignes qui semblent ncessaires pour le construire, aussi bien celles qui sont inconnues qu'aux autres. Puis, sans considrer aucune diffrence entre ces lignes connues et inconnues, on doit parcourir la difficult selon l'ordre qui montre, le plus naturellement de tous, en quelle sorte elles dpendent mutuellement les unes des autres. (VI, p. 372.) Ainsi comprise, la mathmatique prend un vritable intrt, alors que, selon la mthode d'explication classique, elle n'en avait, aux yeux de Descartes, aucun ; et il ne s'tonnait pas, dit-il dans les Regulae, si bien des gens habiles les ddaignent comme puriles et vaines, ou comme trop compliques. Nam revera nihil inanius est, quam circa nudos numeros figurasque imaginarias ita versari, ut velle videamur in talium nu,garum cognitione conquiescere 12 ( X, p. 375.) Aussi cette mathmatique nouvelle vautelle la peine d'tre cultive,non parce qu'elle nous procure, au sujet de nombres ou de figures imaginaires, ces connaissances que Descartes traite de bagatelles, et qui ne sont, dit-il, que l'amusement de calcula10 Tout cela nous le distinguons, nous qui cherchons une connaissance vi-
dente et distincte des choses, mais non les Calculateurs, qui sont satisfaits, pourvu qu'ils trouvent la somme cherche, sans remarquer mme comment elle dpend des donnes, alors que c'est l cependant la seule chose qui constitue vraiment la science. 11 Il dmontrera que ce qu'il cherche dpasse les bornes de l'intelligence humaine, et par suite il ne s'en croira pas plus ignorant, parce que ce rsultat n'est pas une moindre science que la connaissance de quoi que ce soit d'autre. 12 Car, en vrit, rien n'est plus vain que de s'occuper de nombres vides et de figures imaginaires, au point de paratre vouloir se complaire dans la connaissance de pareilles bagatelles.
Simone Weil, Sur la science (1966) 26
teurs ou de gomtres oisifs, mais parce qu'elle est comme l'enveloppe de la vraie science, seule digne d'tre cultive. Ce qui ressort aussi des Regulae : Quicumque tamen attente respexerit ad meum sensum, facile percipiet me nihil minus quam de vulgari Mathematica hic cogitare, sed quandam aliam me exponere disciplinam, cujus integumentum sint potius quam partes. Haec enim prima rationis humanae rudimenta continere, et ad veritates ex quovis subjecto eliciendas se extendere debet ; atque, ut libere loquar, banc omni alia nobis humanitus tradita cognitione potiorem, utpote aliarum omnium fontem, esse mihi persuadeo 13 . (X, p. 374.) Puisque la science vritable ne consiste qu' bien diriger sa raison, il n'y a pas ingalit, ni entre les sciences, ni entre les esprits. Une science ou une partie d'une science ne peut tre plus difficile que n'importe quelle autre. Atqui notandum est illos, qui vere sciunt, aequa facilitate dignoscere veritatem, sive illam ex simplici subjecto, sive ex obscuro eduxerint : unamquamque enim simili, unico, et distincto actu comprehendunt, postquam semel ad illam pervenerunt ; sed tota diversitas est in via, quae certe longior esse debet, si ducat ad veritatem a primis et maxime absolutis principiis magis remotam 14 . (Regulae, p. 401.) Aucun homme ne doit donc renoncer aborder une partie quelconque de la connaissance humaine parce qu'il juge qu'elle dpasse sa porte, ni non plus parce qu'il croit ne pouvoir faire de progrs srieux dans une science qu' condition de s'y spcialiser. Nam cum scientiae omnes nihil aliud sint quam humana sapientia, quae semper una et eadem manet, quantumvis differentibus subjectis applicata, nec majorem ab illis distinctionem mutuatur,
13 ... Quiconque considrera attentivement ma pense s'apercevra facilement
que je ne songe nullement ici aux Mathmatiques ordinaires, mais que j'expose une autre science, dont elles sont l'enveloppe plus que les parties. Cette science doit en effet contenir les premiers rudiments de la raison humaine et n'avoir qu' se dvelopper pour faire sortir des vrits de quelque sujet que ce soit ; et, pour parler librement, je suis convaincu qu'elle est prfrable toute autre connaissance que nous aient enseigne les hommes, puisqu'elle en est la source. 14 Or il faut noter que ceux qui savent vritablement reconnaissent la vrit avec une gale facilit, qu'ils l'aient tire d'un sujet simple ou d'un sujet obscur ; c'est en effet par un acte semblable, un et distinct, qu'ils comprennent chaque vrit, une fois qu'ils y sont parvenus ; toute la diffrence est dans le chemin, qui certainement doit tre plus long, s'il conduit une vrit plus loigne des principes premiers et absolus .
Simone Weil, Sur la science (1966) 27
quam Solis lumen a rerum, quas illustrat, varietate, non opus est ingenia limitibus ullis cohibere ; neque enim nos unius veritatis cognitio, veluti unius artis usus, ab alterius inventione dimovet, sed potius juvat 15 . (Regulae, p. 360.) Bien plus, il faut considrer au sujet des sciences : Ita omnes inter se esse connexas, ut longe facilius sit cunctas simul addiscere, quae., unicam ab allis separare 16 . (Regulae, p. 361.) Aussi un homme quelconque, si mdiocres que soient son intelligence et ses talents, peut-il, s'il s'y applique, connatre tout ce qui est la porte de l'homme ; tout homme statim atque distinxerit circa singula objecta cognitiones illas quae memoriam tantum impient vel ornant, ab iis propter quas vere aliquis magis eruditus dici debet, quod facile etiam assequetur... : sentiet omnino se nihil amplius ignorare ingenii dfectu vel artis, neque quidquam prorsus ab alio homine sciri posse, cujus etiam non sit capax, modo tantun. ad illud idem, ut par est, mentem applicet 17 . (Regulae, p. 396.) La mathmatique ainsi considre rgne sur la physique cartsienne, mais non comme sur la ntre ; elle n'y joue pas le rle de langage, elle constitue la connaissance du monde. Il est faible de dire, quoique Descartes le dise lui-mme, que la physique cartsienne est purement gomtrique ; la vrit est que la gomtrie en Descartes est par elle-mme une physique ; et c'est presque en propres termes ce
15 Car, tant donn que toutes les sciences ne sont rien d'autre que la Sagesse
humaine, qui demeure toujours une et toujours la mme, si diffrents que soient les objets auxquels elle s'applique, et qui ne reoit pas plus de changement de ces objets que la lumire du soleil de la varit des choses qu'elle claire, il n'est pas besoin d'imposer des bornes l'esprit : la connaissance d'une vrit ne nous empche pas en effet d'en dcouvrir une autre comme l'exercice d'un art nous empche d'en apprendre un autre, mais bien plutt elle nous y aide. 16 Il faut donc bien se convaincre que toutes les sciences sont tellement lies ensemble, qu'il est plus facile de les apprendre toutes la fois, que d'en isoler une des autres. 17 ... Chaque fois qu'il aura distingu, propos de chaque objet, les connaissances qui ne font que remplir ou orner la mmoire, de celles qui font dire de quelqu'un qu'il est vraiment plus savant, distinction qu'il est facile aussi de faire... il s'apercevra certainement qu'il n'ignore plus rien par manque d'intelligence ou de mthode, et que personne d'autre ne peut rien savoir qu'il ne soit capable de connatre lui aussi, pourvu seulement qu'il y applique son esprit comme il convient.
Simone Weil, Sur la science (1966) 28
qu'il ose crire Mersenne : Je n'ai rsolu de quitter que la gomtrie abstraite, c'est--dire la recherche des questions qui ne servent qu' exercer l'esprit ; et ce, afin d'avoir d'autant plus de loisir de cultiver une autre sorte de gomtrie, qui se propose pour questions l'explication des phnomnes de la nature. L'explication de la rflexion et de la rfraction, entre autres, remplit ce programme avec une audace encore aujourd'hui inoue, et qui a scandalis Fermat. La dmonstration de la loi par laquelle tout mouvement conserve sa direction, dans le Monde, n'est pas moins tonnante : Dieu conserve chaque chose par une action continue, et, par consquent, il ne la conserve point telle qu'elle peut avoir t quelque temps auparavant, mais prcisment telle qu'elle est au mme instant qu'il la conserve. Or est-il que, de tous les mouvements, il n'y a que le droit qui soit entirement simple, et dont toute la nature soit comprise en un instant. Car, pour le concevoir, il suffit de penser qu'un corps est en action pour se mouvoir vers un certain ct, ce qui se trouve en chacun des instants qui peuvent tre dtermins pendant le temps qu'il se meut. Au lieu que, pour concevoir le mouvement circulaire, ou quelque autre que ce puisse tre, il faut au moins considrer deux de ses instants, ou plutt deux de ses parties, et le rapport qui est entre elles. (XI, p. 44.) Il n'y a pas d'exemple, pour employer les termes de l'cole, d'un idalisme aussi audacieux. Cent autres textes de Descartes feraient voir que nul n'a pouss si loin le ralisme. C'est le monde tel qu'il est en soi qu'il veut connatre, et il l'crit Morus : Res te monet, si dicatur substantia sensibilis, tunc dfiniri ab habitudine ad sensus nostros : qua ratione quaedam eius proprietas dumtaxat explicatur, non integra natura, quae, cum possit existere, quamvis nulli homines existant, certe a sensibus nostris nonpendet 18 . (V, p. 268.) Qu'aprs cela il ait choisi de dfinit le monde par l'tendue, c'est--dire par une ide, c'est ce dont on s'est de tout temps tonn. Mais que cet idalisme et ce ralisme, tous deux extrmes, soient pour lui non seulement conciliables, mais corrlatifs, c'est ce qu'il fait, sinon compren18 Mais prenez garde qu'en disant une substance sensible vous ne la dfinissez
que par le rapport qu'elle a nos sens, ce qui n'en explique qu'une proprit, au lieu de comprendre l'essence entire des corps qui, pouvant exister quand il n'y aurait point d'hommes, ne dpend pas par consquent de nos sens.
Simone Weil, Sur la science (1966) 29
dre, du moins explicitement savoir dans le texte suivant de la Lettre sur Gassendi : Plusieurs excellents esprits, disent-ils, croient voir clairement que l'tendue mathmatique, laquelle je pose pour le principe de ma physique, n'est rien autre chose que ma pense, et qu'elle n'a, ni ne peut avoir, nulle subsistance hors de mon esprit, n'tant qu'une abstraction que je fais du corps physique ; et partant, que toute ma physique ne peut tre qu'imaginaire et feinte, comme sont toutes les pures mathmatiques ; et que, dans la physique relle des choses que Dieu a cres, il faut une matire relle, solide, et non imaginaire. Voil l'objection des objections, et l'abrg de toute la doctrine des excellents esprits qui sont ici allgus. Toutes les choses que nous pouvons entendre et concevoir ne sont, leur conte, que des imaginations et des fictions de notre esprit, qui ne peuvent avoir aucune subsistance : d'o il suit qu'il n'y a rien que ce qu'on ne peut aucunement entendre, ni concevoir, ou imaginer, qu'on doive admettre pour vrai, c'est--dire qu'il faut entirement fermer la porte la raison, et se contenter d'tre singe, ou perroquet, et non plus homme, pour mriter d'tre nus au rang de ces excellents esprits. Car, si les choses qu'on peut concevoir doivent tre estimes fausses pour cela seul qu'on les peut concevoir, que reste-t-il, sinon qu'on doit seulement recevoir pour vraies celles qu'on ne conoit pas, et en composer sa doctrine, en imitant les autres sans savoir pourquoi on les imite, comme font les singes, et en ne profrant que des paroles dont on n'entend point le sens, comme font les perroquets ? (1X, p. 212). Cette opposition se retrouve partout. Si cette gomtrie, si arienne qu'elle semble ddaigner les figures, se rvle assez substantielle pour constituer une physique, c'est qu'elle ne se dtache jamais de l'imagination. L'tude des mathmatiques, crit Descartes la princesse lisabeth, exerce principalement l'imagination (III, p. 692), et un endroit des Regulae : Nous ne ferons plus rien dsormais sans le secours de l'imagination. ( X p. 443.) C'est dans l'imagination, y ditil encore (p. 416), qu'il faut former l'ide de tout ce qui peut se rapporter au corps. Se servant de l'imagination, l'esprit gomtre ne manie pas des ides vides. Il saisit quelque chose. Aussi Descartes repousset-il, au nom de l'imagination, les propositions telles que : l'extension ou la figure n'est pas un corps ; le nombre n'est pas la chose nombre ; la surface est la limite du volume, la ligne la limite de la surface, le point la limite de la ligne ; l'unit n'est pas une quantit, etc., toutes
Simone Weil, Sur la science (1966) 30
propositions qui, dit-il, doivent tre absolument cartes de l'imagination quand elles seraient vraies. (X, p. 445.) Il veut que, s'il est question de nombre, nous imaginions un objet mesurable au moyen de plusieurs units, que le point des gomtres, quand ils en composent la ligne, ne soit qu'une tendue, abstraction faite de toute autre dtermination. Car Descartes ne se contente pas d'avertir, et en termes vigoureux, ces savants qui usent de distinctions si subtiles qu'ils dissipent la lumire naturelle, et trouvent de l'obscurit mme dans ce que les paysans n'ignorent jamais ; il ne se contente pas de les prvenir que pour son compte il ne reconnat pas d'tendue spare d'une substance tendue, ou aucun de ces tres philosophiques quae revera sub imaginationem non cadunt 19 (X, p. 442). Il retrouve son ide dans la gomtrie classique mme, ainsi convaincue de contradictions : quis Geometra repugnantibus principiis objecti sui evidentiam non confundit, dum lineas carere latitudine judicat, et superficies profunditate, quas /amen easdem postea unas ex allis componit, non advertens lineam, ex cujus fluxu superficiem, fieri concipit, esse verum corpus ; illam autem, quae latitudine caret, non esse nisi corporis Modum 20 . (X, p. 446.) Ainsi la science cartsienne est bien autrement charge de matire qu'on ne croit d'ordinaire. Elle ne ddaigne pas les figures, puisque Descartes dit expressment que par elles seules rerum omnium ideae fingi possunt 21 . (X, p. 450.) Elle est si lie l'imagination, si jointe au corps humain, si proche des plus communs travaux, que c'est par l'tude des mtiers les plus faciles et les plus simples qu'il convient de s'y initier ; surtout de ceux o il rgne le plus d'ordre, comme celui des tisserands, des brodeuses ou des dentellires. Quant la partie proprement physique de la science cartsienne, on sait assez, par les innombrables exemples qu'on peut en trouver dans le Monde, les Principes, les Mtores, qu'elle s'aide des comparaisons les plus famili19 ... qui ne tombent pas en ralit sous l'imagination. 20 Quel est le Gomtre qui ne mle l'vidence de son objet des principes
contradictoires, quand il juge que les lignes n'ont pas de largeur, ni les surfaces de profondeur, et que cependant il les compose ensuite les unes avec les autres, sans remarquer que la ligne, dont il conoit que le mouvement engendre une surface, est un vritable corps, et qu'au contraire celle qui n'a pas de largeur n'est qu'un mode du corps, etc. ? 21 ... les ides de toutes les choses peuvent tre forges.
Simone Weil, Sur la science (1966) 31
res, tires parfois de la nature la plus proche de nous, comme les tourbillons des rivires, mais surtout des mtiers et des outils, de la fronde, du raisin qu'on presse. On pourrait croire que ces comparaisons se sont que des moyens de vulgarisation ; elles sont au contraire la substance mme de la physique cartsienne, comme Descartes a soin de l'expliquer Morin : Et j'ai d me servir de ces boules sensibles, pour expliquer leur tournoiement, plutt que des parties de la matire subtile qui sont insensibles, afin de soumettre mes raisons l'examen des sens, ainsi que je tche toujours de le faire (Il, p. 366), et, plus significativement encore : Il est vrai. que les comparaisons dont on a coutume d'user dans l'cole, expliquant les choses intellectuelles par les corporelles, les substances par les accidents, ou du moins une qualit par une autre d'une autre espce, n'instruisent que fort peu ; mais pour ce qu'en celles dont je me sers, je ne compare que des mouvements d'autres mouvements, ou des figures d'autres figures, etc., c'est--dire, que des choses qui cause de leur petitesse ne peuvent tomber sous nos sens d'autres qui y tombent, et qui d'ailleurs ne diffrent pas davantage d'elles qu'un grand cercle diffre d'un petit cercle, je prtends qu'elles sont le moyen le plus propre, pour expliquer la vrit des questions physiques, que l'esprit humain puisse avoir ; jusque-l que, lors qu'on assure quelque chose touchant la nature qui ne peut tre explique par aucune telle comparaison, je pense savoir par dmonstration qu'elle est fausse. (Il, p. 368.) La mme opposition se retrouve au sujet des ides simples, dont on peut croire que la doctrine est lie aux ides prcdentes, quoique Leibniz l'ait bien diffremment dveloppe. Toujours est-il que les ides simples sont bien loin en Descartes de constituer le monde comme en Leibniz. Ces ides simples, qui se conoivent premirement et par elles-mmes, on ne les explique qu'en les obscurcissant, car, si on veut les expliquer, ou on explique autre chose sous leur nom, ou l'explication n'a aucun sens. Tout cela, il est vrai, Descartes le dit. Il ajoute mme que ces natures simples ne contiennent jamais rien de faux . (Regulae, X, p. 420.) Mais loin de constituer le monde par leur enchevtrement, elles n'appartiennent mme pas au monde considr en soi ; elles ont rapport notre esprit ; ainsi souvent quaedam... sub una quidem consideratione magis absoluta sunt quam alia,
Simone Weil, Sur la science (1966) 32
sed aliter spectata sunt magis respectiva 22 (X, p.382) ; et Descartes ajoute : intelligatur nos hic rerum cognoscendaruln series, non uniuscujusque naturam spectare 23 . Aussi l'ensemble des ides claires est-il bien loin de constituer un entendement divin ; au contraire, suivant une doctrine qui a toujours sembl obscure, mais laquelle Descartes attachait une grande importance, les vrits ternelles tirent leur tre du seul dcret de Dieu, tout comme les essences en Platon sont cres et nourries par le soleil du Bien. Car, crit Descartes Mersenne : En Dieu ce n'est qu'un de vouloir et de connatre (I, p.149) ; et quelques jours auparavant : C'est en effet parler de Dieu comme d'un Jupiter ou Saturne et l'assujettir au Styx et aux destines que de dire que ces Vrits sont indpendantes de lui. Ne craignez point, je vous prie, d'assurer et de publier partout que c'est Dieu qui a tabli ces lois en la nature, ainsi qu'un roi tablit des lois en son royaume. Loin que le fait soit idalis jusqu' n'tre constitu que d'ides, ce sont les ides qui semblent ici comme ramenes jusqu'au fait, et d'autant plus nettement que Descartes continue : Elles sont toutes mentibus nostris ingenitae 24 , ainsi qu'un roi imprimerait ses lois dans le cur de tous ses sujets, s'il en avait aussi bien le pouvoir. (1, p. 145.) Ainsi, que deux quantits gales une troisime soient gales entre elles, ce ne serait pas une loi de l'esprit, mais une loi du monde. Ici encore il apparat que la gomtrie est une physique ; et il apparat comme une ide lie celle-l, encore qu'on comprenne difficilement comment, qu'il n'y a point d'entendement infini, puisque Dieu n'est que volont, et que l'entendement est donc limit par sa nature mme. Enfin, non seulement Descartes regarde tout esprit, ds qu'il s'applique penser comme il faut, comme gal au plus grand gnie, mais encore dans la pense la plus commune il retrouve l'esprit humain. Il y a, ses yeux, une sagesse commune bien plus proche de cette philosophie vritable qui est l'esprit ce que les yeux sont au corps que ne sont les penses produites par l'tude... cum saepissime videamus illos, qui litteris operam nunquam navarunt, longe solidius et clarius de
22 Certaines choses, en effet, un certain point de vue, sont plus absolues que
d'autres ; mais, considres autrement, elles sont plus relatives.
23 ... pour mieux faire comprendre que nous considrons ici les sries des cho-
ses connatre et non la nature de chacune d'elles...
24 ... innes en nos esprits.
Simone Weil, Sur la science (1966) 33
obviis rebus judicare, quam qui perpetuo in scholis sunt versati 25 . (X. p. 371.) Aussi son grand prcepte, pour parvenir la sagesse, est-il de ne point trop tudier. La perception elle-mme, qui a t considre par tant de philosophes, commencer par Spinoza, comme la connaissance la plus basse, est de mme nature que la science, comme on voit par le clbre passage du morceau de cire. Quel est ce morceau de cire qui ne peut tre compris que par l'entendement ou l'esprit ? Certes c'est le mme que je vois, que je touche, que j'imagine... Ma perception n'est point une vision, ou un attouchement, ni une imagination, et ne l'a jamais t, quoiqu'il le semblt ainsi auparavant, mais seulement une inspection de l'esprit... et ainsi je comprends, par la seule puissance de juger qui rside en mon esprit, ce que je croyais voir de mes yeux. Ce qu'il explique dans la Dioptrique par la comparaison de l'aveugle qui peroit, non pas les sensations que cause la pression du bton sur sa main, mais directement les objets au bout du bton. Ce qui donne Descartes de faire une thorie des sensations comme signes, par l'exemple des dessins, o nous voyons, non des traits sur du papier, mais des hommes et des villes (VI, p. 113). Et ce qui est remarquable, c'est qu'il use presque des mmes termes dont il usera, dans les Rponses aux Cinquimes Objections, pour expliquer que les lignes traces sur le papier, loin de nous donner l'ide du triangle, ne sont que les signes du vrai triangle (VII, 382). Aussi Descartes trouvet-il dans la perception une gomtrie naturelle et une action de la pense qui, n'tant qu'une imagination toute simple, ne laisse point d'envelopper en soi un raisonnement semblable celui que font les arpenteurs, lorsque, par le moyen de deux diffrentes stations, ils mesurent les lieux inaccessibles . (Dioptrique, VI, p. 138.) Ainsi ce Descartes qui de loin semblait prsenter un systme cohrent et convenable au fondateur de la science moderne, nous n'y trouvons plus, en y regardant de plus prs, que contradictions. Et, ce qui est plus grave, ces contradictions semblent procder toutes d'une contradiction initiale. Car on ne voit pas, pour ce fondateur de la science moderne, quel intrt pouvait prsenter la science, lui qui
25 ... puisqu'on voit bien souvent que ceux qui n'ont jamais donn leur soin
l'tude des lettres, jugent beaucoup plus solidement et clairement sur ce qui se prsente eux, que ceux qui ont toujours frquent les coles .
Simone Weil, Sur la science (1966) 34
avait pris pour devise la maxime du temple de Delphes ainsi mise en vers par Snque : Illi mors gravis incubat Qui notus nimis omnibus Ignotus moritur sibi 26 Comment celui qui avait ainsi adopt la devise socratique du Connais-toi a-t-il pu consacrer sa vie ces recherches de physique que Socrate raillait ? A ce sujet le texte par lequel Descartes affirme qu'il a employ principalement la raison dont Dieu lui a donn l'usage le connatre et se connatre soi-mme, ajoutant qu'il n'et su trouver les fondements de sa Physique s'il ne les et cherchs par cette voie (1, p. 144), ne fait que redoubler l'obscurit. Au reste quoi d'tonnant ce que nous ne trouvions en Descartes qu'obscurits, difficults, contradictions ? Il a averti lui-mme ses lecteurs qu'ils n'y trouveraient pas autre chose s'ils ne faisaient que chercher savoir son opinion sur tel ou tel sujet, le considrant du dehors et par fragments. La pense cartsienne n'est pas telle qu'on puisse la commenter du dehors ; tout commentateur doit se faire au moins pour un moment cartsien. Mais comment tre cartsien ? tre cartsien, c'est douter de tout, puis tout examiner par ordre, sans croire rien qu'en sa propre pense, dans la mesure o elle est claire et distincte, et sans accorder le plus petit crdit l'autorit de qui que ce soit, et non pas mme de Descartes. Ne nous faisons donc aucun scrupule d'imiter, en commentant Descartes, la ruse cartsienne. Comme Descartes, pour former des ides justes au sujet du monde o nous vivons, a imagin un autre monde, qui commencerait par une sorte de chaos, et o tout se rglerait par figure et mouvement, de mme imaginons un autre Descartes, un Descartes ressuscit. Ce nouveau Descartes n'aurait du premier ni le gnie, ni les connaissances mathmatiques et physiques, ni la force du style ; il n'aurait en commun avec lui que d'tre un tre humain, et d'avoir rsolu de ne croire qu'en soi. Selon la doctrine cartsienne, ce26 La mort le frappe durement,
Celui qui, trop connu de tous, Meurt sans s'tre connu lui-mme.
Simone Weil, Sur la science (1966) 35
la suffit. Si Descartes ne s'est pas tromp, une rflexion semblable partir du doute absolu doit, pourvu qu'elle soit librement conduite, concider au fond, en dpit de toutes les diffrences et mme de toutes les oppositions apparentes, avec la doctrine cartsienne. coutons donc ce penseur fictif.
Deuxime partie
Retour la table des matires
Nous sommes des vivants ; notre pense s'accompagne de plaisir ou de peine. Je suis au monde ; c'est--dire que je me sens dpendre de quelque chose d'tranger que je sens en retour dpendre plus ou moins de moi. Selon que je sens cette chose trangre me soumettre ou m'tre soumise, je sens plaisir ou peine. Tout ce que je nomme des objets, le ciel, les nuages, le vent, les pierres, le soleil, sont avant tout pour moi des plaisirs, en tant qu'ils me manifestent ma propre existence ; des peines, en tant que mon existence trouve en eux sa limite. Aussi plaisir et peine ne sont-ils pas sans mlange l'un de l'autre, ainsi qu'il apparat dans les potes ; mon plaisir ne peut tre tel qu'il ne soit corrompu par le dsir d'un plaisir plus grand : medio de fonte leporum Surgit amari aliquid quod in ipsis floribus angat 27
Inversement la douleur n'est jamais gote sans quelque volupt ; car respirer, courir, voir, entendre, mme me blesser, c'est avant tout goter ce plaisir qui est comme la saveur de ma propre existence. La prsence du monde est avant tout pour moi ce sentiment ambigu ; ce que le nageur appelle l'eau, c'est avant tout pour lui un sentiment compos de la volupt que donne la nage, de la peine qu'amne la fatigue. Selon qu'en nageant il dsire la nage ou l'arrt de cette nage, l'eau est plutt volupt ou plutt peine ; plutt amie ou plutt enne27 De la source mme des plaisirs nat quelque chose d'amer qui nous angoisse
jusque parmi les fleurs. (Lucrce De rerum natura, IV, 1133-1134.)
Simone Weil, Sur la science (1966) 36
mie ; mais, par l'ambigut du sentiment, toujours perfide. Et, comme en un mlange de bruits confus je lis soudain des paroles prononces par une voix connue, en un linge froiss que j'aperois au rveil de bizarres figures d'animaux ou d'hommes ; ainsi apparaissent, en ce sentiment indfinissable, au nageur l'eau sous son corps et devant ses bras, au coureur le sol sous ses pieds, l'air devant ses genoux, sur son visage, dans sa poitrine. Dans mes rves, en passant la joie ou la tristesse, je fais apparatre les paysages soit lumineux soit ternes ; quand je marche ou cours, ma puissance m'apparat sous l'espce d'un air pur et vif, d'un sol comme lastique, ou ma lassitude se fait connatre moi en un air lourd, un sol glissant. Ce sentiment nuanc de plaisir et de peine, qui est la seule chose que je puisse prouver, est donc l'toffe du monde ; c'est tout ce que j'en puis dire. Si ce sentiment ambigu qui rend l'eau prsente au nageur est jug par lui tre l'effet, ou la trace, ou l'image d'une fracheur, d'une transparence, d'une rsistance qui ne seraient pas comme constitues par ce sentiment mme, il dit plus qu'il ne sait. Je ne puis donc rien dire du monde. je ne puis dire : cette pine me fait mal au doigt, ni mme : j'ai mal au doigt, ni mme : j'ai mal. Ds que je donne un nom ce que je ressens, je dis, comme l'avait vu Protagoras, plus que je ne puis savoir. Ces choses qui me sont si intimement prsentes ne le sont que par la prsence de ce sentiment insparable de mon existence mme, et qui par leur intermdiaire seulement m'est rvl. Mais j'irais trop vite si j'en concluais que hors de ce sentiment mme je ne puisse rien affirmer ; il semble que les vrits abstraites, indpendantes de ce sentiment, ne sont pas entames par mon incertitude concernant les choses. Les propositions arithmtiques sont vides de plaisir et de peine ; elles se laissent aisment oublier ; mais, pour peu que je les examine, les interdictions dont elles sont charges sont pour moi irrsistibles. Ma soif, qui m'est sensible en ce moment par l'intermdiaire d'oranges qui sont devant moi, ne peut, mme si je rve, m'apparatre en deux couples d'oranges qui, ensemble, soient cinq oranges. Mon existence se manifeste moi par l'intermdiaire d'apparences, mais elle ne peut m'apparatre que de certaines manires ; il y a des manires d'apparatre qui ne dfinissent pour moi aucune apparence. Pourquoi, si l'on veut me montrer un carr qui soit, la fois quant la surface et quant au ct, le double d'un autre carr ne me drangerai-je pas ? C'est que si, en dessinant, je double le ct d'un carr, je ne sais comment em-
Simone Weil, Sur la science (1966) 37
pcher que ne m'apparaisse un carr quadruple. Un carr double d'un autre quant la surface et quant au ct serait un carr que je ne pourrais pas reproduire, ni esquisser, ni dfinir ; non pas carr, forme indchiffrable ; non pas mme forme. Ce n'est pas que le monde me soit transparent ; les apparences me sont impntrables en tant qu'en elles m'est prsent ce sentiment qui en fait comme l'paisseur, la saveur amre et douce de ma propre existence. Car cette saveur est mienne, mais n'est pas par moi ; si rien en moi n'tait tranger moi, ma pense serait pure de plaisir et de peine. Mais, dans la mesure o cette chose impntrable est pour moi distincte et dfinie, dans la mesure o elle m'apparat, elle est comme moule en creux sur moi. Que, rvant moiti, je me sente baigner dans l'eau plus molle que le sommeil comme dit le pote, puis que, m'veillant, je me sente dans mon lit, l'eau et le lit ne sont que des formes dfinies pour moi de ce moelleux indfinissable qui me les rend prsentes. Pourquoi deux couples d'oranges formant quatre oranges sont-elles quelque chose de saisissable pour moi, et non deux couples d'oranges formant cinq oranges ? Je suis ainsi. Pourquoi je suis ainsi, c'est ce que je ne vois aucun moyen d'apprendre, puisque je reconnais que mes penses ne peuvent me renseigner sur rien, sinon sur moi-mme. Aucun progrs de mes penses ne peut m'instruire. Non pas que le progrs me soit dfendu. Certaines proprits d'une figure ou d'une combinaison de quantits ne peuvent m'apparatre sans des formes ou des quantits auxiliaires ; c'est par le moyen seulement des parallles accompagnes de leurs proprits que la somme des trois angles d'un triangle, semblable au gnie que seule la lampe merveilleuse faisait apparatre Aladin, peut tre prsente mon esprit. Qu' moins de trois droites on ne puisse enfermer un espace, c'est ce qui, au contraire, n'a besoin pour m'apparatre que des formes correspondantes. Pourquoi ? C'est un hasard. Ce que j'appelle le monde des ides n'est pas moins que le monde des sensations un chaos ; les ides m'imposent leurs manires d'tre, me tiennent, m'chappent. Si d'ailleurs, au lieu de me servir des formes pour en voquer les proprits, je les interroge par exemple au moyen de la mesure, rien ne m'assure qu'elles me rpondront par ces mmes proprits ; aussi l'illustre gomtre Gauss n'a-t-il pas jug inutile de mesurer la somme des trois angles d'un triangle. Si la gomtrie, la mesure, l'action s'accordent, c'est hasard. Tout est livr ce malin gnie de Descartes qui n'est autre chose que le hasard. Hasard, non point ncessit. Autrement dit, rien de ce qui passe dans ma conscience n'a
Simone Weil, Sur la science (1966) 38
d'autre ralit que la conscience que j'en ai ; il n'y a d'autre connaissance pour moi que d'avoir conscience de ce dont j'ai conscience. Connatre un rve, c'est le rver ; connatre une souffrance, c'est la souffrir ; connatre un plaisir, c'est en jouir. Tout est sur le mme plan. Il ne me sert en rien de passer de ce qu'on nomme le sensible ce qu'on nomme l'intelligible ; je connais une proprit du triangle quand, la suite des constructions convenables, elle me saute aux yeux ou pour mieux dire l'imagination. Si les ides mathmatiques me donnent un sentiment de clart et d'vidence que n'apportent pas les sensations, il ne s'ensuit pas que ce sentiment soit quelque chose indpendamment de la conscience que j'en ai. Aucune pense, aucune action n'a pour moi plus de valeur qu'une autre. Tout est indiffrent tant que le hasard me tient. Non pas que peut-tre une chelle de valeurs, que j'ignore, ne puisse s'appliquer mes penses ; cela mme est hasard. Le hasard est vtu, dguis de bleu, de gris, de lumire, de dur et de mou, de froid et de chaud, de droit et de courbe, de triangles, de cercles, de nombres ; le hasard, c'est--dire n'importe quoi. je n'ai jamais conscience de rien, sinon des vtements du hasard ; et cette pense mme, en tant que j'en ai conscience, est hasard. Il n'y a rien de plus. N'y a-t-il rien de plus ? Non, si rien pour moi ne se rvle exister qu'autant que j'en ai conscience. Moi-mme, en tant que j'ai conscience de moi, je suis n'importe quoi ; ce que ma conscience me rvle, ce n'est pas moi, mais la conscience que j'ai de moi, tout comme elle ne me rvle pas les choses, mais la conscience que j'ai des choses. Ce dont j'ai conscience, je ne sais jamais ce que c'est ; je sais que j'en ai conscience. Voil donc une chose que je sais : j'ai conscience, je pense. Et comment est-ce que je le sais ? Ce n'est pas une ide, un sentiment parmi les ides et les sentiments qui apparaissent ma pense. J'prouve que le ciel est bleu, que je suis triste, que je jouis, que je me meus ; je l'prouve, je n'en sais rien. Ce que je pense, je le pense ; il n'y a rien d'autre connatre. Rien ? Si. Et quoi donc ? Tout ce que j'prouve est illusion, car tout ce qui se prsente moi sans que j'en reoive l'atteinte de l'existence relle se joue de moi. Et non seulement plaisir, souffrance, sensation, mais par suite aussi cet tre que je nomme moi, qui jouit, souffre et sent. Tout cela est illusion. Qu'est-ce dire ? Que tout cela semble illusoire ? Non ; c'est--dire, au contraire, que tout cela fait illusion, par suite semble certain. C'est
Simone Weil, Sur la science (1966) 39
peine si je puis admettre que cette table, ce papier, cette plume, ce bien-tre et moi-mme ne sont que des choses que je pense ; des choses que je pense et qui font semblant d'exister. je les pense ; elles ont besoin de moi pour tre penses. En quoi donc ? Car je ne pense pas ce que je veux. Elles me font illusion de mme par leur puissance propre. Qu'est-ce donc qu'elles empruntent de moi ? La croyance. Ces choses qui font illusion, c'est moi qui les pense, ou comme sres, ou comme illusoires, le prestige qu'elles exercent sur moi restant d'ailleurs intact. La puissance que j'exerce sur ma propre croyance n'est pas une illusion ; c'est par cette puissance que je sais que je pense. Ce que je prends pour ma pense, ne serait-ce pas la pense d'un Malin Gnie ? Cela peut tre quant aux choses que je pense, mais non pas pour ceci, que je les pense. Et par cette puissance de pense, qui ne se rvle encore moi que par la puissance de douter, je sais que je suis. je puis, donc je suis. Et en cet clair de pense se rvlent moi plusieurs choses dont je ne savais auparavant ce qu'elles taient, savoir le doute, la pense, la puissance, l'existence et la connaissance ellemme. Au reste cela n'est pas un raisonnement ; je puis me refuser cette connaissance. Ou plutt je puis la ngliger ; je ne puis la refuser. Car ds que je repousse une pense quelconque comme illusoire, par l mme je pense quelque chose que je ne puise pas dans la chose qui se prsente ma pense ; car dans mes penses illusoires je ne puis puiser que l'illusion, c'est--dire la croyance qu'elles sont sres. En tant que j'accueille une ide, je ne sais si je l'accueille ou si seulement elle se prsente ; ds que je repousse une ide, quand ce serait l'ide mme que je suis, aussitt je suis. Ma propre existence que je ressens est une illusion ; ma propre existence que je connais, je ne la ressens pas, je la fais. Exister, penser, connatre, ne sont que des aspects d'une seule ralit : pouvoir. je connais ce que je fais, et ce que je fais, c'est penser et c'est exister ; car du moment que je fais, je fais que j'existe. je suis une chose qui pense. Dira-t-on que, sans le savoir, Je suis, je fais peut-tre autre chose encore, en dehors de la pense ? Qu'est-ce dire ? Que serait une puissance que je n'exerce pas ? Certes un dieu inconnu peut se servir de moi, sans que je le sache, en vue d'effets que j'ignore ; mais ces effets, je ne les produis pas. Et quant connatre mon tre propre, ce que je suis se dfinit par ce que je puis. Il est donc une chose que je puis connatre, c'est moi ; et je ne peux en connatre aucune autre. Connatre, c'est connatre ce que je puis ; et je connais dans la mesure o, jouir, souffrir, ressentir, imaginer, je substi-
Simone Weil, Sur la science (1966) 40
tue, transformant ainsi l'illusion en certitude et le hasard en ncessit, faire et subir. Faire et subir, cette opposition est prmature ; car je ne me connais qu'une puissance, celle de douter, puissance dont l'exercice ne saurait tre empch par rien. Ce n'est pas que, parmi tous les objets, toutes les ides dont j'ai dcid de douter, la plupart ne m'aient sembl laisser une certaine prise ma puissance, ou pour mieux dire tous. En ce moment mme, c'est moi qui meus ma plume sur le papier. Tout ce que je vois, je le fais disparatre, reparatre, se mouvoir, en fermant, en rouvrant les yeux, en tournant la tte. Je puis transporter la plupart des objets que je touche, marcher, bondir, courir. Mais ces yeux, ce corps, ces objets, sais-je s'ils existent ? Un pouvoir exerc sur des illusions ne peut tre qu'illusoire. La croyance que m'inspirent ces illusions est chose relle, aussi le pouvoir que j'exerce sur elle est-il rel ; je n'existe encore que par le doute. Si plus tard j'arrive me reconnatre une autre puissance, elle m'appartiendra certes ; mais le pouvoir de douter seul me dfinit, car seul il est immdiatement reconnu. Cependant le pouvoir que j'ai sur ma croyance, ne l'ai-je pas sur certaines des choses que je pense ? Ne puis-je crer ou anantir quelques-unes au moins de mes propres penses ? Il m'arrive de forger moi-mme l'objet de ma pense, que j'appelle alors rverie ; j'ai alors, semble-t-il, une pleine domination sur moi-mme, je joue l'gard de moi-mme le rle du Malin Gnie. Mais non. Tout d'abord, jamais je ne me fais illusion, jamais, quand je le voudrais, je ne puis me donner, l'gard des choses rves, la croyance que m'inspirent en leur existence ce que j'appelle les choses relles. je reconnais ainsi que mon pouvoir sur ma propre croyance n'est que ngatif ; je puis douter, je ne puis croire. Puis ces rveries, qu'est-ce qui les produit ? Rien ne m'assure que c'est moi. Si j'en ai le sentiment, c'est que, mme pnibles, elles ne se prsentent moi qu'autant que je les accueille ; mais, de la suite bizarre qu'elles forment, je puis toujours dire la parole inspire Figaro par les vnements de sa vie : Pourquoi ces choses et non pas d'autres ? Je puis les repousser, mais si je les cre, c'est par un pouvoir qui, bien diffrent du pouvoir de douter, me laisse dans l'incertitude au sujet de sa propre existence. Peut-tre les choses que je rve me sontelles aussi extrieures que les choses que je crois entendre, voir, toucher. Peut-tre aussi ce que j'appelle par excellence les choses m'appartiennent-elles aussi bien que les rveries. Quoique ce soit trange
Simone Weil, Sur la science (1966) 41
dire, cette supposition, si elle tait vraie, rendrait la puissance que je crois avoir sur les choses illusoire ; sensations imprvues ou voulues, course ou chute, tout serait mien au mme titre. Il est vrai que les vnements me surprennent, mme quand ils sont dsirs ; toujours il y a en ce que je perois, mme agrable, quelque chose que je n'ai point dsir, qui me saisit, s'impose moi comme une chose trangre. C'est ce qui me fait croire presque invinciblement que, si mes rveries n'existent que pour moi, au contraire ce papier, cette table, le ciel, la terre, Paris existent indpendamment de moi. Mais ce n'est pas une preuve. je n'ai jamais cru que ma colre ait une existence indpendante de moi, et pourtant est-ce que je ne me mets pas en colre subitement, et souvent quand je dsire en mme temps rester calme ? Ai-je une raison de penser que le bleu du ciel, les nuages blancs ou gris, le contact du papier sur ma main, la chaleur du soleil, sont plus spars de moi que ma colre, mon inquitude ou ma joie ? Et comme la colre succde un calme que je peux croire avoir conquis, de mme la lumire et aux couleurs succde une obscurit que je crois produire, en mme temps que le contact de mes paupires, en fermant les yeux. Mais je reconnais facilement que mon irritation est mienne au mme titre que l'apaisement qui la suit, ma peur au mme titre que ma hardiesse, ma tristesse au mme titre que ma joie. De mme les tnbres que j'ai cru produire, le sentiment des paupires qui se touchent, ne se rapportent pas moi autrement que tout l'heure la lumire et les yeux ouverts. Certes, si la lumire me fatigue, les tnbres rpondent immdiatement mon dsir ; et de mme, des jambes, mme malades, s'agitent immdiatement au moindre dsir de courir ; mais autre est la course que je dsire, autre la course que je sens. Ces tnbres non plus, je ne les ai pas dsires parsemes de taches, accompagnes du contact des paupires. En un mot, autre chose est dsirer sentir, autre chose est sentir. Au contraire, au sujet de toutes ces choses, vouloir me retenir de juger tmrairement, c'est me retenir de juger tmrairement. Autant qu'il s'agit seulement, non des choses que je pense, mais de ma pense, le vouloir est par lui-mme efficace, et il n'a pas un autre effet que le vouloir mme. Vouloir et agir ici ne font qu'un. Aussi, si joie et tristesse, tnbres et lumire, m'appartiennent au mme titre, ma pense de ces choses est bien autrement moi, elle est moi. Ce qui fait que je suis, ce n'est pas que je me meus, c'est que je le pense. Quant ce que j'appelle la puissance de me mouvoir, elle n'est qu'une relation entre mes dsirs et les sensations qui me semblent r-
Simone Weil, Sur la science (1966) 42
pondre mes dsirs tant bien que mal ; ainsi, au dsir d'un fruit peut rpondre le fruit dans ma bouche ou seulement mon bras tendu. Mais, quand chaque dsir rpondrait une jouissance, je n'exerce en dsirant aucun pouvoir. Aussi le dsir des tnbres qui, devant une lumire aveuglante, ferme mes yeux, n'est-il pas plus moi que cette douleur aux yeux. Ni trangers ni miens, les dsirs, les passions, les sensations, les rveries ne peuvent tmoigner d'aucune existence, non pas mme, sinon en tarit que je les pense, de la mienne propre. Rien n'empche d'en dire autant au sujet des calculs, des raisonnements, des ides. Ces penses ne se prsentent moi ni comme les rveries, ni comme les dsirs, ni comme les choses perues ; je ne les trouve que si je les cherche, mais alors sans pouvoir les changer, comme un trsor incorruptible qui serait cach en moi. Il n'en est pas moins vrai qu'elles ne m'apprennent rien, sinon que, moi qui les pense, je suis. Ainsi, comme il en est de la connaissance que je suis, il en est de toute connaissance. Je dois renoncer apprendre en interrogeant mes penses. Des choses que je pense ne peuvent auprs de moi tmoigner de rien. Moi qui pense, je suis l'unique tmoin. Unique tmoin de mon existence propre, mais aussi, si je puis jamais connatre autre chose que moi, unique tmoin de l'autre existence. Tmoin suffisant. Il m'a suffi d'carter la supposition d'une existence quelconque pour connatre aussitt que j'existe ; j'carte prsent la supposition de toute autre existence. je pose qu'il n'y a que moi qui existe. Mais qui suis-je ? Une chose qui exerce ce pouvoir que je nomme pense. Sinon par ce pouvoir librement, autrement dit rellement exerc, l'tre que je nomme moi n'est rien. Pour me connatre, il me reste donc savoir jusqu'o ce pouvoir s'tend ; mais qu'est-ce dire ? Ce pouvoir ne comporte pas de degrs plus que l'existence mme, que j'ai reconnue tre identique avec lui. je puis, comme j'existe, absolument. Un pouvoir comme celui que j'attribue un roi, qui est un rapport entre une chose et une autre, par exemple entre ses paroles et les mouvements de ses sujets, peut tre mesur ; mais mon pouvoir n'est pas cette ombre de pouvoir, il rside tout entier en moi-mme, tant cette proprit de moi, qui est moi, par laquelle dcider, pour moi, c'est agir. Tout pouvoir rel est infini. S'il n'existe que moi, il n'existe que cette puissance absolue ; je ne dpends que de mon vouloir, je n'existe qu'autant que je me cre, je suis Dieu. je suis Dieu, car cette mme domination souveraine que j'exerais sur moi ngativement quand je m'interdisais de juger, je dois en ce cas l'exercer positivement, concernant la matire de mon juge-
Simone Weil, Sur la science (1966) 43
ment ; c'est--dire que rves, dsirs, motions, sensations, raisonnements, ides ou calculs ne doivent tre que mes vouloirs. Ai-je jamais attribu Dieu une puissance plus grande ? Or il n'en est rien. je ne suis pas Dieu. Ce pouvoir qui est mien, infini par sa nature, je dois lui reconnatre des bornes ; ma souverainet sur moi, absolue tant que je ne veux que suspendre ma pense, disparat ds qu'il s'agit de me donner une chose penser. La libert est la seule puissance qui soit mienne absolument. Il existe donc autre chose que moi. Si nul pouvoir n'est limit par lui-mme, il me suffit de connatre que ma puissance n'est pas toute-puissance pour connatre que l'existence de moi n'est pas l'unique existence. Quelle est l'autre existence ? Elle se dfinit par cette empreinte en creux sur moi, qui me prive de la domination en me laissant la libert. Libert conqurir. Il serait absurde de supposer d'un ct ma libert intacte, et de l'autre les choses que je pense semblables, selon une parole clbre, des tableaux muets ; du moment que mes penses sont autre chose que mes vouloirs, elles m'engagent. Ma croyance est engage en effet, je ne m'en aperois que trop la difficult de douter ; mais plus simplement les choses que je pense m'engagent, moi, c'est--dire ma volont. Tout ce qui apparat d'une manire ou de l'autre mon imagination, rves, objets ou formes, m'est rendu prsent, je j'ai reconnu, par un sentiment ml de plaisir et de peine, c'est--dire par ceci, que je l'accueille et le repousse la fois. C'est par cette rpulsion et cet accueil, qui me semblent constituer l'imagination, que mes penses m'engagent ; je ne suis libre qu'autant que je peux me dgager. Autrement dit, autant l'autre existence, par l'intermdiaire de mes penses, peut sur moi, autant moi, par le mme intermdiaire, je peux sur elle. Aussi ces penses dont je ne puis crer une seule sont-elles toutes, depuis les rves, les dsirs, les passions jusqu'aux raisonnements, autant qu'elles dpendent de moi, signes de moi, autant qu'elles n'en dpendent pas, signes de l'autre existence. Connatre, c'est lire en une pense quelconque cette double signification, c'est faire apparatre en une pense l'obstacle, en reconnaissant dans cette pense ma propre puissance ; non pas un fantme de puissance comme ce pouvoir surnaturel que je crois parfois possder dans mes rves, mais cette mme puissance qui me fait tre, que je connais mienne depuis que je sais que, du moment que je pense, je suis. Je peux aussi bien dire que sont vraies toutes les penses que je nomme claires et distinctes, c'est--dire toutes les penses dont le je pense, donc je suis est le modle. Autant que j'affirme de telles penses, je
Simone Weil, Sur la science (1966) 44
suis infaillible ; cette infaillibilit, c'est Dieu qui me la garantit. Toutes mes autres penses n'taient que des ombres ; l'ide de Dieu seule a pu porter tmoignage d'une existence. Aussi l'ide de Dieu seule tait-elle l'ide d'une puissance vritable, par suite relle ; la puissance vritable ne saurait tre imaginaire. Si la toute-puissance pouvait tre une fiction de mon esprit, je pourrais tre moi-mme une fiction, car je n'existe qu'autant : que je participe la toute-puissance. Ainsi Dieu mme me garantit que, ds que je pense comme il faut, je pense la vrit. Je n'ai pas lieu de supposer que cette garantie est trompeuse, que cette autre existence dont je crois dpendre n'est qu'une illusion impose par Dieu. Il est vrai que si j'arrive me heurter la limite de mon pouvoir, je ne connatrai la rigueur pas autre chose, sinon de quelle manire Dieu m'empche d'tre Dieu ; mais il n'y a rien de plus savoir, cette connaissance tant la connaissance du monde. Voici qu'il est en mon pouvoir de connatre, et par le moyen que j'avais entrevu ; en ne lisant dans le sentiment de ma propre existence, dans le plaisir et la souffrance qui le colorent, dans les apparences et les illusions dont il se revt, que l'obstacle subi et vaincu. Connatre ainsi, c'est me connatre, c'est connatre sous quelle condition je dpends de moi ; seule connaissance qui m'importe, et d'ailleurs seule connaissance. Connaissance qu'il m'appartient d'acqurir, que je ne puis recevoir que de moi, et que je suffis me donner. L'autorit d'autrui peut me persuader, les raisons d'autrui me convaincre, l'exemple d'autrui me guider ; il n'y a que moi qui puisse m'instruire. Dieu mme ne m'apprend rien, il ne me donne qu'une garantie. je n'ai donc point d'aide, et n'ai comme matriaux que des rveries confuses, des ides trop claires, des sensations aussi obscures qu'imprieuses, toutes choses dont aucune, Je ne l'ai que trop prouv, ne constitue une connaissance. je ne commettrai plus la faute de vouloir les considrer en elles-mmes, elles que je n'ai jamais cru saisir sans m'apercevoir aussitt que je ne saisissais rien. Je ne veux plus que chercher ce que je puis sur moi. Peut-tre cette recherche est-elle sans fin ; d'autant qu'elle ne consiste pas m'apercevoir peu peu d'une puissance que j'exercerais mon insu, ide plausible nagure mes yeux, mais qui m'apparat prsent comme aussi absurde que l'incertitude au sujet de ma propre existence. Apprendre connatre ma puissance, ce n'est autre chose, je le sais maintenant, qu'apprendre l'exercer. Ainsi se rendre savant et se rendre matre de soi, ces deux entreprises qui me semblaient entirement distinctes, et dont la premire me paraissait d'ailleurs de beau-
Simone Weil, Sur la science (1966) 45
coup la moins importante, je reconnais qu'elles sont identiques. Il se peut donc que ce double apprentissage ne soit jamais termin, qu'il me reste toujours quelque puissance acqurir ; peut-tre aussi rencontrerai-je tout de suite la limite de mon pouvoir. Mais ce que je sais ds maintenant, c'est que connatre ne dpend que de moi ; je ne connatrai rien par hasard. Mais comment donc dois-je faire pour apprendre plus que je ne sais prsentement ? Car, jusqu' prsent, je n'esprais gure m'instruire autrement que par l'tude de ce que les autres avaient trouv avant moi ; je me considrais comme un livre vide, o seuls quelques axiomes taient crits, mais o chaque journe d'tude remplissait une page. L'ide ne me venait pas qu'on put recevoir une connaissance nouvelle, sinon du dehors, ou par l'enseignement, ou par rencontre. Aussi, quoique ne dsesprant pas d'apporter peut-tre un jour moi-mme quelque contribution nouvelle au trsor des connaissances acquises, ne formais-je aucun projet l'avance concernant la manire dont je m'y prendrais ; je comptais seulement rapprocher, comparer, combiner de toutes les manires qui me viendraient l'esprit les connaissances mises ma disposition par l'tude, puis, dans l'amas des vraisemblances, des problmes, des incertitudes nes de ce brassage, avoir assez de bonheur pour ramasser quelques ides vraies. Comment, en effet, aller autrement qu'au hasard la recherche de vrits non encore souponnes ? Je connaissais pourtant une mthode sre pour employer les connaissances que je possdais prouver la lgitimit d'une affirmation ; c'est ce qu'on nomme la logique. Mais je remarquais que cette mthode ne constituait qu'une simple analyse, absolument sre parce qu'absolument infructueuse ; elle pouvait me servir tirer de l'ensemble de mes connaissances la connaissance dont je pouvais avoir besoin mais je la reconnaissais impuissante me faire rien acqurir. Quant aux moyens de connatre quelque chose de nouveau, je n'en connaissais que deux ; le premier n'est autre que les hasards de l'exprience. Une grande partie de la science que l'tude m'avait procure tait constitue par les rponses que des hommes obstins interroger de toutes les manires les astres, les mers, les mouvements des corps, la lumire, la chaleur, toutes les transformations des corps inertes ou vivants avaient eu quelquefois le bonheur d'obtenir. Quant l'autre moyen d'apprendre, je le trouvais dans le pouvoir presque miraculeux des gomtres ; ils tracent un triangle, en rappellent quelques proprits, tracent, comme au hasard ou par inspiration d'autres lignes dont ils noncent aussi les proprits, et cela suf-
Simone Weil, Sur la science (1966) 46
fit pour que soit soudain voque, comme par une crmonie magique, une proprit du triangle inconnue jusque-l. Cette proprit, les preuves me contraignaient l'accepter, mais, rigoureusement parlant, je n'y comprenais rien ; si je pensais pouvoir peut-tre moi-mme , un jour, ajouter quelque chose l'ensemble des mathmatiques, je n'esprais pas pour cela arriver crer les preuves au lieu de les subir. je supposais seulement qu' la condition de combiner, en m'aidant d'une certaine habilet instinctive, figures, proprits et formules, la miraculeuse apparition d'une proprit nouvelle Se produirait parfois d'ellemme, le hasard me tenant lieu de manuel. Si l'on m'avait persuad alors que ni l'tude, ni l'exprience, ni les hasards de la mathmatique ne peuvent fournir autre chose que l'illusion de connatre, j'aurais renonc une fois pour toutes rien savoir. Mais est-il permis de me rsigner ainsi, maintenant que j'ai mis la connaissance en ma possession, en la dfinissant comme la connaissance de moi, de mon pouvoir sur moi, des conditions de ce pouvoir ? Je ne peux plus que par lchet renoncer me satisfaire au sujet de toutes choses. Ce n'est pas dire que j'aie l'ambition de rpondre toutes les questions qui pourront se poser moi ; connatre, par rapport un problme quelconque, j'ai cru autrefois que C'tait le rsoudre, je sais maintenant que c'est connatre de quelle manire il me concerne. Rpondre effectivement une question ou savoir quelle condition il est en mon pouvoir d'y rpondre, ou savoir qu'elle est pour moi insoluble, ce sont trois manires de connatre, et qui constituent, au mme titre, des connaissances. je ne tirerai que de moi cette science sans lacunes. Je ne chercherai pas de mthode non plus que de hasards, en vue de faire apparatre une vrit entirement nouvelle ; une telle vrit n'est qu'une chimre mon gard, et je ne puis avoir pour mthode que l'analyse. C'est--dire que ce que je connais prsentement, que je pense, que je suis, que je dpends de Dieu, que je subis un monde, cette connaissance que j'ai d dvelopper non sans prcautions, mais intuitive et qui ne fait qu'un avec l'acte de connatre, contient tout ce que j'ai connatre ; je dois trouver en elle de quoi me satisfaire n'importe quel sujet. S'ensuit-il que grce a elle je puisse rsoudre ou reconnatre insoluble toute question ? Je me demanderai, par exemple, ce qu'est ce papier sur lequel j'cris ? s'il est quelque chose autre que les impressions de couleur ou de contact que je crois en recevoir ? ou si la question est hors de ma porte. Or tout cela, je m'aperois que je l'ignore. Avant d'essayer de rsoudre cette contradiction, je veux examiner plus soigneusement ce
Simone Weil, Sur la science (1966) 47
que je sais ds prsent touchant ce qu'est le monde par rapport moi. Cette connaissance de moi que je me donne du fait seul que je pense, serait la connaissance totale si j'tais Dieu ; mais je reste impntrable moi-mme dans la mesure o je ne me cre pas par l'acte de penser, c'est--dire autant que je subis l'empreinte d'un monde. Ce monde se presse sur moi par tout le poids de l'aversion, du dsir, de la croyance, sans me laisser, je l'ai reconnu, d'autre pouvoir que le refus. Et que puis-je refuser ? En ce moment par exemple je jouis d'un air plus pur et plus frais, je dsire la campagne, la promenade et la brise printanire, je crois, par une imprieuse persuasion, en l'existence de ce ciel voil, de cette ville en rumeur, et, au milieu de tout cela, je ressens une inquitude vague, que je rapporte des tres absents ; sur cette jouissance, ce dsir, cette croyance, cette inquitude, si je veux m'en dlivrer ou les changer, ma volont a-t-elle prise ? Pas le moins du monde. Tout ce que je puis, c'est, ce que je crois, ce que je dsire, refuser mon assentiment. Je n'ai moi que mon jugement seul ; je n'ai pas sur mes penses un pouvoir royal, je n'en suis que l'arbitre. Est-ce dire que je ne possde qu'une impuissante libert de m'approuver ou de me dsapprouver moi-mme ? S'il en est ainsi, je ne puis esprer une autre vertu que celle qui permettait Mde, selon le pote, de voir le meilleur parti et de l'approuver, tout en suivant le pire, ni un autre savoir que la connaissance intuitive de mon existence et de ma dpendance par rapport une chose inconnue, et la conscience de mes passions. Mais ce fantme de libert ne pourrait mme tre nomm libert ; je ne me reconnais libre qu'autant que je dpends effectivement de moi. Et en vrit si, lorsque je me sens envahir par le dsir de vengeance, je ne suis libre que de ne pas consentir cette colre douce comme le miel, selon la parole du pote, l'exercice de cette libert n'est pourtant pas une chose indiffrente ; si petite qu'en soit la porte, ce pouvoir est efficace, ce refus est un acte. Je n'ai moi que mon jugement, mais mon jugement n'est pas sans changer quelque chose. Il ne peut modeler les dsirs, les croyances par lesquelles le monde me tient ; du moins donc mon jugement mord sur le monde mme. La peine presque insurmontable que me cote un jugement libre en tmoigne. Le monde pse sur mon libre arbitre de manire faire de moi, si je ne rsiste, le jouet des impulsions ; en retour l'exercice de mon libre jugement ne peut point laisser le monde intact. De sorte que, autant les choses en mes passions ont prise sur moi, autant en mme temps elles me laissent prise ; et ainsi le monde, sans dpen-
Simone Weil, Sur la science (1966) 48
dre de moi, n'est pas non plus une emprise inexplicable sur moi, mais bien, comme je l'avais entrevu, l'obstacle. L'obstacle, c'est--dire que l'acte de douter, par lequel je suis, et par lequel j'prouve le poids de l'autre existence en mme temps que j'exerce tout mon pouvoir de rsister, cet acte implique bien pour moi toute la connaissance, mais ne me donne pas de quoi rsoudre la moindre question concernant ce qui est hors de ma puissance. Je n'imaginais autrefois que deux manires de m'instruire, le triage des connaissances acquises, la rencontre inopine de connaissances trangres ma pense ; mais ce monde qui ne dpend en rien de moi et qu'en mme temps je puis changer, ce monde doit laisser le mme genre de prise la connaissance qu' l'action. Autant que je puis changer le monde, autant que par suite le connatre n'est qu'une manire de me connatre moi-mme, je connais par analyse ; autant que le monde ne dpend pas de moi, je ne possde pas de quoi me satisfaire au sujet des questions le concernant, telles que celle de savoir ce qu'est ce papier. Il ne me reste qu' inventer une analyse d'une espce inconnue aux logiciens, une analyse qui soit un principe de progrs. N'est-ce pas absurde ? Sur quoi peut se fonder un pareil progrs ? Il ne peut se fonder que sur le monde mme ; aussi bien cette ncessit de n'apprendre que peu peu est-elle mon gard comme le tmoin qu'il existe un monde. Ou, pour mieux dire, ce progrs doit se fonder sur la charte qui lie moi et le monde, savoir que, n'ayant moi que ma libert, je n'exerce qu'une puissance indirecte. Qu'est-ce que cette puissance ? Comment est-ce que sans avoir d'action sinon sur moi-mme, et seulement ngative, je mords en mme temps sur le monde ? C'est ce qu'il n'est pas facile de connatre, car cette prise que j'ai sur le mande, je ne puis ni la dduire, ni l'expliquer, ni la constater, mais seulement en user. Mais en user, en quoi est-ce que cela consiste ? Dois-je me rsoudre agir aveuglment ? Agir aveuglment, ce n'est pas agir, c'est ptir. Possder une puissance que je ne dirigerais pas, ce serait n'exercer aucune puissance. Il me faut donc un moyen de disposer de ma propre action. O chercher ce moyen ? Dans ma pense ; aussi bien n'y a-t-il rien, du moins mon gard, qui ne soit pense. Ou du moins, au sujet de ce qui n'est pas ma pense, ma pense seule m'instruit ; c'est ma pense qui a tmoign de ma propre existence, ma pense qui a tmoign de l'existence du monde. Ma pense doit tmoigner aussi de mon action sur le monde ; comme les impressions me servent d'intermdiaires pour subir le
Simone Weil, Sur la science (1966) 49
monde, une autre espce de pense doit me servir d'outil pour le changer. C'est par ces penses que sera dfini le passage que le monde me laisse. Que sont-elles ? Le je pense, donc je suis ne m'est ici d'aucune utilit ; je me trouve dans un nouveau royaume, devant une connaissance nouvelle. Connatre, jusqu'ici, n'a pas t autre chose pour moi que de rendre compte d'une pense. Quand j'ai dit : je pense, donc je suis , j'ai su que j'existais, je l'ai su aussitt, d'une manire parfaite, complte, et qui me satisfaisait au point que je ne conois pas autrement la pense divine ; car, par un mme acte, je pensais, j'existais, je connaissais, de sorte qu'en moi, comme en Dieu, connatre et vouloir ne faisaient qu'un. Mon existence, au moment o je l'ai conue, m'a rendu compte d'elle-mme de telle sorte que je ne puis mme penser qu'il y ait lieu d'en savoir plus ; car je suis parce que je pense, je pense parce que je le veux, et le vouloir est sa propre raison d'tre. La connaissance par laquelle je saisis autre chose que moi est bien autre ; il n'y est plus question de demander compte. La prise que m'offre le monde ne dpend pas de moi, et quelle qu'elle soit, il n'y a pour moi aucune raison qu'elle soit telle. Elle me donne, ou me donnera quand je la connatrai, minemment l'occasion de poser l'ternelle question de Figaro : Pourquoi ces choses et non pas d'autres ? et de me rpondre la seule rponse que cette question comporte : C'est ainsi. je dois accepter le rapport qui se trouve exister entre mon action et les choses, et je dois de mme accepter comme des connaissances les penses qui dterminent ce rapport ; tant connatre est loin dsormais de se confondre avec vouloir. Ainsi, ds lors qu'il s'agit du monde, il ne me sert de rien de m'interroger. Que dois-je donc interroger ? Le monde ? Mon action doit se guider sur lui, mais, quoique le monde tienne ma pense et ne la lche jamais, il lui serait malais de me guider ou de m'clairer, guider et clairer tant des faits de l'esprit. Puisque le monde ne peut m'enseigner, et que j'ai m'instruire, j'irai demander des oracles concernant les choses, non aux choses muettes, non moi ignorant, mais ce troisime tre, cet tre ambigu, compos de moi et du monde agissant l'un sur l'autre. Telle semble avoir t la pratique des Grecs, qui interrogeaient Delphes ce point de rencontre des choses et d'un esprit, en la personne d'une femme qu'ils pensaient vraisemblablement avoir rduite n'tre plus autre chose. Moi qui ne veux croire qu'en moi, je ne consulterai qu'en moi
Simone Weil, Sur la science (1966) 50
aussi ce lien d'action et de raction entre le monde et ma pense, que, par opposition l'entendement, nom de moi qui pense, et la sensibilit, mon nom en tant que je subis, je nommerai imagination. L'imagination sera dsormais ma seule institutrice, elle qui est seule cause de toutes mes incertitudes et de toutes mes erreurs. Car l'entendement ne peut me tromper, d'autant que par lui-mme il ne m'apprend rien, sinon : je pense, donc je suis, et les impressions des sens ne peuvent me tromper, puisqu'il est toujours vrai que je sens ce que je sens. Si je n'tais qu'entendement et sensibilit, je saurais que je vois un clair, que j'entends le tonnerre, peu prs comme je sais que les paroles que l'art muet me prsente sur un cran sont prononces par une voix d'homme ou de femme. Mes impressions, mes penses, seraient sans mlange les unes des autres, et je n'aurais, hors de la certitude que je suis, ni opinions, ni croyances, ni prjugs, ni passions ; je jouirais d'une sagesse ngative, mais parfaite. Je serais toujours comme on est au spectacle quand la mise en scne est mauvaise, et que la tempte, l'meute ou la bataille sont ridiculement imites. Mais cette supposition est absurde, tant elle est contraire la ralit, car les impressions des sens ne parviennent ma pense qu'en la troublant, et, loin d'tre un entendement auquel des sens sont ajouts comme des tlphonistes un tat-major, je ne suis d'abord qu'imagination. De ce que le tonnerre clate, il s'ensuit, non que je prends connaissance d'un son, mais que l'acte par lequel je pense est troubl en sa source, que ma volont n'est plus mienne, qu'en s'emparant du monde elle s'y livre, et que, perdant aussi en efficacit tout ce qu'elle perd en autonomie, elle devient effroi, inquitude, aversion, dsir, espoir. dfaut d'un coup de tonnerre, un lger murmure tablit cette mainmise mutuelle et, sinon par ma mort, indissoluble, du monde et de moi l'un sur l'autre. Le monde et mon esprit s'y mlent si bien que, si je crois penser l'un des deux sparment, je lui attribue aussi ce qui est l'autre ; ainsi, les penses confuses occupent toute mon me. Le moindre branlement des sens me jette sur le monde ; mais, comme il ne m'est pas donn sur le monde cette prise directe que j'y cherche ttons, mon vouloir, loin d'tre actif, tombe la passion ; j'attribue alors ce vouloir plus ou moins d'influence selon qu'il est moins ou plus du, je regarde mon tre comme constitu par cette puissance imaginaire qui ne vient que du monde, et, en retour, je doue le monde de passions. En ce corps corps, le monde est toujours vainqueur, quoique je m'y trompe toujours. je dois sortir du monde si j'y veux prendre pied. je ne dois
Simone Weil, Sur la science (1966) 51
pas attaquer de front et essayer d'treindre, mais ruser, chercher une prise et saisir de biais. Dj, de ce chaos mlang du monde et de moi, j'ai pu me dgager. J'ai un instant rendu mon esprit, par le doute, aveugle et sourd aux assauts du dehors, j'ai fait taire le tumulte de l'imagination qui m'empchait de reconnatre en moi non pas un tre qui se nourrit, marche, s'arrte, aime, hait, mais un tre qui pense, et j'ai enfin connu que je suis. je sais maintenant tout ce que je peux savoir par le pur entendement. prsent je n'ai plus suspendre l'imagination, mais lui laisser cours pour m'instruire auprs d'elle. C'est en ce nud d'action et de raction qui me retient au monde que je dois trouver ma part et connatre ce qui me rsiste. cet gard l'lan qui, au moindre grincement, me jette recrer le monde me trompe chaque fois ; car les impressions qui lui succdent et par lesquelles il se trouve exauc ou du, ou plutt exauc et du la fois, sont fortuites. Aussi ne dois-je pas tudier l'imagination comme action, c'est-dire en rapport avec les effets, mais uniquement comme pense. Le monde n'est pas hors de ma pense, il est avant tout ce qui n'est pas moi en moi. je ne dois pas chercher sortir de moi pour dfinir l'obstacle. Ainsi je vais interroger l'imagination. Non pas la faire parler, car elle parle assez d'elle-mme ; je n'entends qu'elle en moi, je n'ai pu la faire taire qu'un instant pour couter le pur esprit. Mais il faut que j'apprenne l'couter, que je distingue quand elle parle vrai. je le puis, car il ne s'agit que de distinguer, dans les penses o l'imagination a part, celles o elle est drgle, ou plutt o elle me mne, et celles o l'esprit tient les guides. Car l'imagination par sa nature est double. Elle reprsente pour moi, ou la prsence de ce monde tranger que je ne puis comprendre, ou ma prise sur ce monde. Or sur le monde l'imagination ne peut me renseigner ; si je me fie elle, le monde ne sera jamais qu'une cause de tristesse ou de joie, soit, puisque je me reprsente toujours la cause de mme nature que l'effet, une volont trangre la mienne, redoutable, bien ou mal dispose ; il ne sera jamais l'obstacle. Car il n'y a d'obstacle que pour qui agit, et il n'y a point d'action pour l'esprit que l'imagination domine ; l'imagination reprsente bien, ou plutt constitue, la prise que j'ai sur le monde, la correspondance qui se trouve tre, par l'union de l'me et du monde, entre une pense de moi et un changement hors de moi ; mais cette correspondance ne constitue pas une action, je puis seulement en user pour
Simone Weil, Sur la science (1966) 52
agit. C'est selon cette double nature que je vais examiner tout ce qui en moi est imagination. Je rappelle donc en foule toutes les penses dont je m'efforais d'oublier la prsence : ville, nuages, bruits, arbres, formes, couleurs, odeurs, motions, passions, dsirs, tout cela a de nouveau pour moi un sens ; la question est de savoir quel sens. L'imagination me semble drgle en toutes ces penses marques de passion, qui s'imposent moi parfois aussi violemment que les impressions des sens, puis qui changent, que je change, qui m'chappent. C'est ainsi que parfois quelque chose, au tournant de la route, m'effraie ; qu'est-ce ? Non pas des impressions sensibles ; les impressions ne parviennent pas plus ma pense que les dessins bizarres forms par les lettres, lorsque je lis. Ce qui m'effraie, c'est l'ide, forme par l'imagination l'occasion de ce que je vois, d'une volont hostile et puissante qui me menace. Quelques instants plus tard mon imagination forme une autre ide : celle d'un tre inoffensif, d'un arbre. Parfois je puis ensuite jouer avec ma frayeur, me l'inspirer de nouveau si je veux, mais il arrive alors, ou qu'elle m'chappe, ou qu'elle me saisisse malgr moi. En toutes ces choses qui m'entourent, que je croirais indpendantes de moi, je remarque de pareils jeux d'imagination. De toute manire les ides que j'en ai reprsentent bien la prsence du monde sur moi, non la prise de moi sur le monde ; car elles se forment en moi au moins en partie malgr moi. je les subis, elles ne m'apportent donc qu'ignorance. Mais poursuivons. N'y a-t-il pas d'autres penses o l'imagination ait part ? Si, il y en a, et bien autres. Quand je compte ces mmes choses l'occasion desquelles l'imagination rgne en moi, je rencontre une ide d'une autre espce, qui ne s'impose pas moi, qui n'existe que par un acte de mon attention, que je ne puis changer ; elle m'est, comme le je pense, donc je suis , transparente et invincible. Cette ide du nombre, et celles qui lui ressemblent, je trouve qu'elles remplacent pour ainsi dire les changements sans rgle auquel les autres sont sujettes par un progrs dont elles sont le principe. Elles servent d'abord des raisonnements qui, encore qu'ils soient clairs et immuables comme elles, semblent contraindre mon esprit presque la manire des sens, et comme me jeter les vrits aux yeux. Mais je trouve aussi parfois, entre ces ides, un ordre qui me permet de former une ide aprs une autre, de telle manire que chacune soit marque de la mme vidence qu'avait par elle-mme l'ide premire. C'est ainsi que je pense deux aprs un, trois aprs deux.
Simone Weil, Sur la science (1966) 53
Si je cherche quel crdit doit tre accord toutes ces penses que l'imagination nourrit, je trouve que seules, Parmi elles, les ides claires ne reprsentent pas l'invasion du monde en moi, puisque seule ma propre attention me les prsente. L'imagination y a bien part cependant, car elles ne me sont pas, comme l'ide de je pense, donc je suis , entirement limpides. Pourquoi sept est-il un nombre premier ? Pourquoi pas neuf ? je ne sais. C'est ainsi. Ces ides ne rendent pas compte d'elles-mmes. je dois les prendre telles qu'elles sont. Elles procdent donc de quelque chose qui m'est tranger, autrement dit du monde ; et puisque l'imagination est le seul intermdiaire entre le monde et moi, elles procdent de l'imagination. Mais l'imagination les forme, non pas en tant qu'elle soumet la pense au monde ; en tant au contraire que, conduite par l'esprit, elle lui ouvre un passage dans le monde. Telle est donc l'arme de l'esprit contre le hasard. Si mes penses laissaient tout intact hors de moi, ou si, ce qui cet gard reviendrait au mme, elles s'imprimaient elles-mmes dans les choses, il n'y aurait point place pour le hasard. Mais ces penses laissent sur le monde une trace qui ne leur ressemble pas ; moi cependant, je cherche sans cesse une telle ressemblance, et crois plus ou moins la trouver ; telle est la source des superstitions, des passions, de toutes les folies, qui consistent, sans exception, en ce que la pense est livre au hasard. Mais le propre de l'esprit est de supprimer le hasard. Il trouve ici sa tche, tche ngative, la seule qui lui reste, car par l'acte de poser le Je pense, donc je suis , l'esprit a donn tout ce qu'il pouvait donner de positif. Or l'esprit rencontre ici sa ressource contre le hasard ; car ses passions cderont la place une volont qui, malgr la condition o le rduit le monde, s'imprimera directement dans les choses, pourvu qu'il ne prenne pour objet immdiat de son vouloir que ce changement dont il dispose, et qui constitue sa prise sur le monde. Les ides claires, filles de l'imagination docile, seront donc dsormais mon seul appui. Il est vrai que cet appui semble bien frle, car ces ides sont videmment insuffisantes. Il n'en peut tre autrement ; si cette prise sur le monde, quoi elles correspondent, n'tait pas insuffisante, elle constituerait une domination directe, je ne subirais pas le monde, l'esprit resterait pur sans combats. Au contraire, le monde limite ce pouvoir souverain sur soi qui fait l'esprit. Il rduit l'esprit ne pouvoir que changer partiellement cette existence trangre par laquelle il se sent
Simone Weil, Sur la science (1966) 54
tenu. Or l'action de l'esprit, c'est l'esprit mme ; et si le monde peut ainsi rduire l'esprit n'tre qu'une chose finie le monde est le plus fort, l'esprit prit. Mais cette action partielle n'est pas par elle-mme action, elle ne me dfinit pas, la pense infinie en dispose. Quoique rduit exercer une prise misrablement peu efficace, l'esprit se retrouve esprit par le pouvoir infini d'ajouter elle-mme cette action finie. Par ce pouvoir, l'esprit chappe la domination du monde, il gale le monde. Ainsi l'insuffisance mme des ides claires tmoigne pour moi de leur prix. Une ide claire ne constitue pas une connaissance, je ne fais acte de connaissance qu'au moment o j'ajoute une ide claire elle-mme et conois qu'une telle addition est sans fin. C'est ainsi que j'ajoute un un. Ce que je connais ainsi, ce n'est pas le monde ; une srie n'est pour moi qu'un modle ou un plan d'action. Mais ce modle, c'est le modle d'une action vritable, c'est--dire d'une action que rien ne limite, infinie en droit, qui me fait en quelque sorte galer Dieu. Ainsi, autant du moins que le monde est soumis mon action, l'ordre me donne le pouvoir de tenir le monde, dans sa totalit, en quelque sorte sous mon regard, de le passer en revue, de me fier la certitude que d'aucune manire le monde ne dpasse ma pense. Si j'examine prsent en quoi consiste la prise que me laisse le monde et que les ides claires me serviront dfinir, je trouve qu'elle n'est pas constitue par autre chose que par ce que je nomme le mouvement droit. Ce qu'est le mouvement, je n'essaierai pas de l'expliquer, puisque, sauf ma pense propre, dont il ne procde point, rien n'est plus clairement connu par soi. Ainsi cette source inconnue des penses que les sens et l'imagination ensemble produisent en moi, le monde, est dfini comme quelque chose sur quoi j'agis par l'intermdiaire du mouvement droit. Cette ide de mouvement droit, conue selon la puissance infinie par la elle j'ajoute l'action l'action, n'est autre que l'ide de droite. D'o le monde est encore dfini comme ce qui reoit la droite. prsent, puisque j'ai dcid de concevoir le monde, dans mon corps corps avec lui, comme un lutteur, pour ainsi dire, semblable moi, mais tte innombrable, je vais combiner le mouvement droit avec le mouvement droit, la droite avec la droite. J'imaginerai par exemple un objet que je tire par une corde, et qui est en mme temps tir dans une autre direction ou retenu par un rebord ; l'objet ne pourra se mouvoir que dans une direction oblique par rap-
Simone Weil, Sur la science (1966) 55
port celle que je lui ai donne. Ainsi se trouve dfini l'oblique, qui est la gomtrie ce qu'est le nombre deux la suite des nombres. Si je suppose prsent l'objet que je meus rattach, non plus une direction quelconque, mais un point fixe, je dfinis le cercle ; si je le suppose rattach deux points fixes, je dfinis l'ellipse. Cette esquisse est grossirement trace, et je me trouve prsentement incapable de pousser la srie plus loin. Mais du moins je conois tout d'abord que, si je considre la srie sous un aspect un peu diffrent, le rapport d'une droite avec une droite parallle joue le rle de l'unit. Le rapport de deux droites qui se coupent suit immdiatement dans l'ordre de la complication ; la distance entre les droites n'est plus constante, mais elle change comme la suite des nombres ; c'est ici le moment d'noncer ce fameux thorme de Thals sur lequel est fond la gomtrie analytique. Toutes les autres lignes se trouvent dfinies de mme, par rapport la droite, d'aprs le degr qui marque leur distance la droite dans la srie. Ainsi la suite des nombres, autrement dit l'arithmtique, s'applique la gomtrie. vrai dire il ne convient pas de lui appliquer l'arithmtique elle-mme, mais une arithmtique redouble qui est la deuxime espce de srie, dont il a t dit qu'elle convient la connaissance du monde, ce qu'est l'arithmtique simple la premire espce, qui dfinit mon action. Cette autre arithmtique, qui a nom algbre, se constitue en remplaant, comme principe gnrateur de la srie, l'addition par la multiplication. Tel est l'difice des ides que je dois prparer avant de tourner mon esprit vers le monde. J'ai ainsi de quoi remplacer les ides que l'imagination trompeuse me fait lire dans les sensations. Cette maison qui me semble un tre secret et perfide, je supposerai qu'elle n'est qu'objet de mon action, rsistance mon action. je ne puis concevoir une telle rsistance que comme tant de mme espce que mon action ellemme qui s'y applique, c'est--dire non pas comme pense, volont, passion, mais comme mouvement. Et pour reprsenter ce que je suis l'gard du monde, je supposerai qu' l'unique mouvement dont je dispose il oppose un mouvement innombrable, un mouvement qui soit l'impulsion droite ce qu'est le nombre que les mathmaticiens nomment infini l'unit, les mouvements qui correspondent l'oblique, au cercle, l'ellipse tant comme deux, trois, quatre. Mais pour concevoir clairement ce mouvement infiniment compos, il n'est pas d'autre moyen pour moi que de concevoir une quantit indfinie d'impulsions
Simone Weil, Sur la science (1966) 56
droites qui se combinent, et de les concevoir chacune sparment, sur le modle du mouvement dont je dispose. je supposerai dans le monde une quantit indfinie d'impulsions simples, et je dfinirai chacune d'elles, comme la mienne propre, par une droite. C'est dire qu'autant que dans le monde elle se trouvera dtourne, je la supposerai dforme, tordue par ses innombrables surs. Je dfinirai aussi ce mouvement comme uniforme ; bref je supposerai l'impulsion premire se reproduisant sans cesse, toujours semblable elle-mme. La part du monde est ainsi rduite ce qui dforme, arrte, acclre, ralentit un mouvement uniforme et droit. Je puis ensuite, cette part mme, la rduire nouveau en y considrant nouveau un mouvement uniforme et droit. Je puis ainsi dcomposer sans fin le monde. Ce n'est pas que j'espre arriver un rsultat ; la condition o je me trouve consiste en particulier en ceci, que je ne puis jamais puiser le monde. jamais je ne rejoindrai le monde au mouvement droit. Mais ce que j'ai acquis du moins, c'est de savoir qu'il n'y a pas de limite mon analyse, qu'elle est toujours valable, que toujours je puis trouver que le monde consiste en un mouvement, puis un mouvement, puis un mouvement. Je fais ainsi socit avec le monde, non, il est vrai, comme un homme avec un homme, mais comme un homme avec une multitude indfinie. Comme un mouvement du monde rpond une espce de pense en moi, que je nomme vouloir, de mme ces autres penses, que je nomme impressions des sens, je suppose qu'elles sont ce qui, en moi, correspond ce peuple de mouvements. Mais cette foule ne m'effraie plus prsent que je la compose en ajoutant une unit une unit. Je vois bien que la direction lue ma pense y imprime doit aussitt, par tous es mouvements qui s'y combinent, tre rendue mconnaissable ; mais je vois aussi qu'elle se combine son tour aux mouvements que je subis, et je conois qu'il peut m'tre ainsi possible de les diriger. J'entrevois comment on peut apprendre louvoyer dans cette mer. Cette physique est-elle vraie ? je ne saurais l'affirmer. Car elle consiste supposer tous les changements en mes impressions comme constitus par des mouvements du monde, par des mouvements droits. Or l'ide mme de mouvement procde de l'imagination, et, quoiqu'elle soit plus claire que toutes les ides auxquelles l'imagination participe, elle n'est pas moins ambigu ; car, comme l'imagination elle-mme, elle participe de moi et du monde. Ainsi une droite est la fois une et divisible ; l'unit y est ma marque. Quand je fais une vo-
Simone Weil, Sur la science (1966) 57
lont correspondre l'ide d'un mouvement, je puis dire en deux sens que ce mouvement est continu. Par la volont, par le projet, le mouvement est un du commencement la fin. En revanche ds que je conois que le mouvement se ralise, je conois qu'il se dissout, que loin d'tre un il se recommence sans cesse. Ainsi, par le mouvement, mon vouloir est comme parpill dans le temps. Or c'est l en quoi consiste la part du monde en moi. C'est cette double nature de mon action qui se trouve comme imite en tout ordre, et par exemple dans la suite des nombres. Aussi puis-je dire qu'entre un et deux le monde est envelopp tout entier, en quelque sorte en puissance. Un, deux, cela forme comme une pince saisir le monde. Or si ma pense, en tant qu'elle est jointe au monde, est ainsi comme morcele, sans cesse hors d'elle-mme, c'est que le monde est ce qui est sans fin extrieur soi. Ce qui fait l'unit du mouvement, la direction, est la part de l'esprit ; si je cherche ce qui reste du mouvement, abstraction faite de la direction, je trouve que la part du monde est la juxtaposition. Dans le monde tout est hors de tout, tout est tranger tout, tout est indiffrent tout. S'il est cause qu'en ma pense autant qu'elle lui est jointe, rien n'est immdiat, c'est parce qu'en lui tout est immdiat. Bref ce qui n'est pas moi dans le mouvement, c'est le fait, non pas qu'il est dirig, mais qu'il s'tend ; et ce qui constitue le monde, c'est l'tendue. Et l'on ne peut pas dire que le monde soit dfini ainsi seulement en tant qu'il me fait obstacle, et par suite seulement par rapport moi. Si le monde me fait obstacle, c'est autant qu'tant joint la pense, la pense doit se conformer au monde, en suivre la nature propre qui n'a point de rapport avec l'esprit. Ce qui dans le monde me fait obstacle, c'est le monde. Le monde est ce qu'il est, il ne se modle pas sur la pense en s'unissant elle, et c'est en quoi il l'empche. Ainsi je puis dire que le monde, en soi-mme, n'est autre chose qu'une substance tendue. Les ides gomtriques et physiques, en attribuant au monde des lignes et des mouvements dirigs, non seulement vont plus loin que ce que je puis savoir, mais mme elles sont fausses. Est-ce dire qu'elles ne me font rien connatre ? On peut dire qu' proprement parler elles ne peuvent rien me faire connatre, puisque je sais tout quand je sais que le monde, c'est l'tendue. Mais elles ne laissent pas pourtant de m'instruire, non en tant que je suis entendement, mais en tant que je suis aussi imagination. En ces impressions o je commence par lire des penses qui me sont trangres, des penses caches, ces thories m'aident supposer que le texte vritable est l'tendue.
Simone Weil, Sur la science (1966) 58
Cette sagesse est-elle la dernire sagesse ? Ne puis-je jamais que supposer l'tendue ? Ce serait une sagesse bien incomplte, bien maigre, toute ngative, de pure dfiance. Car, tandis que la folle imagination fait que je crois voir, dans les sensations, les choses les plus fantastiques, et que je fais lever un dieu chaque pense, il sen peu qu' cette loquente folie j'oppose la simple supposition que ce qui est vritablement signifi par les sensations, c'est l'tendue. La raison est alors abstraite, et, spare de l'imagination, ne l'empche pas de se donner libre cours. je suis toujours deux, d'un ct l'tre passif qui subit le monde, de l'autre l'tre actif qui a prise sur lui ; la gomtrie, la physique me font concevoir comment ces deux tres peuvent se rejoindre, mais ne les rejoignent pas. Ne puis-je atteindre la sagesse parfaite, la sagesse en acte, qui rejoindrait les deux tronons de moimme ? Certes je ne puis les unir directement, puisque c'est en cette impuissance que consiste la prsence du monde en mes penses ; mais je peux les rejoindre indirectement, puisque ce n'est pas en autre chose que consiste l'action. Non pas cette apparence d'action par laquelle l'imagination folle me fait bouleverser aveuglment le monde au moyen de mes dsirs drgls, mais l'action vritable, l'action indirecte, l'action conforme la gomtrie, ou, pour la nommer de son vrai nom, le travail. C'est par le travail que la raison saisit le monde mme, et s'empare de l'imagination folle. C'est ce qui ne se pourrait pas si je connaissais le monde par le pur entendement. Mais cette imagination folle que je veux modeler selon la raison n'est pas autre que l'imagination docile, ma matresse de gomtrie, ou plutt mon instrument ; il n'y a qu'une imagination. Cette imagination simple, et cette autre tte innombrable, c'est la mme, la prise mutuelle du monde et de moi, selon qu'elle obit surtout au monde ou surtout moi. Par l'intermdiaire du monde seulement, par l'intermdiaire du travail, je les rejoins ; car par cet intermdiaire, si je n'unis pas les deux parties de moi, celle qui subit, celle qui agit, je peux faire du moins que je subisse les changements produits par moi, que ce que je subis, ce soit ma propre action. C'tait impossible tant que je ne savais que dsirer, puisque au dsir d'un bonheur quelconque ne correspondait qu'un mouvement dans le monde, entirement tranger au bonheur. Mais si je ne fais porter ma volont que sur l'ide d'une direction, ce vouloir rpond aussitt une
Simone Weil, Sur la science (1966) 59
impulsion qui lui est conforme ; ma volont s'imprime toute vive dans le monde. Mais cela ne suffit pas, il faut trouver des intermdiaires qui rejoignent le mouvement droit, que seul je peux produire, ce changement complexe que je veux faire parvenir mes sens. Je dois ruser, je dois m'empcher moi-mme par des obstacles qui me mnent o je veux. Le premier de ces obstacles, c'est l'imagination mme, cette attache, ce nud entre le monde et moi, ce point de rencontre entre le mouvement simple dont je dispose et le mouvement infiniment compos qui reprsente pour mon entendement le monde. Ce point de rencontre des deux mouvements, c'est une chose qui reoit le mouvement, c'est une chose tendue, c'est un corps. je le nomme mon corps, et par excellence, le corps. En lui, et dans le monde autant que je le saisis par le travail, se rejoignent les deux imaginations. Elles se trouvent toutes rejointes en ma pense, et mme, je le reconnais prsent, elles le sont depuis les plus anciennes penses que je puisse me souvenir d'avoir formes. Car j'ai eu tort, quand j'ai pass en revue mes penses, de ne distinguer, dans les unes, que l'imagination conduite par l'entendement, que dfinissait la gomtrie ; dans les autres, que la sensibilit passive et l'imagination trompeuse. En cette dernire classe je rangeais, avec les passions et les rves, les penses de toutes les choses prsentes autour de moi : cette chambre, cette table, ces arbres, mon corps mme. je reconnais prsent en ces choses perues l'union de ces deux espces d'imagination, qui se trouvent, spares, l'une dans les motions, l'autre dans la gomtrie. La perception, c'est la gomtrie prenant possession en quelque sorte des passions mmes, par le moyen du travail. Il est impossible que je ressente directement ma propre action, puisque telle est la condition que le monde m'impose. Mais du moins je puis, au lieu de prendre les impressions comme signes d'existences fantastiques, ne les prendre que comme intermdiaires pour saisir mon propre travail, ou plutt l'objet de mon travail, l'obstacle, l'tendue. C'est en quoi consiste la perception, comme on peut voir par le clbre exemple du bton de l'aveugle. L'aveugle ne sent pas les diffrentes pressions du bton sur sa main, il palpe directement les choses de son bton, comme si son bton tait sensible et faisait partie de son corps. Moi-mme, en ce moment, je sens le papier au bout de ma plume, et bien mieux encore si je ferme les yeux. La pression du porte-plume sur ma main, seule chose, semble-t-il, que je devrais sentir, je dois y faire attention pour
Simone Weil, Sur la science (1966) 60
la remarquer, tout comme j'ai besoin d'attention pour voir des plaques de couleur jaune ou rouge, et non une peau de femme, sur la toile qui reprsente la Joconde. Mes sensations prsentent toujours la pense, non elles-mmes, mais une ide qui s'accorde au trouble qu'elles y causent. Quand je rponds ces assauts du monde contre moi, que je nomme sensations, non plus par la joie ou la tristesse, mais par le travail, elles n'apportent autre chose la pense que l'objet du travail. C'est ainsi que de son bton comme d'une main l'aveugle, loin de subir purement et simplement, comme on croit volontiers, des contacts, palpe, non pas la matire sensible, mais l'obstacle. Et inversement pour chacun le bton de l'aveugle n'est autre chose que son propre corps. Le corps humain est pour l'esprit comme une pince saisir et palper le monde. Mais, pour dcrire la chose par ordre, le corps n'est pas naturellement ma disposition. Je dois prendre possession de mon corps. chacune de mes penses sont joints des mouvements de mon corps ; ainsi, quand j'ai peur, le corps court. Mais parmi tous ces mouvements, je ne dispose que de quelques-uns ; tout ce que je puis, c'est imprimer un mouvement droit en certains points de mon corps. Mais encore que je ne dispose pas de mouvements plus compliqus, mon corps en dispose, il dforme suivant sa structure propre la direction que je lui transmets, et je dois apprendre me servir de cette dformation, utiliser l'obstacle pour suppler la puissance qui me manque. Ainsi je ne sais pas ce que c'est qu'imprimer un mouvement circulaire, mais j'y remdie en m'empchant moi-mme, dans l'acte mme de mouvoir mon bras en ligne droite, par l'attache du bras l'paule. En plus, comme, par l'tendue du corps, je dispose de plusieurs mouvements droits, je puis les combiner ; mais tout d'abord, je les spare, et, tout comme dans un problme, je divise la difficult pour en considrer part chaque lment ; de mme j'apprends mouvoir, non tout le corps par une pense, mais seulement le membre que je veux. Puis, par une sorte de gomtrie en acte, je combine ces mouvements suivant un ordre du simple au complexe. Ce n'est pas trois qui m'instruit sur trois, ni le cercle sur le cercle, mais l'unit et la droite. De mme, pour peu que je craigne, mon corps sait courir ; mais si je veux, moi, savoir courir, ce n'est pas en courant que je l'apprends, c'est en m'exerant sparment lever les genoux et allonger le pas ; exercices qui ne ressemblent pas plus la course que la droite au cercle. Cet intermdiaire entre la gomtrie et le travail, c'est la gymnastique. J'apprends me servir de mes sens d'une manire analogue, car tous
Simone Weil, Sur la science (1966) 61
mes sens sont des espces de toucher ; pour mieux dire je n'aperois qu'en agissant et en palpant ; c'est ainsi que, comme le fait voir la clbre analyse de Descartes, je saisis chaque objet de mes deux yeux, comme de deux btons. Ds que mon corps est ainsi moi, je ne conois plus seulement, comme la gomtrie me le permettait, qu'on puisse louvoyer en cette mer du monde ; j'y louvoie ; non seulement j'ai prise sur le monde, mais ma pense est comme un lment du monde, tout comme le monde, d'une autre manire, fait partie de ma pense ; de ce moment, j'ai part l'univers, je suis au monde. Cela ne me suffit pourtant point. Le corps n'est pas ce qu'il faut pour le travail. Car le travail consiste, comme il a t dit, en ce que, pour me faire ressentir ce que je veux, je dois user de mouvements par eux-mmes indiffrents ce que je veux. Mais si ces mouvements sont trangers par eux-mmes ce que je veux ressentir, ils ne le sont pas ce que je ressens ; chacun d'eux se trouve attach plaisir ou douleur, et je dois en tenir compte. C'est ainsi que je ne puis mettre ma main sous une lourde pierre pour la soulever. En plus la structure de mon corps me sert parfois, il est vrai, comme pour courir, pour lancer, mais d'autres fois elle m'empche ; c'est un obstacle qui me mne parfois o je veux, parfois non, et je ne puis le jeter pour le remplacer par un autre. Aussi ai-je besoin pour ainsi dire d'autres corps humains, des corps humains insensibles, que je puisse engager n'importe o,dont je puisse disposer, que le puisse prendre, quitter, reprendre, bref qui reprsentent parfaitement la nature indirecte du travail. Ces corps humains moins ambigus, qui, de ce mlange de sensibilit et de travail, gardent ceci seulement, qu'ils sont propres au travail, je les possde, ce sont les outils. L'impulsion de l'esprit est ainsi coule, non uniquement dans le moule immuable de ce premier outil qui m'est joint, mon corps, mais en plus dans le moule des outils proprement dits, dont la structure n'est immuable qu'autant qu'il me plat. Au reste ces outils, tout en tendant ma porte, jouent le mme rle mon gard que le corps mme. Ce sont des obstacles forms de manire transformer mes impulsions en mouvements plus composs. L'attache du bras au corps me permet de dcrire un cercle ; cette transformation de mouvement droit est parfaite pour le paysan, quand au bout de son bras il a mis une faux. La roue, la manivelle, me permettent de dcrire des cercles o je veux, alors que ceux que je dcris avec mon bras ont toujours mon paule pour centre. Le rmouleur, en levant et en abaissant
Simone Weil, Sur la science (1966) 62
son pied, perpendiculairement au sol, c'est--dire par un mouvement droit, obtient le mouvement circulaire de sa roue. Le levier au contraire transforme un mouvement vertical en un mouvement vertical. On pourrait essayer ainsi une srie des outils selon un ordre gomtrique. Au reste ces outils eux-mmes, tout comme le corps, ne me permettent que les mouvements les moins complexes ; la puissance qu'ils me procurent est de mme espce que celle que fournit le corps, quoique plus tendue. Aussi, si je veux tendre nouveau mon royaume, je n'ai qu'un moyen de le faire, c'est de composer les outils simples entre eux. L'action humaine se rapproche ainsi de plus en plus de la complexit indfinie du monde, sans jamais l'atteindre. L'homme compose des machines avec la roue et le levier, comme il construit un point quelconque d'une conique avec la rgle et le compas. C'est ainsi qu'au travail s'ajoute l'industrie. C'est ainsi que je peux distinguer plusieurs manires de connatre le monde. Par le travail je le saisis. Cette plume que je meus sur le papier sert d'intermdiaire entre moi et le monde. Les sensations qu'il me procure, n'ayant aucun intrt pour moi par elles-mmes, ne se rapportent en mon esprit qu' mon action et au papier qui la reoit. C'est de la mme manire que je cache le Panthon par mon volet, d'un mouvement de ma tte, puis, d'un mouvement inverse, le dcouvre, et saisis ainsi que le volet est entre mes yeux et le Panthon. C'est ainsi encore que je rapporte les sensations que me procurent les deux yeux un seul Panthon, dont je dtermine le relief, la distance ou la grandeur en variant, par mon propre mouvement, ce double contact. Car une telle exploration, encore qu'elle s'exerce distance, qu'elle ne mette en mouvement que mon propre corps, qu'elle n'ait pas pour fin de rien changer, est, sinon travail, du moins prparation au travail ; elle fait des sensations les signes des distances, des grandeurs, des formes, autrement dit, de mes travaux possibles. Inversement le travail effectif a rapport la connaissance, non autant qu'il change quelque chose dans le monde, mais autant qu'il l'explore. Je sens ou plutt je perois la pierre au bout du levier, comme je perois le Panthon au bout, si je puis dire, de mon regard, au point de rencontre de mes deux regards. Ainsi autant le monde est soumis mon action, exerce au moyen du corps et des plus simples outils, autant je saisis l'tendue elle-mme en mes sensations. Je ne me contente plus de construire la gomtrie, je l'exerce. L'ambigut qui se trouve dans la gomtrie
Simone Weil, Sur la science (1966) 63
thorique, qui appartient la fois l'esprit et au monde, disparat ici ; dans l'exercice mme de l'action gomtrique, dans le travail, la direction que je donne, l'obstacle que je rencontre, sont nettement spars ; ce qui est objet pour l'esprit, ce n'est plus l'ordre, c'est ce qui dans l'ordre est la part du monde tout seul ; je saisis l'ordre immdiat. L'ordre immdiat, c'est l'tendue nue. Cette tendue que je perois comme directement, dpouille de tout mlange d'esprit, de toute parure d'imagination, cette tendue intuitivement saisie, c'est l'espace. L'tendue est plus pourtant que l'espace, car elle chappe ma perception autant qu'elle chappe la prise de mon corps et des outils que j'ai en main. je fais glisser le Panthon le long du ciel rien qu'en bougeant la tte, j'en couvre de ma main les parties que je veux, j'en change le relief par mes mouvements, je dtermine quelle distance de moi mes deux regards, braqus sur lui comme deux btons qui le saisissent, se rejoignent, et ainsi j'y perois l'espace ; mais je ne le touche pas. Je ne fais qu'en imaginer la consistance. Car autant que sur un objet je n'exerce aucune prise, j'en imagine une ; mais cette imagination, dans la mesure o elle n'est pas rgle par la mmoire des travaux et des explorations passs, est libre, par suite trompeuse. Ainsi le Panthon est bien au sommet du triangle dtermin par la distance de mes yeux, que je connais, et la direction de chacun de mes deux, regards, que je connais galement ; mais un tel triangle n'existe pas pour le soleil. Si je voulais saisir les objets avec deux btons que je pourrais rendre plus grands ou plus petits volont, j'carterais les btons pour saisir les objets loigns ; mais comme je ne peux carter les yeux, cette pince que constitue ma vue n'a pas prise sur le soleil. Aussi je ne perois pas la distance du soleil moi, je ne fais jamais que l'imaginer, par exemple deux cents pas. Le soleil peut tre saisi, non pas par deux yeux d'un mme homme, mais par deux hommes ; s'ils s'loignent suffisamment, ils peuvent, connaissant la distance qui est entre eux et la direction de leur regard, dterminer la distance du soleil exactement comme je perois celle du Panthon. Mais quand je participerais cette mesure, ma manire de percevoir n'en serait pas change, car cette action qui saisit le soleil est collective, je n'en dispose pas. je sais que le soleil est trente-six millions de lieues, mais je ne le perois pas plus trente-six millions de lieues qu'un de mes yeux, s'il pensait, ne percevrait en ce moment la distance du Panthon. On peut dire que les deux observateurs qui mesurent la distance du soleil
Simone Weil, Sur la science (1966) 64
sont comme deux yeux de l'humanit, que l'humanit seule peroit l'espace qui spare la terre du soleil ; tout comme on peut dire que, par l'industrie, c'est l'humanit qui travaille. Pour prendre un autre exemple : si, en faisant tourner la nuit une roue devant moi, on ne me donne qu'une lumire interrompue d'instant en instant, je ne verrai que des positions successives de la roue, mais j'en percevrai pourtant le mouvement ; on peut dire que c'est de la mme manire que, par les observations, les registres, les archives, l'humanit peroit le retour des comtes. Telle est la science. Le lien que ma tche est d'tablir, du fait que je perois, entre mes sensations et mes actions, la science doit d'abord le dissoudre, car, dans le domaine de la science, un tel lien ne peut tre qu'imaginaire et par suite trompeur. Je ne puis cependant, dans la perception mme, sparer ce lien d'imagination des liens rels qui constituent l'espace. La science rduit chaque observateur tre, non un tre percevant, mais autant qu'il est possible analogue un simple organe des sens. Toute tromperie possible de la part de l'imagination est supprime, du fait que celui qui observe est strictement rduit la prise qu'il exerce rellement sur les phnomnes observs ; cette prise, si petite qu'elle soit, existe toujours, car dans la mesure o le monde ne nous laisse aucune prise il chappe aussi entirement nos sens. C'est ainsi que la prise que nous avons sur le ciel consiste en particulier en cacher les parties que nous voulons par des objets interposs ; aussi pour l'astronome le ciel toil n'est-il que des taches brillantes dans les quarts de cercle que dtermine son rticule. Telle est la constatation. Comme les outils forment les pices des machines, ainsi chaque observateur, autant que, par sa prise trop simple, il saisit les phnomnes compliqus qui le dpassent, est comme une pice de la science. D'autre part, comme la gomtrie la plus simple est comme enferme en mon corps, d'autres corps sont fabriqus qui, tels que les lunettes astronomiques, en mme temps qu'ils sont purs de tout mlange de sensibilit, enferment une gomtrie suprieure ; ce sont les instruments. Ainsi, l o les hommes ne saisissent pas l'espace, la science les aide supposer l'tendue. Car elle imite, par la construction de la gomtrie, entre ce qui est constat et l'tendue, cette liaison parfaite qu'tablirait le travail. cet effet elle imagine, pour ainsi dire, sous les phnomnes constats, des combinaisons d'outils simples, tels qu'en forment les machines. Ces modles mcaniques des choses, elle
Simone Weil, Sur la science (1966) 65
ne prtend pas qu'ils reproduisent le monde ; cela n'aurait mme pas de sens. Du moins permettent-ils de placer les phnomnes que nous ne saisissions pas en srie avec ceux que nous saisissons, selon l'ordre gomtrique du simple au complexe. Aussi tous les modles mcaniques d'un phnomne, pourvu qu'ils le placent au mme rang dans la srie, sont-ils quivalents. Ou plutt ils sont plus quivalents, ils sont un, comme l'ellipse qu'un jardinier trace au moyen d'une corde noue deux piquets est la mme que la section d'un cne ; et l'unit de tous ces modles mcaniques est dfinie par ce qui exprime leur degr commun de complication, c'est--dire par une formule algbrique. Peut-tre peut-on interprter de la sorte la clbre parole de Maxwell, que, quand on a obtenu un modle mcanique d'un phnomne, on en peut trouver une infinit. L'on peut aussi comprendre ainsi comment l'analyse peut s'appliquer directement la physique. Mais en une telle application, il est craindre que ce qui la lgitime soit oubli ; ce n'est que dans la gomtrie, ce n'est que dans la mcanique que l'algbre trouve sa signification. Si le but de la science tait d'ajouter des connaissances vraies l'entendement, peut-tre la science purement algbrique vaudrait-elle bien plus, ou tout au moins autant, que la science gomtrique et mcanique. Mais il n'en est pas ainsi ; l'entendement ne peut retirer aucun profit de la science ; nous savons tout quand nous savons que le monde est tendu. La fin de la science est toute autre ; elle est d'abord de rendre l'esprit humain matre, autant que possible, de cette partie de l'imagination que la perception laisse libre, puis de le mettre en possession du monde ; et peut-tre en regardant bien les deux fins ne font-elles qu'une. Cela est vrai mme de l'astronomie, pourvu qu'on comprenne ce que c'est que possder. Celles des dcouvertes de l'industrie qui, obtenues par le hasard ou par une technique aveugle, nous permettent de bouleverser le monde par des changements incomprhensibles pour nous-mmes nous donnent bien l'illusion d'une sorte de tyrannie ; mais c'est un pouvoir extrieur nous-mmes ; par ces innovations, le monde n'est pas plus nous qu'il n'tait auparavant. Au contraire, comme par le regard je m'empare du Panthon, de mme l'astronomie, sans nous donner aucun pouvoir effectif sur le ciel, le fait entrer pourtant dans notre royaume ; au point que ces astres, dont le pouvoir de l'humanit runie ne pourrait faire dvier le cours de l'paisseur d'un cheveu, le pilote ose s'en servir comme de ses instruments.
Simone Weil, Sur la science (1966) 66
En fin de compte, la seule sagesse consiste savoir qu'il y a un monde, c'est--dire une matire que le travail seul peut changer, et que, l'esprit except, il n'y a rien d'autre. Mais pour faire apparatre l'univers, un pas suffit. Entre un pas et un pas je touche le monde mme. Entre un et deux je le pressens seulement ; aussi bien compter, n'est-ce que comprendre qu'on peut marcher, marcher d'une marche qui nous laisse o nous sommes. La sagesse que l'ai laborieusement cherche, la plus simple perception la contient. L'ordre que j'ai cru devoir suivre n'a-t-il donc aucun sens, puisque moi-mme, puisque tout homme, mme le moins mditatif, sans avoir dout de tout, sans avoir, de sa pense, conclu sa propre existence comme la seule chose sre, sans avoir pens Dieu ni cherch de raisons pour croire une existence trangre lui, ni rflchi au mouvement, la gomtrie, l'tendue, possde cette sagesse que j'ai cru n'atteindre qu'aprs toutes ces prparations ? Il n'en est pas ainsi. En un clair, l'esprit qui s'arrache ce qu'il sent se retranche en soi-mme et agit ; le pilote qui dans la tempte dirige le timon, le paysan qui balance sa faux, se sait soimme et sait le monde de la manire qu'exprime la parole : Je pense, donc je suis avec son cortge d'ides. Les travailleurs savent tout ; mais, hors du travail, ils ne savent pas qu'ils ont possd toute la sagesse. Aussi, hors de l'action efficace, dans les moments o le corps, dans lequel les perceptions passes se sont inscrites, dispensent le corps d'explorer, la pense humaine se trouve-t-elle livre aux passions, l'imagination qui fait surgir les dieux, aux discours d'apparence plus ou moins raisonnable qui sont reus d'autrui. C'est pourquoi l'homme a besoin de la science, pourvu qu'au lieu d'imposer ses preuves elle soit enseigne de la manire que Descartes nommait analytique, c'est--dire de sorte que chaque colier suivant le mme ordre que s'il inventait lui-mme mthodiquement, puisse tre dit moins recevoir l'instruction que s'instruire lui-mme. La science ainsi conue, en rduisant un systme de machines le ciel, la terre, toutes choses, et l'imagination mme sous le nom de corps humain, ajoutera pour chacun une connaissance, une seule, la connaissance que renferme le travail percevant, savoir que celle-ci contient tout et qu'il n'y a rien d'autre.
Simone Weil, Sur la science (1966) 67
Conclusion
Retour la table des matires
Cette aventureuse suite de rflexions une fois termine, il apparat qu'elle s'carte de la doctrine cartsienne au point de sembler parfois y contredire. Il serait tonnant pourtant qu'une pareille esquisse, si ttonnante, si insuffisante soit-elle, du seul fait qu'elle imite le mouvement de la pense cartsienne sans la suivre, ne l'clairt pas dans une certaine mesure. Peut-tre permettra-t-elle en effet d'entrevoir comment peuvent se rsoudre les contradictions apparentes prcdemment releves dans Descartes, et quelques autres difficults. On peut comprendre pourquoi le mouvement est dit, dans le Monde, tre une notion plus simple que la figure ; comment se rattache cette ide l'invention de la gomtrie analytique, comment c'est par suite en devenant aussi concrte que possible que la gomtrie a pris l'apparence d'une extrme abstraction, et comment c'est par un mme acte de l'esprit que Descartes a identifi la gomtrie, d'une part l'algbre, d'autre part la physique. Par malheur, Descartes a rendu obscur dessein l'expos de sa dcouverte gomtrique ; mais, du moins, sa Gomtrie fait-elle voir qu'il a voulu rie des lignes gomtriques, qu'il n'a pu d'ailleurs qu'baucher, et en deux manires diffrentes, mais que Lagrange devait construire en ses immortels travaux. L'on voit d'autre part comment c'est la mme innovation qui a rduit la physique la gomtrie, et qui l'a fonde sur des comparaisons avec les phnomnes que nous rendent familiers l'exprience courante et les plus communs travaux ; comment aussi, chose qui a tonn les contemporains, Descartes, tout en imaginant toujours des mouvements, a cru devoir, pour restreindre l'extrme la part d'esprit que la physique est force de sembler attribuer au monde, n'admettre autant que possible que de simples impulsions ; pourquoi enfin, aprs avoir fond toute sa physique sur le mouvement, il la ruine en apparence en posant le mouvement comme purement relatif. Il apparat aussi qu'il n'y a nulle contradiction, au contraire, rduire l'imagination au corps humain, et en faire, pour tout ce qui concerne le monde, l'unique instrument de
Simone Weil, Sur la science (1966) 68
la connaissance. On voit que les ides simples peuvent, la fois tre rapportes l'esprit et considres comme lois du monde, s'il est vrai qu'elles expriment, non le monde ni l'esprit, mais le passage que le monde laisse l'esprit ; on voit aussi pourquoi on peut les dire cres par Dieu, puisque le rle de Dieu mon gard consiste rpondre en quelque sorte de l'union de l'me avec le corps. Les grandes corrlations, qui forment le nud de la doctrine, apparaissent ; il n'y a plus de contradiction entre libert et ncessit, entre idalisme et ralisme. Pour cette dernire opposition, il suffit, pour n'tre plus arrt par elle, de remarquer que tout l'esprit est en acte dans l'application de la pense un objet. C'est pourquoi Descartes ose dire, en contradiction directe avec la manire dont la philosophie couramment enseigne dfinit la dduction, que c'est le propre de notre esprit, de former les propositions gnrales de la connaissance des particulires . (Rponses aux Secondes Objections, 1X, p. 111). Aussi se contente-t-il, dans les Regulae, pour expliquer les quatre oprations arithmtiques, de ces preuves intuitives que Poincar a cru devoir remplacer par des raisonnements analytiques. C'est par cette vue concernant l'esprit que les ides claires et distinctes apparaissent comme infaillibles, et la science comme uniformment simple, claire et facile, si loin qu'elle s'tende. Car elle ne fait que crer des sries o chaque ide soit aussi facile saisit d'aprs la prcdente que la premire par elle-mme ; autrement dit il n'y a pas d'autre ordre que celui qui rgle la suite des nombres, et fait qu'on pense mille aussi facilement que deux. Enfin l'on comprend que, conformment cette mme vue, lorsque l'esprit s'applique au monde, il prenne pour intermdiaires des figures gomtriques et des signes algbriques, ou bien des sensations, c'est toujours le mme esprit, le mme monde, la mme connaissance ; et c'est ce que Descartes, en tous ses crits, fait assez clairement entendre. Ce n'est pas que les ides formes au cours de cette hasardeuse reconstruction puissent prtendre tre les ides mmes de Descartes, ou mme leur ressembler. Il suffit qu'une telle bauche non pas mme commente, mais permette seulement d'aborder nouveau et plus fructueusement les textes mmes. Aussi ne peut-on mieux la
Simone Weil, Sur la science (1966) 69
conclure qu'en invoquant, comme Descartes pour justifier sa Dioptrique, l'exemple des astronomes qui, bien que leurs suppositions soient presque toutes fausses et incertaines, toutefois... ne laissent pas d'en tirer plusieurs connaissances trs vraies et trs assures .
Simone Weil, Sur la science (1966) 70
Sur la science [crits publis entre 1932 et 1942.]
(1932-1942)
Retour la table des matires
Simone Weil, Sur la science (1966) 71
Sur la science [crits publis entre 1932 et 1942.] (1932-1942)
Lettre un camarade
Cher camarade,
Retour la table des matires
Comme rponse l'enqute que vous m'envoyez concernant l'enseignement historique des sciences, je ne peux que vous raconter une exprience que j'ai faite cette anne 28 dans ma classe (classe de philosophie au lyce de jeunes filles du Puy). Mes lves, comme la plupart des lves, ne regardaient les diverses sciences que comme des sommes de connaissances mortes, dont l'ordre est celui que donnent les manuels. Elles n'avaient aucune ide, ni de la liaison entre les sciences, ni des mthodes qui ont permis de les crer. Bref on peut dire que ce qu'elles savaient des sciences constituait le contraire d'une culture. Cela me rendait trs difficile l'expos de la partie du programme de philosophie intitule La mthode dans les sciences . Je leur ai expliqu que les sciences, ce n'taient pas des connaissances toutes faites tales dans les manuels l'usage des ignorants, mais des connaissances acquises au cours des ges par les hommes, au moyen de mthodes entirement distinctes des mthodes d'exposition qu'elles trouvaient dans les manuels. Je leur ai propos de leur faire quelques cours supplmentaires d'histoire des sciences. Elles ont accept, et les ont toutes suivis, sans que je les y oblige.
28 1931-1932.
Simone Weil, Sur la science (1966) 72
Je leur ai esquiss rapidement le dveloppement des mathmatiques, ordonn autour de l'opposition : continu, discontinu, et considr comme un effort pour ramener le continu au discontinu, la premire tape tant la mesure elle-mme. je leur ai racont l'histoire de la gomtrie grecque (triangles semblables [Thals et les pyramides] thorme de Pythagore - dcouverte des incommensurables, avec la crise qui en est rsulte - solution grce la thorie des proportions d'Eudoxe - dcouverte des coniques comme sections du cne - mthode d'exhaustion) et de la gomtrie du dbut des temps modernes (algbre - gomtrie analytique -principe du calcul diffrentiel et intgral). Je leur ai expliqu - ce que personne n'avait pris soin de leur dire - comment le calcul infinitsimal avait t la condition de l'application de la mathmatique la physique, et par suite de l'essor actuel de la physique. Tout cela a t suivi par toutes, mme les plus nulles en science, avec un intrt passionn, et s'est fait fort facilement en six ou sept heures supplmentaires. Le manque de temps et mes trop faibles connaissances ne m'ont pas permis d'en faire autant pour la mcanique et la physique ; je n'ai pu leur raconter que des fragments de l'histoire de ces sciences. Les lves auraient dsir en savoir plus. la fin de cette srie de leons, je leur ai lu l'enqute concernant l'enseignement historique des sciences, et toutes ont approuv avec enthousiasme le principe d'un tel enseignement. Elles disaient qu'un tel enseignement seul peut faire de la science, pour les lves, quelque chose d'humain, au lieu d'une espce de dogme qu'il faut croire sans jamais bien savoir pourquoi. Cette exprience conclut donc entirement, et tous les points de vue, en faveur de votre ide. Simone WEIL, professeur de philosophie au Lyce djeunes filles du Puy.
Simone Weil, Sur la science (1966) 73
Sur la science [crits publis entre 1932 et 1942.] (1932-1942)
L'enseignement des mathmatiques
Retour la table des matires
Je voudrais ici la fois dnoncer une conception qui, bien que commune beaucoup de rvolutionnaires, me parat dangereuse et fausse, et faire part mes camarades d'une exprience pdagogique personnelle. On sait que Bouasse, sous la forme violente et spirituelle qui lui est propre, a souvent rpt que les mathmatiques ne sont pour le physicien qu'un langage au moyen duquel il peut exprimer commodment les rsultats de l'exprience. Cette ide, qui se retrouve chez Henri Poincar et chez un grand nombre de philosophes bourgeois, est considre par Louzon comme ayant une valeur rvolutionnaire. Les articles de Barru et du camarade R... dans l'Universit syndicaliste montrent que syndicalistes rvolutionnaires et communistes orthodoxes sont d'accord pour juger bourgeois tout ce qui est purement thorique. La question mrite d'tre longuement examine. Pour l'instant, je veux me borner signaler que, si nous devons dnoncer, avec Marx, la honteuse division entre travail intellectuel et travail manuel , ce-
Simone Weil, Sur la science (1966) 74
la ne signifie nullement qu'il faille confondre thorie et pratique. La culture d'une socit socialiste raliserait la synthse de la thorie et de la pratique. Mais synthse n'quivaut pas confusion ; il n'y a synthse que de contraires. Historiquement, la science est ne le jour o l'on a momentanment abandonn le souci des applications. C'est la Grce qui a cr la science, et non point l'gypte. Toute notre culture, sans en excepter le marxisme, repose sur le miracle grec , c'est-dire sur une civilisation qui, ct de ses merveilleuses dcouvertes thoriques, est reste tout fait stationnaire du point de vue de la technique. Le Moyen ge au contraire a t, du point de vue technique, une priode de progrs d'une importance capitale, comme l'a rcemment montr Lefebvre des Nouttes ; mais les thomistes euxmmes ne peuvent nier que les progrs de la science aient t alors peu prs nuls. La Renaissance a t avant tout une renaissance de la culture scientifique. cette poque, c'est--dire l'aurore du rgime capitaliste, une liaison a t, pour la premire fois, tablie entre la thorie et l'application. Mais Descartes, dont on ne peut contester le rle capital dans le dveloppement de la science, loin de considrer la mathmatique comme un langage propre faire des rsums commodes, la considrait comme un principe d'explication, seul susceptible de permettre une mainmise mthodique de l'homme sur les forces naturelles. De nos jours, il est vrai, s'il faut en croire Bouasse, on tablit la valeur d'une proposition mathmatique par les mmes procds que l'excellence d'une passe de football ; mais il reste savoir si ce n'est pas l la marque d'une dcadence de la culture, dcadence qui serait un des effets du rgime o nous vivons. Il faut remarquer que Marx a pour principal titre de gloire d'avoir soustrait l'tude des socits non pas simplement aux constructions utopiques, mais aussi, et du mme coup, l'empirisme. Il me parat vident que, dans l'tude que Marx a faite de la socit, les rapports entre l'analyse thorique, l'exprience et l'application font penser beaucoup plus la conception que se faisait Descartes de la science qu' la conception de Henri Poincar ou de Bouasse. Le progrs de l'humanit ne consiste pas transporter dans l'tude thorique les procds de routine aveugle et d'exprience errante qui ont si longtemps domin la production. C'est l pourtant tout ce que la science actuelle semble capable de faire, si l'on en juge d'aprs ce que disent les savants. Le progrs consisterait transporter, autant qu'il est
Simone Weil, Sur la science (1966) 75
possible, dans la production elle-mme, ce que l'humanit n'a d'abord trouv que dans les spculations purement thoriques, et compltement abstraites des applications ; savoir la mthode. Descartes, qui aurait voulu fonder une universit ouvrire o chaque ouvrier aurait acquis les notions thoriques ncessaires pour comprendre son propre mtier, tait plus proche de l'ide marxiste de division dgradante du travail en travail intellectuel et travail manuel que ceux qui, aujourd'hui, se rclament de Marx. Certes c'est seulement par son rapport aux applications que la science a une valeur. Mais d'autre part - et c'est ce que devraient comprendre facilement tous ceux qui se disent dialecticiens - le rapport vritable entre thorie et application n'apparat qu'une fois que la recherche thorique a t purifie de tout empirisme. L'exprience pdagogique que je dsire soumettre mes camarades se rapporte l'enseignement historique des sciences prconis avec raison par Langevin et plusieurs autres. tant professeur de philosophie, j'ai profit de ce que le programme comporte l'examen de la mthode en mathmatiques pour consacrer une douzaine d'heures lhistoire des mathmatiques, prsente comme tant oriente vers une rsolution de la contradiction fondamentale entre continu et discontinu (nombre). En voici une esquisse trs sommaire. La premire tape est la mesure des longueurs. La seconde est le thorme attribu par la lgende Thals concernant la similitude des triangles ; la combinaison de ce thorme avec celui de Pythagore qui en est la consquence directe permet de ramener tous les rapports de lignes des rapports de nombres. La dcouverte des incommensurables semble ruiner les fondements mmes de cette gomtrie. Eudoxe lui rend sa valeur, sur un plan suprieur, par sa thorie des proportions (quivalente notre thorie du nombre gnralis) et sa mthode de l'exhaustion (premire esquisse du calcul infinitsimal). En mme temps Mnechme, qui dcouvre la fois les coniques et leurs formules, fait entrevoir par l mme la possibilit de dfinir les lignes courbes par une loi, en les rapportant des droites. Archimde et Apollonius n'ont gure fait que dvelopper ces inventions, dont on ne pouvait cependant apercevoir encore la porte gnrale, faute d'un instrument
Simone Weil, Sur la science (1966) 76
indispensable, savoir l'algbre. On trouve dj dans Diophante comme une premire esquisse de l'algbre. Mais l'algbre proprement dite date de la Renaissance. Descartes s'en est servi pour donner toute leur porte aux dcouvertes de Mnechme et d'Apollonius ; Leibniz, Newton, Lagrange (et ce dernier seul d'une manire vraiment intelligible) ont fait le mme travail pour le calcul infinitsimal dont le principe avait t trouv par Eudoxe. Le caractre sommaire de mes connaissances mathmatiques m'empche malheureusement d'aller plus loin. Cette exprience a eu un plein succs, pdagogiquement parlant, en ce sens que l'expos a t compris de toutes les lves, y compris les plus mauvaises en mathmatiques, et les a toutes intresses jusqu' l'enthousiasme. Elles ont compris que les mathmatiques sont un produit de la pense humaine, et non un ensemble de dogmes. Quant la valeur d'une telle exprience, c'est aux camarades en juger. mon avis, l'enseignement de la science, pour constituer une culture, devrait comporter : 1 un enseignement pour une part au moins historique de chaque science, avec lecture de mmoires originaux, et, pour la physique, toutes les fois que ce sera possible, reproduction des expriences faites par les inventeurs ; 2 un enseignement de l'histoire des rapports entre la science et la technique ; 3 l'apprentissage et la pratique d'un mtier productif, li un enseignement plus dtaill de l'histoire de ce mtier dans son rapport avec la science et l'ensemble de la technique.
Simone Weil, Sur la science (1966) 77
Sur la science [crits publis entre 1932 et 1942.] (1932-1942)
Rponse une lettre d'Alain
Retour la table des matires
Je n'ai pas rpondu votre lettre, parce qu'il me semblait plus facile de le faire oralement ; mais, puisque l'occasion ne s'en prsente pas, je vais essayer quand mme d'crire trs brivement dans quel sens je voudrais m'orienter. Il me semble que tout ce qui s'est pass depuis trois sicles pourrait, si on voulait, se rsumer en ceci, que l'aventure de Descartes a mal tourn. C'est donc qu'il manque quelque chose au Discours de la Mthode. Quand on compare les Regulae la Gomtrie, on sent bien qu'il manque en effet beaucoup. Pour moi, voici la lacune que je crois y trouver. Descartes n'a pas dcouvert un moyen d'empcher l'ordre, aussitt conu, de devenir une chose au lieu d'une ide. L'ordre devient une chose, me semble-t-il, ds qu'on fait d'une srie une ralit distincte des termes qui la composent, en l'exprimant par un signe ; or l'algbre, c'est cela mme, et depuis le dbut (depuis Vite). Il n'y a qu'une manire de concevoir une srie sans la dtacher des termes, c'est l'analogie. (C'est l une de vos ides, n'est-ce pas ?) Seule l'analogie fournit la possibilit de penser d'une manire la fois absolument pure et absolument concrte. On ne pense que des choses particulires ; on ne raisonne que sur l'univer-
Simone Weil, Sur la science (1966) 78
sel ; la science moderne a perdu son me en voulant rsoudre cette contradiction par l'artifice qui consiste ne plus raisonner que sur des signes conventionnels, qui sont des objets particuliers en tant que marques noires sur du papier blanc, et sont universels par leur dfinition. L'autre solution serait l'analogie. J'entrevois ainsi une nouvelle manire de concevoir la mathmatique, d'un point de vue aussi matrialiste et pour ainsi dire aussi cynique que possible, comme consistant purement et simplement en des combinaisons de signes ; mais sa valeur thorique et sa valeur pratique, qui ne seraient plus distinctes, rsiderait dans des analogies, qu'il faudrait arriver concevoir clairement et distinctement, entre ces combinaisons et les problmes concrets auxquels on les applique dans le cours de la lutte livre par l'homme l'univers. Les signes seraient alors rabattus leur rang de simples instruments, rang que Descartes essayait de leur assigner dans les Regulae. Leur vritable destination apparatrait, savoir : servir non l'entendement, mais l'imagination ; et le travail scientifique apparatrait comme tant en somme un travail d'artiste, consistant assouplir l'imagination. Paralllement, il s'agirait de tirer au clair et de dvelopper au maximum la facult de concevoir des analogies sans manier les signes algbriques. On se trouve l dans le domaine de la perception. Seulement la perception de l'oisif, qui se meut l'aise au milieu d'une matire que d'autres ont prpare pour la lui rendre commode, est peu de chose ; c'est la perception de l'homme au travail qu'il faudrait s'intresser, ce qui implique une tude approfondie des instruments de travail, non plus d'un point de vue technique, c'est--dire quant leur rapport avec la matire, mais quant leur rapport avec l'homme, avec la pense humaine. Il faudrait tirer au clair et ordonner en sries tous les rapports impliqus dans le maniement de tous les instruments de travail, que ces rapports soient confusment aperus par ceux qui les manient, ou aperus clairement par quelques privilgis placs plus haut dans la hirarchie du travail (dans l'industrie, deux ou trois ingnieurs par entreprise, peut-tre), ou, ce qui doit arriver souvent, aperus par personne. Au point de rencontre de ces deux sries d'efforts critiques se trouverait une physique vritable, ou du moins la partie de la physique qui concerne les phnomnes qui sont matire du travail humain ; il y aurait construire ct de cette physique, et par analogie avec elle, mais sur un plan bien distinct, l'tude des phnomnes qui ne sont qu'objets de contemplation.
Simone Weil, Sur la science (1966) 79
Vous excuserez, j'espre, la confusion, le dsordre, et aussi l'audace de ces embryons d'ides. S'ils ont une valeur quelconque, leur dveloppement ne peut videmment s'oprer que dans le silence. Mais ce dveloppement supposerait nanmoins - malheureusement - un travail collectif que je verrais ainsi. D'abord un bilan des applications de la mathmatique, ou plutt des diverses formes de calcul mathmatique, prises une par une, bilan dress, bien entendu, dans la mesure du possible, en se rfrant non pas simplement au moment prsent, mais au dveloppement de la science et de la technique dans l'histoire des trois ou quatre derniers sicles pour le moins. Ensuite des monographies concernant les mtiers, portant toutes sur le mme thme, savoir : quelle est au juste l'activit de la pense qu'implique la fonction d'un manuvre sur machines - d'un manuvre spcialis - d'un tour neur - fraiseur - etc. professionnel - d'un chef d'atelier - d'un dessinateur - d'un ingnieur d'usine - d'un directeur d'usine, etc., et de mme pour les mines, le btiment, les champs, la navigation et le reste. Inutile de dire qu'en concevant ce programme, je ne me fais aucune illusion sur les possibilits de ralisation. Enfin, je souhaiterais des ouvrages pdagogiques qui appliqueraient ds maintenant, la formation des esprits, cette mthode que j'entrevois, fonde sur l'analogie. Cela, je n'ai gure eu le loisir d'y penser ; mais j'ai rv parfois d'un manuel de physique pour coles primaires, o l'interprtation des phnomnes naturels serait exclusivement prsente sous l'aspect d'analogies successives, de plus en plus exactes, et cela en partant de la perception conue comme une tape de la connaissance scientifique. Ainsi, pour la lumire, on commencerait par la liste de tous les cas o la lumire se comporte comme quelque chose d'analogue un mouvement, pour passer ensuite l'analogie avec un mouvement rectiligne, l'analogie avec les ondes... J'en suis reste, jusqu'ici, ces vagues rveries. Mais M. m'a dit qu'un manuel de physique pour coles primaires tait un de vos projets. J'ignore comment vous le concevez, mais j'imagine que je peux un peu me le reprsenter d'aprs quelques pages des Entretiens au bord de la mer. Je regrette infiniment que ce ne soit encore qu'un projet. Restent les questions sociales. L encore, je verrais avant tout des monographies concernant les diverses fonctions sociales, conues bien entendu comme des fonctions dans la lutte contre la nature, leurs rap-
Simone Weil, Sur la science (1966) 80
ports rciproques, leur rapport avec l'oppression sociale. Ici aussi c'est surtout des bilans que je voudrais voir dresser. Par exemple, une tude sur tout ce qu'au moment actuel le travail des champs doit l'industrie, ou, en d'autres termes, le bilan de tout ce que la culture, sous sa forme actuelle, perdrait si la grande industrie se trouvait supprime du jour au lendemain. Une srie d'tudes concernant les diverses formes actuelles de la proprit, en fonction de cette ide que la proprit relle est le pouvoir de disposer des biens. Et beaucoup de choses encore que je n'ai pas en ce moment prsentes l'esprit. Vous m'avez demand un plan de travail, et je ne vous ai rpondu que par des aperus nuageux et des ambitions dmesures. J'ignore si on peut faire quelque chose de rel, comme une revue, partir de tout cela. Ce que j'aimerais, c'est pouvoir lancer un appel tous ceux qui savent ou font effectivement quelque chose, et qui il ne suffit pas de savoir ou de faire, mais qui veulent rflchir sur ce qu'ils savent et font !
Simone Weil, Sur la science (1966) 81
Sur la science [crits publis entre 1932 et 1942.] (1932-1942)
Fragment d'une lettre un tudiant
(Paris, 1937)
Retour la table des matires
... aussitt rentre, je me suis jete sur Louis de Broglie. J'ose peine avouer que cela m'a fait une impression mlange. Son intuition de gnie consiste, il me semble, essentiellement avoir aperu que l'apparition de nombres entiers dans les phnomnes atomiques, depuis la dcouverte sensationnelle de Planck sur les mouvements stables des lectrons, implique quelque chose d'analogue des interfrences d'ondes. Cette intuition a t confirme notamment par la prodigieuse exprience de la diffraction des lectrons au moyen de cristaux ou de rseaux optiques. Tout cela, c'est de la physique et de la plus belle. Quant considrer la notion d'onde comme une notion premire concernant la structure de la matire, ne serait-ce pas absurde ? L'on ne pense une onde qu'au moyen des notions de choc et de pousse, appliques aux fluides. Rappelez-vous la comparaison de Huyghens avec ses billes d'agate, au dbut de son admirable mmoire. ( ce propos, celui de Fresnel aussi est prodigieusement intressant.) D'autre part, l'image des ondes et celle des corpuscules sont inconciliables ; qu'y a-t-il l d'extraordinaire ? Cela montre qu'il faudrait laborer une troisime image o soient groupes les analogies reprsentes par les deux autres. Quand ce serait impossible, je ne trouve pas si choquant qu'on doive se rfrer deux images incompatibles pour
Simone Weil, Sur la science (1966) 82
rendre compte d'un phnomne, les images ne faisant jamais que reprsenter des analogies d'une manire sensible au cur , comme dirait Pascal. Par ailleurs, la mcanique quantique aboutit des formules o se trouvent des termes ne satisfaisant pas la rgle de commutativit de la multiplication. Dans l'imagerie de la mcanique ondulatoire, ce phnomne mathmatique bizarre apparat comme correspondant la dualit entre l'aspect ondes et l'aspect corpuscules de la matire. De toute manire, on admet que cette non-commutativit correspond l'impossibilit de mesurer simultanment et d'une manire exacte deux grandeurs. (D'aprs l'interprtation ondulatoire position et vitesse.) On exprime cette impossibilit par des relations d'incertitude . Je cherche en vain ce qui, dans tout cela, porte atteinte au dterminisme. Que nous soyons incapables de dterminer par des mesures ces deux grandeurs la fois, est-ce dire que ces grandeurs soient en soi indtermines ? La question mme n'a pas de sens. Veut-on tablir qu'il nous est impossible de possder les donnes ncessaires pour concevoir concrtement la nature comme dtermine ? Mais cela, le simple bon sens a toujours permis de le reconnatre. Sans rien savoir en physique, on peut comprendre que nous ne possdons en aucun cas les donnes des problmes auxquels nous essayons de rduire les phnomnes naturels. Pour tudier un phnomne quelconque, nous liminons par abstraction d'une part tout ce qui se passe autour, d'autre part tout ce qui se passe une chelle plus petite, imaginant ainsi comme un double vase clos auquel nous ne croyons pas nous-mme, car nous savons que la notion mme de dterminisme implique l'impossibilit de dcouper quelque chose dans la nature. Notamment nous savons trs bien que le fait mme d'observer et de mesurer modifie la chose observe et mesure. Nous convenons de considrer ces modifications comme ngligeables (mot qui n'a thoriquement aucune signification), mais il tait clair d'avance qu' mesure qu'on descendrait dans l'chelle des grandeurs, on s'approcherait d'une limite o on ne pourrait plus les ngliger . Il est dj bien beau de pouvoir mesurer mathmatiquement l'imperfection de nos mesures. On peut imaginer une chelle encore beaucoup plus petite que l'chelle atomique d'autres corpuscules dont nous ne connatrons sans doute jamais ni les positions ni les vitesses ; et l'intrieur de ceux-l.... etc. Le dterminisme n'a jamais t pour la science qu'une
Simone Weil, Sur la science (1966) 83
hypothse directrice, et il le restera toujours. De Broglie introduit la probabilit dans sa description des phnomnes, mais cela n'implique nullement que nous devions substituer la probabilit la ncessit dans notre conception des phnomnes ; au contraire, nous ne pensons la probabilit que lorsqu'il se pose devant nous un problme dont nous pensons que la solution est strictement dtermine par les donnes, mais dont nous ignorons certaines donnes. Depuis longtemps (car on parle de ces choses depuis des annes), je cherche en vain ce que les relations d'incertitude de de Broglie peuvent avoir de rvolutionnaire pour notre conception gnrale de la science. Pour leur attribuer ce caractre, il faut qu'on ait tout fait perdu la notion de ce qu'est la science. Une chose qui me choque bien plus, c'est cette constante de Planck qui apparat dans toutes les expressions mathmatiques, et que personne ne sait traduire en termes physiques. Si quelqu'un y arrive, c'est lui qui aura accompli la synthse entre les deux hypothses de l'ondulation et de la projection, non de Broglie. Pour bien des raisons, je crois comme vous que la science entre dans une priode de crise plus grave qu'au Ve sicle, et comme alors, accompagne d'une crise de la morale et de l'agenouillement devant les valeurs purement politiques, c'est--dire devant la force. Le phnomne nouveau de l'tat totalitaire rend cette crise infiniment redoutable, et risque d'en faire une agonie. C'est pourquoi il y a pour moi, parmi les hommes, d'un ct ceux qui pensent et aiment (combien de fois, en Italie, la lecture des affiches ne m'a-t-elle pas vivement remis en mmoire le beau vers de Sophocle, prononc par Antigone : Je suis ne pour partager l'amour et non la haine ), de l'autre ceux qui inclinent leur pense et leur cur devant la puissance dguise en ides. Si notre poque est celle d'une crise de la science comparable celle du Ve sicle, il en rsulte un devoir vident : refaire un effort de pense analogue celui d'Eudoxe.
Simone Weil, Sur la science (1966) 84
Sur la science [crits publis entre 1932 et 1942.] (1932-1942)
La science et nous
Retour la table des matires
Il s'est pass pour nous, gens d'Occident, une chose bien trange au tournant de ce sicle ; nous avons perdu la science sans nous en apercevoir, ou tout au moins ce que depuis quatre sicles on appelait de ce nom. Ce que nous possdons sous ce nom est autre chose, radicalement autre chose, et nous ne savons pas quoi. Personne peut-tre ne sait quoi. Le grand public s'est aperu de quelque chose de singulier vers 1920, propos d'Einstein, et bien entendu a admir, car n'est-il pas convenu que notre sicle est admirable ? Mais la thorie de la relativit n'a rien eu renverser, car vers 1900 celle des quanta avait dj tout renvers. D'ailleurs, si bizarre que soient l'application d'une gomtrie non euclidienne, la courbure de l'espace, le temps considr comme dimension, une vitesse la fois infinie et mesurable, du moins la notion qui a donn son nom la thorie d'Einstein, l'ide que mouvement et repos ont un sens seulement par rapport un systme de rfrence, n'est ni nouvelle ni trange ; elle se trouve dans Descartes, et si Newton l'a repousse, ce n'tait pas comme une absurdit vidente. Il en est tout autrement des quanta d'nergie. La thorie des quanta marque une rupture dans l'volution de la science de deux manires. Elle marque, d'abord, le retour du discontinu. Le nombre, autant qu'on peut savoir, fut d'abord le seul objet auquel s'appliqut la mthode mathmatique ; l'tude en avait t pousse si loin qu'un adolescent babylonien d'il y a quatre mille ans savait
Simone Weil, Sur la science (1966) 85
peu prs autant d'algbre qu'un lycen franais d'aujourd'hui, mais cette algbre consistait en quations numriques. D'ailleurs certains noncs de problmes -l'un d'eux parle d'une somme de deux nombres dont l'un est un nombre de jours, l'autre un nombre d'ouvriers - semblent indiquer que l'algbre tait alors ce qu'elle est aussi aujourd'hui dans certains esprits, un maniement de rapports de pure convention, non pas une connaissance du monde ; le monde ne fournit jamais de telles donnes. Autant que nous sachions, c'est en Grce, au VIe sicle, que la mthode mathmatique sortit du nombre et s'appliqua au monde, et cela en prenant pour objet le continu. Que ce changement d'objet ait t conscient de la part des Grecs, nous en avons pour marque le fait que, jusqu' une poque trs tardive, jusqu' Diophante, ils ont toujours feint d'ignorer l'algbre et ses quations ; ils n'admettaient les relations algbriques qu'habilles en propositions gomtriques. L'pinomis dfinit la gomtrie comme une assimilation des nombres qui ne sont pas semblables entre eux naturellement, assimilation rendue vidente grce aux proprits des figures planes ; c'est la dfinir comme la science du nombre gnralis, c'est--dire de la quantit, exprimable ou non exprimable en nombres et fractions. L'expression de nombres semblables semble indiquer que la construction de triangles semblables, fondement de la gomtrie, constituait pour les Grecs une mthode pour chercher des proportions, et sans doute la construction du triangle rectangle, combinaison de triangles semblables, une mthode pour chercher des moyennes proportionnelles ; la proportion fut peuttre pour les Grecs le mobile des tudes gomtriques, car la plupart de leurs dcouvertes peuvent se grouper autour de deux problmes, la recherche d'une moyenne proportionnelle entre deux nombres, la recherche de deux moyennes proportionnelles entre deux nombres. Platon poussa rsoudre le second et ne put s'empcher de clbrer sans cesse la solution du premier avec une singulire exaltation. Quoi qu'il en soit, les Grecs du dbut du IVe sicle possdaient la thorie complte du nombre gnralis, sous la forme la plus rigoureuse, et une conception parfaitement prcise du calcul intgral. Comme les lignes reprsentes par les figures de la gomtrie sont toujours en mme temps des trajectoires de mouvements, leur gomtrie constituait pour eux la science de la nature ; Dieu est un perp-
Simone Weil, Sur la science (1966) 86
tuel gomtre. l'quation de l'algbre babylonienne se substituait la notion de fonction, me de toute connaissance scientifique. L'usage des lettres pour reprsenter, non pas des nombres entiers ou fractions quelconques, mais des nombres quelconques au sens du nombre gnralis, permit la Renaissance de conserver, en mme temps que l'hritage de la Grce, celui des Babyloniens transmis travers Diophante, les Hindous, les Arabes ; la forme de l'quation servit exprimer la fonction, le calcul diffrentiel et intgral dcoula de l immdiatement ; et l'algbre cre par la Renaissance, quivalent moderne de la gomtrie grecque, expression comme elle des combinaisons entre grandeurs continues analogues aux distances, joua le mme rle comme instrument pour la connaissance de la nature. Les sries de Fourier concernant la chaleur en sont un brillant exemple. Mais l'esprit humain ne peut s'en tenir ni au nombre ni au continu ; il va de l'un l'autre, et quelque chose dans la nature rpond l'un et l'autre, sans quoi l'homme tel qu'il est, l'homme qui pense toujours le nombre et l'espace, ne pourrait pas vivre. Au cours et surtout vers la fin du XIXe sicle, le discontinu s'imposa de nouveau la pense scientifique dans toutes les branches de la science. En mathmatique, les groupes et tout ce qui en procde, l'extension de l'arithmtique et ses rapports nouveaux avec l'analyse ; en physique les atomes, la thorie cintique des gaz, les quanta ; toutes les lois chimiques ; en biologie, les mutations ; ce sont l autant de marques du retour de la science au discontinu. Ce retour, tape d'un balancement invitable entre deux notions corrlatives, n'a rien que de naturel ; ce qui est, sans exagration, contraire la nature, c'est l'usage du discontinu dans la physique contemporaine, lorsqu'on divise en atomes l'nergie, qui n'est pas autre chose qu'une fonction de l'espace. Par l ce qu'en 1900 on appelait encore la science, ce qu'il faut appeler aujourd'hui la science classique, a disparu, car on en a supprim radicalement la signification. Les savants qui se sont succd depuis la Renaissance jusqu' la fin du XIXe sicle n'ont pas fait effort simplement pour accumuler des expriences ; ils avaient un objet ; ils poursuivaient une reprsentation de l'univers. Le modle de cette reprsentation, c'est le travail, ou plus exactement la forme lmentaire, grossire du travail, celle o l'habitude, le savoir-faire, le tour de main, l'inspiration n'interviennent pas,
Simone Weil, Sur la science (1966) 87
le travail de manuvre, la manutention. Entre un dsir quelconque et la satisfaction de ce dsir, il y a pour nous une distance qui, en un sens, est le monde mme ; si je dsire voir sur la table un livre qui est sur le plancher, je n'aurai pas satisfaction avant que j'aie ramass le livre et l'aie soulev de toute la hauteur qui spare la table du plancher. Si l'on considre un plan horizontal plac entre celui de la table et celui du plancher, en aucun cas, quoi qu'il arrive, quelque vnement qui se produise parmi l'infinit des possibles, le livre ne sera sur la table sans avoir travers ce plan. Je puis m'pargner le poids du livre en arrachant page aprs page, et ne soulever ainsi qu'une page ; mais je devrai alors recommencer autant de fois qu'il y a de pages dans le livre. Qu'on imagine ma place un idiot, un criminel, un hros, un sage, un saint, cela ne fera aucune diffrence. L'ensemble des ncessits gomtriques et mcaniques auxquelles une telle action est toujours soumise constitue la maldiction originelle, celle qui a chti Adam, celle qui fait la diffrence entre l'univers et un paradis terrestre, la maldiction du travail. La science classique, celle que la Renaissance a suscite et qui a pri vers 1900, a tent de reprsenter tous les phnomnes qui se produisent dans l'univers en imaginant, entre deux tats successifs d'un systme constats par l'observation, des intermdiaires analogues ceux par lesquels passe un homme qui excute un travail simple. Elle a pens l'univers sur le modle du rapport entre une action humaine quelconque Il n'est pas question, bien entendu, d'imaginer des volonts l'uvre derrire les phnomnes de la nature, car il s'agirait de volonts non analogues celles des hommes, non lies des corps, surnaturelles, c'est--dire dispenses des conditions du travail ; ainsi, pour tablir une analogie entre les phnomnes de la nature et le travail, il faut ncessairement liminer du travail un des termes qui le dfinissent et sans lequel il ne peut tre conu. Il est vrai, la loi du travail qui rgle la vie humaine est la loi de l'action indirecte par laquelle chaque tape de l'excution est indpendante de la prcdente et de la suivante, indiffrente au dsir et au rsultat espr ; si je veux soulever une pierre trs lourde, j'y russirai non en soulevant, mais en abaissant quelque chose, condition que ce quelque chose soit un levier. travers un tel enchanement d'intermdiaires auxquels mon dsir est extrieur, je touche le monde, et je le pense sur le modle d'une telle chane d'intermdiaires, mais d'intermdiaires purs qui ne
Simone Weil, Sur la science (1966) 88
sont intermdiaires entre rien. Du moins j'essaie de le penser ainsi, mais je ne puis russir tout fait concevoir un travail sans travailleur, un obstacle qui ne s'oppose aucune action, des conditions qui ne sont les conditions d'aucun projet. C'est pourquoi il se trouve une obscurit impntrable - on peut s'en convaincre mme en parcourant un manuel scolaire - dans les notions simples et fondamentales de la mcanique et de la physique, repos, mouvement, vitesse, acclration, point matriel, systme de corps, inertie, force, travail, nergie, potentiel. Nanmoins la science classique parvint enfin soumettre toute tude d'un phnomne de la nature une notion unique, directement drive de celle de travail, la notion d'nergie. Ce fut le rsultat de longs efforts. Lagrange, s'appuyant sur ce qu'avaient trouv les Bernoulli et d'Alembert, et au moyen du calcul diffrentiel, parvint dfinir par une formule unique tous les tats possibles d'quilibre ou de mouvement de n'importe quel systme de corps soumis des forces quelconques, formule qui n'a rapport qu' des distances et des forces - ou, ce qui revient au mme, des masses et des vitesses -, c'est-dire quelque chose d'analogue au poids ; de l Maxwell, en un clair de gnie, conclut que si l'on peut imaginer un modle mcanique d'un phnomne, on peut en imaginer une infinit. Il est sous-entendu qu'ils sont tous gaux en valeur explicative. Ds lors il est inutile d'en imaginer mme un ; il suffit d'tablir qu'il est possible d'en imaginer. La notion d'nergie, fonction de la distance et de la force, ou encore de la masse et de la vitesse, mesure commune de tous les travaux, c'est-dire de toutes les transformations analogues l'lvation ou la chute d'un poids, en fournit le moyen ; la formule unique de la dynamique exprime que d'un tat d'un systme un autre tat la variation de cette fonction est nulle si aucune force extrieure ce systme n'est intervenue. Appliquer une telle formule un phnomne, c'est tablir qu'il est possible d'imaginer pour ce phnomne un modle mcanique. Ainsi on ne se proccupe plus des intermdiaires, on pose seulement que le rapport entre deux tats successifs exprimentalement constats d'un systme est identique ou quivalent au rapport entre le point de dpart et l'aboutissement d'un travail humain ; et pour chaque espce de phnomnes on cherche tablir des quivalences numriques entre certaines mesures prises au cours des expriences, d'une part, d'autre part les distances et les poids qui constituent pour l'homme les obs-
Simone Weil, Sur la science (1966) 89
tacles du travail. La notion de travail est toujours prsente, puisque l'nergie se mesure toujours en distances et en poids ; et bien que la force soit une fonction de la masse et de l'acclration, et non pas quelque chose de semblable un effort, la place tenue par l'acclration dans les formules vient de la contrainte de la pesanteur sur toute action humaine. La science du XIXe sicle consista dterminer, dans plusieurs espces de phnomnes, des quivalences numriques avec des distances et des poids, comme fit joule, le premier, pour la chaleur. Elle fit autre chose encore, elle inventa une notion nouvelle en traduisant, pour l'appliquer l'nergie, la ncessit qui, avec celle de travailler, pse le plus lourdement sur la vie humaine. Cette ncessit tient au temps lui-mme et consiste en ce qu'il est dirig, en sorte que, quoi qu'il arrive, le sens d'une transformation n'est jamais indiffrent. Nous prouvons cette ncessit, non seulement par la vieillesse qui nous treint lentement et ne nous lche jamais, mais par les vnements de chaque journe. Un moment et un effort peu prs aussi petits qu'on veut peuvent suffire parfois pour jeter un livre d'une table, mlanger des papiers, tacher un vtement, froisser du linge, brler un champ de bl, tuer un homme. Il faut des efforts et du temps pour soulever le livre jusqu' la table, mettre en ordre les papiers, nettoyer le vtement, repasser le linge ; un an de peine et de soins est ncessaire pour faire apparatre une autre moisson dans le champ ; on ne ressuscite pas un homme mort, et pour faire surgir dans le monde un homme nouveau, il faut vingt annes. Cette ncessit qui nous enchane troitement se reflte dans la contrainte sociale, par le pouvoir qu'elle procure ceux qui savent brler des champs et tuer des hommes, choses rapides, sur ceux qui savent faire surgir le bl et lever les enfants, choses lentes. Or l'espace ne l'exprime d'aucune manire, lui qui est indiffrent toutes les directions. Le poids non plus ne l'exprime pas, car les poids de la dynamique sont des poids lastiques qui ne tombent jamais sans rebondir ; il faut qu'ils soient tels pour l'expression de la ncessit essentielle du travail humain, transporte par le physicien dans la nature, savoir que rien au monde ne peut en dispenser. Mais ds lors il faut ajouter quelque chose la notion d'nergie, dfinie par les distances et les poids, pour exprimer la condition de toute action humaine. Il faut ajouter que toute transformation a un sens qui n'est pas indiffrent. Mais il faut le dire en une formule algbrique, dans le
Simone Weil, Sur la science (1966) 90
langage de la mathmatique applique la physique. Clausius y parvint, et inventa ainsi ce qu'on nomme l'entropie. On pose que dans tout phnomne il se produit une transformation de l'nergie, telle qu'il ne se trouve aucun moyen quoi qu'il arrive, une fois le phnomne achev, de rtablir exactement partout l'tat initial. On traduit ce principe par la fiction d'une grandeur qui, dans tout systme o a lieu un changement, augmente toujours, sauf intervention de facteurs extrieurs ; seuls sont excepts les phnomnes purement mcaniques, non accompagns d'chauffement ou de refroidissement, mais il n'y en a pas. La recherche d'une formule algbrique pour cette grandeur est le triomphe le plus complet de la notion de limite trouve autrefois par Eudoxe en mme temps que le calcul intgral ; car il n'y est question que de limites. Puisqu'il s'agit de variations lies celles de la chaleur, on cherche un cas, bien entendu impossible, o un phnomne se produise sans qu'il y ait apport ou soustraction de chaleur, et o nanmoins la temprature joue un rle ; ce cas est fourni par les gaz parfaits, gaz qui n'existent pas, mais qui, contrairement ceux qui existent, peuvent se dilater sans changer de temprature, et par une compression infiniment lente obtenue au moyen d'une pression gale celle du gaz, chose videmment impossible, l'annulation d'une formule diffrentielle, puis une intgration, permettent d'obtenir une fonction de la temprature et du volume qui, parce qu'elle est constante, correspond par hypothse l'entropie. L'accroissement de l'entropie est fonction de l'accroissement de l'nergie, de l'accroissement du volume, de la pression, de la temprature et de la masse ; ou encore il est proportionnel la masse et au rapport de la chaleur fournie la temprature. D'autres calculs permettent d'appliquer la notion d'entropie aux gaz qui existent. Tel fut le couronnement de la science classique, qui devait ds lors se croire capable, par les calculs, les mesures, les quivalences numriques, de lire, travers tous les phnomnes qui se produisent dans l'univers, de simples variations de l'nergie et de l'entropie conformes une loi simple. L'ide d'une telle russite avait de quoi enivrer les esprits. La catastrophe vint peu aprs. La grandeur de cette entreprise de quatre sicles ne peut tre nie. La ncessit qui nous contraint dans l'action la plus simple nous donne, ds que nous la rapportons aux choses, l'ide d'un monde si compltement indiffrent nos dsirs que nous prouvons combien
Simone Weil, Sur la science (1966) 91
nous sommes prs de n'tre rien. En nous pensant nous-mmes, si l'on peut s'exprimer ainsi, du point de vue du monde, nous parvenons cette indiffrence l'gard de nous-mmes sans laquelle on ne peut se dlivrer du dsir, de l'espoir, de la crainte, du devenir, sans laquelle il n'y a ni vertu ni sagesse, sans laquelle on vit dans le rve. Le contact avec la ncessit est ce qui substitue au rve la ralit. L'clipse est un cauchemar quand on ne comprend pas que la disparition du soleil dans l'clipse est analogue la disparition du soleil pour l'homme qui se couvre les yeux de son manteau ; quand on le comprend, l'clipse est un fait. Ce qu'il y a de purificateur dans le spectacle et dans l'preuve de la ncessit, quelques vers splendides de Lucrce suffisent le faire sentir ; le malheur bien support est une purification de ce genre ; et de mme la science classique est une purification, si l'on en fait bon usage, elle qui cherche lire travers toutes les apparences cette ncessit inexorable qui fait du monde un monde o nous ne comptons pas, un monde o l'on travaille, un monde indiffrent au dsir, aux aspirations, et au bien ; elle qui tudie ce soleil qui brille indiffremment sur les mchants et sur les bons. Mais on ne peut regretter qu'elle ait trouv un terme, car elle tait par nature limite. L'intrt d'abord en est limit et mme faible ; elle est terriblement monotone, et le principe une fois saisi, c'est--dire l'analogie entre les vnements du monde et la forme la plus simple du travail humain, elle ne peut rien apporter de nouveau, si longtemps qu'elle accumule les dcouvertes. Ces dcouvertes ne donnent aucune valeur nouvelle au principe, elles tirent de lui toute leur valeur. Ou s'il prend par elles une plus grande valeur, c'est seulement autant qu'il est rellement saisi par l'esprit d'un homme au moment de la dcouverte, car l'acte par lequel un esprit se met soudain lire la ncessit travers des apparences est toujours admirable ; ainsi Fresnel lisant la ncessit dans les franges de lumire et d'ombre par analogie avec les ondulations de l'eau. De mme l'attitude d'esprit scientifique n'est admirable qu'au moment o elle est celle d'un homme aux prises avec des vnements, des dangers, des responsabilits, des motions, peuttre des terreurs, par exemple sur un navire ou un avion. En revanche rien n'est si morne, si dsertique que l'accumulation des rsultats de la science dans les livres, l'tat de rsidu mort. Une accumulation indfinie d'ouvrages de physique classique n'est pas dsirable.
Simone Weil, Sur la science (1966) 92
Elle n'est pas non plus possible ; la science classique est limite quant l'extension, parce que l'esprit humain est limit. Les hommes diffrent entre eux ; mais mme chez les plus dous l'esprit humain ne peut pas embrasser n'importe quelle quantit de faits clairement conus ; pourtant une synthse ne s'accomplit qu'entre des faits conus par un mme esprit ; il ne peut y avoir synthse entre un fait pens par moi et un fait pens par mon voisin, et, si mon voisin et moi-mme pensons chacun deux, il n'en rsultera jamais quatre. Or toute thorie physique est une synthse dont les lments sont des faits conus comme analogues les uns aux autres. Comme les faits s'accumulent mesure que les gnrations de savants se succdent, au lieu qu'il n'y a pas de progrs dans la capacit de l'esprit humain, la quantit des faits embrasser en arrive dpasser de trs loin la porte d'un esprit ; le savant a ds lors dans l'esprit non plus les faits, mais les synthses opres par d'autres partir des faits, synthses dont il fait son tour une synthse sans les avoir rvises. Cette opration a d'autant moins de valeur, d'autant moins d'intrt, d'autant moins de chances de russir que la distance entre la pense et les faits est plus grande. Ainsi la science classique contenait dans son progrs mme un facteur progressif de paralysie qui devait un jour la tuer. Mais quand elle embrasserait l'univers entier et tous les phnomnes, elle serait encore limite ; elle ne rendrait compte de l'univers que partiellement. L'univers qu'elle dcrit est un univers d'esclave, et l'homme, y compris les esclaves, n'est pas seulement un esclave. L'homme est bien cet tre qui, s'il voit un objet sur le plancher et dsire le voir sur une table, est contraint de le soulever ; mais il est aussi, en mme temps, tout autre chose. Le monde est bien ce monde qui met une distance pnible franchir entre tout dsir et tout accomplissement, mais il est aussi, en mme temps, tout autre chose. Nous sommes srs qu'il est tout autre chose, sans quoi nous n'existerions pas. Il est vrai que la matire qui constitue le monde est un tissu de ncessits aveugles, absolument indiffrentes nos dsirs ; il est vrai aussi en un sens qu'elles sont absolument indiffrentes aux aspirations de l'esprit, indiffrentes au bien ; mais en un sens aussi ce n'est pas vrai. Car s'il y a jamais eu dans le monde, ft-ce chez un seul homme et pendant un seul jour, de saintet vritable, c'est qu'en un sens la saintet est quelque chose dont la matire est capable ; puisque la matire seule et ce qui est inscrit dans la matire existe. Le corps d'un
Simone Weil, Sur la science (1966) 93
homme, et par suite en particulier le corps d'un saint, n'est pas autre chose que de la matire, et c'est un morceau du monde, de ce mme monde qui est un tissu de ncessits mcaniques. Nous sommes rgis par une double loi, une indiffrence vidente et une mystrieuse complicit de la matire qui constitue le monde l'gard du bien ; le rappel de cette double loi est ce qui nous atteint au cur dans le spectacle du beau. Rien n'est plus tranger au bien que la science classique, elle qui prend le travail le plus lmentaire, le travail d'esclave, comme principe de sa reconstruction du monde ; le bien n'y est mme pas voqu par contraste, comme terme antagoniste. On peut peut-tre s'expliquer ainsi qu'en aucun temps et aucun lieu, sinon au cours des quatre derniers sicles dans la petite pninsule d'Europe et son prolongement amricain, les hommes ne se soient donn la peine d'laborer une science positive. Ils taient plus dsireux de saisir la complicit secrte de l'univers l'gard du bien. Il y a l un grand attrait, mais aussi un grand danger ; car l'homme confond facilement l'aspiration au bien avec le dsir ; le pch n'est pas autre chose que ce mlange impur ; ainsi, en essayant de saisir dans le monde des valeurs plutt que de la ncessit, on risque d'encourager en soi-mme ce qu'il y a de plus trouble. Mais si l'on sait viter ce danger, une telle tentative est peuttre une mthode de purification bien suprieure la science positive. Bien entendu, elle ne peut aboutir un savoir communicable la manire de la science ; on s'en convaincra si l'on rflchit que toute tude scientifique des phnomnes de la nature, si abstraite soit-elle, est mene de manire aboutir, en fin de compte, une collection de recettes techniques, au lieu que les sages, les grands artistes les saints, ne disposent jamais de recettes, non seulement l'usage d'autrui, mais mme leur propre usage, quoiqu'ils aient chacun une mthode pour donner l'existence au bien auquel ils aspirent. Les rsultats des efforts accomplis pour penser l'univers, le corps humain, la condition humaine dans leur rapport avec le bien ne peuvent peut-tre pas s'exprimer dans un autre langage que celui des mythes, de la posie, des images ; images faites non seulement de mots, mais aussi d'objets et d'actions. Le choix des images peut, bien entendu, tre plus ou moins heureux. Quand il est heureux, elles enferment toujours quelque mystre. L'ordalie du Moyen ge, par exemple, le feu qui ne brle pas, l'eau qui ne noie pas les innocents, est une image de cette espce,
Simone Weil, Sur la science (1966) 94
claire, mais trs grossire. la mme poque, l'alchimie est une image mystrieuse et plus leve ; c'est bien tort qu'on a pris les alchimistes pour les prcurseurs des chimistes, puisqu'ils regardaient la vertu la plus pure et la sagesse comme une condition indispensable au succs de leurs manipulations, au lieu que Lavoisier cherchait, pour unir l'oxygne et l'hydrogne en eau, une recette susceptible de russir entre les mains d'un idiot ou d'un criminel aussi bien qu'entre les siennes. Toutes les civilisations autres que celle de l'Europe moderne consistent essentiellement dans l'laboration d'images de cette espce. Parmi toutes les recherches autres que la science positive, la science grecque, malgr sa clart merveilleuse, ingale, est pour nous un mystre. En un sens elle est le commencement de la science positive, et premire vue la destruction de la Grce par les armes semble avoir dtermin seulement une interruption de dix-sept sicles, non un changement d'orientation. Toute la science classique est contenue dj dans les travaux d'Eudoxe et d'Archimde. Eudoxe, ami de Platon, lve d'un des derniers pythagoriciens authentiques, qui sont attribues la thorie du nombre gnralis et l'invention du calcul intgral, combina des mouvements circulaires et uniformes accomplis sur une mme sphre, mais autour d'axes diffrents et avec des vitesses diffrentes, pour former un modle mcanique qui rendait parfaitement compte de tous les faits connus son poque concernant les astres. L'ide d'un mme mobile accomplissant en mme temps plusieurs mouvements diffrents qui se composent en une certaine trajectoire est le fondement mme de la cinmatique et permet seule de concevoir une composition de forces ; nous avons seulement remplac les mouvements circulaires par des mouvements droits, et introduit l'acclration. C'est l la seule diffrence entre notre conception du mouvement des astres et celle d'Eudoxe, car bien que Newton ait beaucoup parl de force d'attraction, la gravitation n'est pas autre chose qu'un mouvement uniformment acclr dans la direction du soleil. Archimde fonda non seulement la statique, mais la mcanique tout entire par sa thorie purement mathmatique de la balance, du levier, du centre de gravit ; et sa thorie de l'quilibre des corps flottants, elle aussi purement mathmatique, et qui revient considrer les fluides comme un ensemble de leviers superposs o un axe de symtrie jouerait le rle de point d'appui, contient en germe toute la physique. C'est bien tort que dans l'enseignement on abaisse aujourd'hui ces
Simone Weil, Sur la science (1966) 95
conceptions merveilleuses au rang des observations empiriques les plus dnues d'intrt. Il est vrai que la dynamique, fonde sur la considration du mouvement uniformment acclr, constitua au XVIe sicle une nouveaut ; mais si, grce aux Bernoulli, d'Alembert et Lagrange on parvint rduire toute la dynamique une formule unique, ce fut en la ramenant autant que possible la statique, en dfinissant la cohsion d'un systme de corps ou de points matriels en mouvement comme un quilibre identique celui du levier. La science classique n'est qu'un effort pour concevoir toutes les choses dans la nature comme des systmes de leviers, ainsi qu'Archimde avait fait pour l'eau. Mais si la science grecque est le commencement de la science classique, elle est aussi, en mme temps, autre chose. Les notions qu'elle emploie ont toutes des rsonances mouvantes et plus d'une signification. Celle d'quilibre, par exemple, avait toujours t au centre de la pense grecque ; dj d'ailleurs en gypte, depuis des sicles et des sicles, la balance tait le symbole par excellence de l'quit, leurs yeux la premire des vertus. L'injustice apparat, implicitement dans l'Iliade, presque explicitement dans Eschyle, comme une rupture d'quilibre qui doit ncessairement plus tard tre compense par un dsquilibre en sens contraire, et ainsi de suite ; une formule singulire d'Anaximandre applique cette conception la nature elle-mme, faisant apparatre tout le cours des phnomnes naturels comme une succession de pareils dsquilibres qui se compensent, image mobile de l'quilibre comme le temps est l'image mobile de l'ternit. Comme la naissance fait sortir les choses de l'indtermin, la destruction les y fait retourner par ncessit ; car elles subissent un chtiment et une expiation les unes de la part des autres pour leurs injustices mutuelles, selon l'ordre du temps. Quelques lignes du Gorgias, les plus belles peut-tre, rendent le mme son ; Socrate y reproche au dfenseur de l'injustice d'ignorer que la concorde et l'harmonie dterminent l'ordre du monde, et d'oublier la gomtrie. La notion qui apparat dans de telles paroles est la mme qui, sous le nom d'quilibre, constitue la physique grecque. Archimde a d seulement lui trouver une dfinition rigoureuse ; ou plutt deux dfinitions, l'une gomtrique, l'autre empirique. Le mouvement et plus gnralement le changement apparaissait aux Grecs comme un dsquilibre ; ainsi, aux yeux d'Archimde, le signe de l'quilibre est l'immobilit. D'autre part,
Simone Weil, Sur la science (1966) 96
un systme de corps tant symtrique autour d'un axe, il est vident que l'ensemble des corps situs d'un ct de l'axe ne peut exercer aucune action sur l'ensemble des corps situs de l'autre ct, et une telle symtrie constitue la dfinition gomtrique de l'quilibre. Le postulat est que, pour les systmes considrs, les deux dfinitions concident, et qu'au cas o il y aurait repos sans symtrie il est toujours possible nanmoins de dcouvrir une symtrie cache, par une suite de dmonstrations rigoureusement mathmatiques. Tout cela, bien que non explicitement nonc par Archimde, est impliqu clairement par ses postulats, ses hypothses et ses thormes. D'autre part la notion d'quilibre domine toutes les formes d'art authentique, et on peut en dire autant de la proportion, cette notion centrale de la gomtrie grecque ; quant aux mouvements uniformes et circulaires d'Eudoxe, ils font songer la danse ; aussi bien y a-t-il une page splendide de l'Epinomis sur la danse des astres, danse qu'un crivain grec compara plus tard celles dont on entourait celui qu'on voulait prparer l'initiation d'Eleusis. De mme que la science classique est essentiellement parente de la technique, de mme la science grecque, quoique aussi rigoureuse ou plutt davantage, quoique non moins applique saisir partout des ncessits, est essentiellement parente de l'art et surtout de l'art grec. La science classique prend comme modle de la reprsentation du monde le rapport entre un dsir quelconque et les conditions auxquelles il peut tre accompli, en supprimant le premier terme du rapport ; cette suppression ne peut, d'ailleurs, tre complte. C'est pourquoi elle se fonde sur le mouvement droit, forme mme du projet, pense de tout homme qui dsire, par exemple, tre quelque part, saisir ou frapper quelque chose ou quelqu'un ; et sur la distance, condition ncessairement enferme dans tout dsir d'un tre soumis au temps. Dans un tel tableau du monde, le bien est tout fait absent, absent au point qu'on n'y trouve mme pas marque l'empreinte de cette absence ; car mme le terme du rapport qu'on s'efforce de supprimer, le terme qui concerne l'homme, est tout fait tranger au bien. Aussi la science classique n'est-elle pas belle ; ni elle ne touche le cur ni elle ne contient une sagesse. On comprend que Keats ait ha Newton, et que Gthe non plus ne l'ait pas aim. Il en tait tout autrement chez les Grecs. Hommes heureux, en qui l'amour, l'art et la science n'taient que trois aspects peine diffrents du mme mouvement de l'me vers
Simone Weil, Sur la science (1966) 97
le bien. Nous sommes misrables ct d'eux, et pourtant ce qui fit leur grandeur est porte de notre main. D'aprs une admirable image qu'on trouve chez les Manichens, et qui remonte certainement beaucoup plus haut, l'esprit est dchir, mis en morceaux, dispers travers l'espace, travers la matire tendue. Il est crucifi sur l'tendue ; et la croix n'est-elle pas le symbole de l'tendue, tant faite des deux directions perpendiculaires qui la dfinissent ? L'esprit est aussi crucifi sur le temps, dispers en morceaux travers le temps, et c'est le mme cartlement. L'espace et le temps sont une seule et mme ncessit doublement sensible, et il n'y a pas d'autre ncessit. L'tre pensant, dans son dsir le plus animal comme dans son aspiration la plus haute, est spar de lui-mme par la distance que met le temps entre ce qu'il est et ce qu'il tend tre, et, s'il croit s'tre trouv lui-mme, il se perd aussitt par la disparition du pass. Ce qu'il est dans un seul instant n'est rien, ce qu'il a t, ce qu'il sera n'est pas, et le monde tendu est fait de tout ce qui lui chappe, maintenu qu'il est en un point comme par une chane et une prison, impuissant tre ailleurs sinon aprs avoir dpens du temps, aprs s'tre soumis une peine et aprs avoir abandonn le point o il tait d'abord. Le plaisir le cloue au lieu de sa prison et l'instant prsent que pourtant il perd, le dsir le suspend un instant prochain et fait disparatre le monde entier pour un objet, la douleur consiste toujours pour lui sentir le dchirement et la dispersion de sa pense travers la juxtaposition des moments et des lieux. Pourtant l'tre pensant est fait, il le sent, pour autre chose que le temps et l'espace ; et ne pouvant s'empcher de les avoir prsents sa pense, il se sent fait du moins pour en tre le matre, pour habiter l'ternit, dominer et embrasser le temps, possder tout l'univers tendu en tous ses lieux la fois. La ncessit du temps et de l'espace s'y oppose. Mais les choses juxtaposes dans l'tendue et qui changent d'instant en instant fournissent pourtant l'homme une image de cette souverainet perdue et interdite. Autrement l'homme ne vivrait pas ; car il ne lui est donn de penser que ce qui lui est sensible. C'est cause de cette image que l'univers, bien qu'impitoyable, mrite d'tre aim, mme au moment o l'on souffre, comme une patrie et une cit. Cette image est fournie dans certaines uvres de l'homme par la limite, l'ordre, l'harmonie, la proportion, les retours rguliers, par tout
Simone Weil, Sur la science (1966) 98
ce qui permet l'homme d'embrasser d'un seul acte de la pense une juxtaposition de lieux qui quivaut tous les lieux, une succession d'instants qui quivaut tous les instants, comme s'il tait partout et toujours, comme s'il tait ternel. Mais pour qu'il y ait l une vritable image du regard que l'homme voudrait pouvoir abaisser sur le monde, et non un mensonge vide et froid, il faut que cet acte soit difficile, qu'il semble sur le point de s'achever et ne s'achve jamais, que la ncessit du temps et de l'espace qui s'y oppose soit plus douloureusement ressentie que dans les moments mmes les plus malheureux de la vie. Un juste mlange de l'unit et de ce qui s'oppose l'unit, c'est la condition du beau et le secret de l'art, secret mystrieux pour l'artiste aussi. Une suite de sons varie comme la voix d'un tre esclave de l'motion, soumis au changement, soumis aussi l'obsession ; pourtant les combinaisons de sons s'enchanent par des retours rguliers o elles semblent la fois identiques elles-mmes et nouvelles, de sorte que celui qui coute parcourt la suite mme laquelle il est enchan ; le silence entoure cette suite de part et d'autre, lui marque un commencement et une fin, et en mme temps semble la prolonger indfiniment. Un espace est clos de limites qu'on n'imagine pas modifiables et qui semblent enfermer un monde part, mais voque aussi des distances illimites, plus lointaines que les toiles, hors de lui, dans toutes les directions ; on le saisit presque d'un coup d'il dans sa structure, mais il invite la marche qui en dveloppe une infinit d'aspects diffrents. Un marbre qu'on croirait fluide et s'coulant par nappes, qu'on croirait flexible la pression de tout l'univers environnant, a pris pour toujours la forme d'un corps humain intact, dans la position d'quilibre o la pesanteur ne l'altre pas et o tout mouvement est galement possible. Une petite surface enferme dans des limites bien marques un espace infiniment vaste trois dimensions, o des choses et des tres sont lis et spars la fois par leur position rciproque, fixs dans une apparence d'un instant, et tels que s'ils n'taient vus par personne et d'aucun point de vue, tels que s'ils taient surpris sans la souillure d'un regard humain tout voil d'inconscience. Un pome prsente tour tour des personnages dont chacun est l'auditeur et pourtant est un autre, qui changent emports par un temps impitoyablement marqu par la mesure du vers, et pourtant par cette mesure le pass demeure et l'avenir est l ; le poids de l'univers entier, sous la forme du malheur, y marque tous les hommes sans en dtruire aucun et altre les mots sans briser la mesure. Tout cela, ce sont des images qui
Simone Weil, Sur la science (1966) 99
atteignent et blessent l'me en son centre. Un corps et un visage humain qui inspirent, en mme temps que le dsir et plus fortement, la crainte d'en approcher de peur d'y nuire, dont on ne peut imaginer l'altration et dont on sent vivement l'extrme fragilit, qui arrachent presque l'me un lieu et un instant particulier et lui font sentir violemment qu'elle y est cloue, c'est aussi une telle image. Et l'univers tranger l'homme fournit aussi de telles images. L'univers fournit de telles images par la faveur divine accorde l'homme d'y appliquer d'une certaine manire le nombre, intermdiaire, comme l'a dit Platon, entre l'un et l'indfini, l'illimit, l'indtermin, entre l'unit telle que l'homme peut la penser et tout ce qui s'oppose ce qu'il la pense. Ce n'est pas le nombre par lequel on dnombre, ni celui qu'on forme par addition continuellement rpte, qui constitue cet intermdiaire, mais plutt le nombre en tant qu'il est susceptible de former des rapports ; car un rapport entre deux chiffres, chose infiniment diffrente d'une fraction, est en mme temps rapport entre une infinit d'autres chiffres choisis convenablement et groups deux par deux ; chaque rapport enveloppe des quantits qui croissent d'une manire illimite sans cesser d'tre fidles une relation parfaitement dfinie, comme un angle, partir d'un point, embrasse un espace qui s'tend indfiniment au-del des plus lointaines toiles. Et le rapport, pour tre pens, doit sortit du nombre pour passer dans l'angle, car le nombre entier supporte mal la substitution du rapport l'addition ; il ne donne aucun moyen d'exprimer, sinon en certains cas, la moyenne proportionnelle. Cela, non seulement les Grecs de la priode archaque, mais aussi les Babyloniens de l'an 2000 devaient le savoir, eux qui cherchaient des solutions aux quations du deuxime degr, C'est--dire des moyennes proportionnelles ; l'incommensurabilit de la diagonale du carr, tardivement rvle en Grce au grand public, n'a d jeter le trouble et le scandale que parmi les ignorants. Les Grecs du VIe sicle fondrent la science du nombre gnralis, et ds lors l'tude du monde consista y chercher des nombres en ce sens nouveau, c'est--dire des proportions. Or on y trouve des proportions. C'est ainsi qu'au lieu du rapport entre le dsir et les conditions de l'accomplissement, la science grecque a pour objet le rapport entre l'ordre et les conditions de l'ordre. Il s'agit d'un ordre sensible
Simone Weil, Sur la science (1966) 100
l'homme, et par suite l'homme n'est pas absent de ce rapport ; pourtant cet ordre se rapporte l'univers mieux que ne font le dsir, le projet, l'effort ; la science grecque est au moins aussi dpouille de l'humain que la science classique, quoi qu'ait pens l'orgueil du sicle dernier. Les conditions qu'on cherche dfinir dans les deux rapports sont les mmes, ce sont les mmes ncessits de l'espace et du temps, obstacles et appui pour le travail de l'architecte ou de tout homme qui cre de l'ordre comme pour n'importe quel travail. Au reste penser les conditions d'un ordre, c'est penser un ordre construit, c'est le rapprocher des ordres qui sont les effets du travail ; d'autre part, tout travail efficace suppose un certain ordre dans l'univers et certaines proportions, sans quoi il n'y aurait ni outil ni mthode ; ainsi les deux rapports semblent se confondre. Mais l'esprit des deux sciences est essentiellement diffrent. Les Grecs, partout o ils croyaient discerner un ordre, en construisaient une image avec des lments parfaitement dfinis ou en se soumettant la ncessit s'il y avait cart entre cette image et leurs observations, l'cart signifiait l'intervention dans les phnomnes de facteurs autres que ceux qu'ils avaient supposs. On ne peut rien souhaiter de plus rigoureux. Mais cette rigueur parfaite tait en mme temps posie. La dfinition mme de la proportion par Eudoxe, qui constitue la thorie du nombre gnralis, est belle, elle qui enveloppe les variations infinies que peuvent subir quatre grandeurs multiplies deux deux par tous les nombres entiers possibles, sans jamais cesser d'obit la loi qui prescrit ces produits d'tre plus grands ou plus petits les uns que les autres. Plus belle encore fut la premire intuition de Thals, quand il aperut dans le soleil l'auteur d'une infinit de proportions qui s'inscrivent sur le sol et qui changent avec les ombres ; ds ce premier moment apparaissait ainsi la notion de proportion variable, c'est--dire de fonction ; mais pour nous le terme mme de fonction indique la dpendance d'un terme l'gard d'un autre, au lieu que les Grecs trouvaient simplement leur joie faire du changement un objet de contemplation. Si l'on ajoute une charge un bateau, et qu'il s'enfonce un peu, nous voyons l une force qui produit un effet ; aux yeux d'Archimde une ligne marquait sur la surface du corps flottant l'image du rapport entre sa densit et celle du fluide. De mme un point marquait sur la balance en quilibre, sous forme de longueurs, la proportion entre les poids ingaux. Quelle plus belle image que celle
Simone Weil, Sur la science (1966) 101
d'un navire soutenu sur la mer, comme un plateau de balance, par une masse d'eau de mer place de l'autre ct d'un axe, et qui change sans mouvement mesure que le navire avance, comme l'ombre d'un oiseau qui vole ? On perd cette posie, on perd aussi beaucoup de rigueur, en parlant simplement d'une pousse vers le haut. Bien qu'il soit plus facile de construite une trajectoire elliptique avec des mouvements droits susceptibles d'acclration qu'avec des mouvements circulaires uniformes, nous avons perdu de la rigueur et de la posie en disant que les plantes tendent vers le soleil ; il est plus beau de dire que les astres dcrivent des cercles, et que leurs positions successives refltent les proportions entre les rayons, les vitesses et les angles dfinissant les divers mouvements circulaires dont chacun est m. Le cercle est l'image du mouvement infini et fini, changeant et invariable, il enferme un espace clos, et voque tous les cercles concentriques qui s'tendent aussi loin que l'univers ; il est aussi, comme Pythagore le reconnut avec ivresse, le lieu des moyennes proportionnelles. Le mouvement circulaire a une loi sans se diriger nulle part ; seul il convient aux astres, seul il peut leur tre appliqu sans diminuer leur pouvoir d'voquer pour nous tout ce qui est ternel. Les Grecs avaient raison de penser qu'une telle convenance suffit rendre une hypothse lgitime, car rien d'autre au monde ne peut la rendre plus lgitime. La ncessit aveugle, qui nous tient par la contrainte et qui nous apparat dans la gomtrie, est pour nous une chose vaincre ; pour les Grecs, c'tait une chose aimer, car c'est Dieu mme qu' est le perptuel gomtre. Depuis l'clair de gnie de Thals jusqu'au moment o les armes romaines les crasrent, dans les retours rguliers des astres, dans les sons, dans les balances, dans les corps flottants sur les fluides, partout ils s'appliquaient lire des proportions pour aimer Dieu. Les formes diffrentes qu'a prises selon les pays et les poques la connaissance du monde ont chacune pour objet, pour modle et pour principe le rapport entre une aspiration de la pense humaine et les conditions effectives de sa ralisation, rapport qu'on essaie de lire travers les apparences dans le spectacle du monde et d'aprs lequel on construit une image de l'univers. Par exemple la magie ressemble la science classique par choix de l'aspiration laquelle elle a, gard, et qui est un dsir quelconque ; mais elle considre comme conditions des rites et des signes, lesquels sont effectivement des conditions pour la russite de l'action humaine, mais variables avec la socit. La
Simone Weil, Sur la science (1966) 102
science grecque, elle, considre les mmes conditions que la science classique, mais elle a gard une aspiration tout autre, l'aspiration contempler dans les apparences sensibles une image du bien. L'aspiration qui correspond ce qu'on a nomm les sciences traditionnelles semble tendre vers des pouvoirs analogues ceux qu'un homme acquiert effectivement sur lui-mme et peut-tre sur autrui par un long effort de transformation intrieure ; les conditions sont mystrieuses. Autant il peut y avoir de semblables rapports susceptibles d'tre conus par l'homme, autant il y a de formes diffrentes de la connaissance du monde ; et la valeur de chacune de ces formes est la valeur du rapport qui lui sert de principe, exactement, ni plus, ni moins. Au reste, certaines de ces formes s'excluent, d'autres ne s'excluent nullement. Mais la science contemporaine, que faut-il en penser ? Quel rapport lui sert de principe et en mesure la valeur ? Il est difficile de rpondre cette question, non qu'il y ait quelque obscurit, mais parce que le respect humain loigne de la rponse. La signification philosophique de la physique du XXe sicle, la pense profonde qui en est l'me, sont comme le manteau de l'empereur dans le conte d'Andersen ; on passerait pour un sot et pour un ignorant en disant qu'il n'y en a pas, il vaut mieux les donner pour inexprimables. Nanmoins le rapport qui est au principe de cette science est simplement le rapport entre des formules algbriques vides de signification et la technique. La science du XXe sicle, c'est la science classique aprs qu'on lui a retir quelque chose. Retir, non pas ajout. On n'y a apport aucune notion, et surtout on n'y a pas ajout ce dont l'absence en faisait un dsert, le rapport au bien. On en a retir l'analogie entre les lois de la nature et les conditions du travail, c'est--dire le principe mme ; c'est l'hypothse des quanta qui l'a ainsi dcapite. Les formules algbriques auxquelles se rduisait, vers la fin du XIXe sicle, la description des phnomnes, signifiaient cette analogie du fait qu' chacune d'elles on pouvait faire correspondre un dispositif mcanique dont elle traduist les rapports entre distances et forces ; il n'en est pas ainsi pour une formule faite d'une constante et d'un nombre, une telle formule ne peut rien exprimer qui se rapporte la distance. Qu'on suspende des poids gaux des hauteurs diffrentes et qu'on lve un plateau qui les soulve mesure qu'il les atteint, les variations de l'nergie, fonction de la distance et de la force, ressembleront celles d'une surface limite par deux droites perpendiculaires, dont l'une mobile, et
Simone Weil, Sur la science (1966) 103
une ligne brise en escalier, autrement dit elles seront continues. On peut chercher imaginer autant de dispositifs mcaniques que l'on voudra comportant de la discontinuit ; en aucun cas une fonction de deux variables dont l'une varie d'une manire continue ne peut crotre par addition successive d'une quantit constante. Or l'nergie est une fonction de l'espace, et l'espace est continu ; il est la continuit mme ; il est le monde pens du point de vue de la continuit ; il est les choses en tant que leur juxtaposition enveloppe le continu. On peut penser les choses comme discontinues, c'est--dire les atomes - on ne le peut d'ailleurs pas sans arriver des contradictions - mais mme au prix de contradictions implicites on ne peut pas penser ainsi l'espace. Si certains Grecs, dit-on, ont parl du nombre des points contenus dans un segment de droite, c'est seulement parce qu'ils concevaient le nombre comme le modle de la quantit, et parce que le langage supporte tout. Mais on pourrait aussi bien penser la continuit elle-mme discontinue que l'espace. Nous n'avons rien de plus certain pour guider nos affirmations que de telles impossibilits ; l'espace est continu. L'nergie est une fonction de l'espace ; toute variation d'nergie est analogue ce qui se produit quand des poids tombent ou sont soulevs. La formule de Planck, savoir la constante 6,55 X 10-27, ou plus brivement la constante h, multiplie par un nombre, ne signifie pas l'nergie. Mais elle ne signifie pas non plus une notion autre que la notion d'nergie. Elle joue le mme rle dans les calculs que la formule signifiant l'nergie, et celle-ci est regarde comme un cas limite de celle-l pour les phnomnes l'chelle desquels la quantit 6,55 X 10-27, rapporte l'unit de mesure de l'nergie, peut tre nglige. Si le rapport tait inverse, si la formule quantique tait une limite de la formule classique, la signification serait conserve ; mais il n'en est pas ainsi. Or il n'existe pas dans la pense humaine de notion par rapport laquelle la notion du travail de soulever un poids puisse tre considre comme une limite valable une certaine chelle. La formule de Planck, faite d'une constante dont on n'imagine pas la provenance et d'un nombre qui correspond une probabilit, n'a aucun rapport avec aucune pense. Comment est-ce qu'on la justifie ? On en fonde la lgitimit sur la quantit des calculs, des expriences issues de ces calculs, des applications techniques procdant de ces expriences, qui ont russi grce cette formule. Planck lui-mme n'allgue rien d'autre. Pareille chose une fois admise, la physique devient un ensemble de signes et de nombres combins en des formules qui sont
Simone Weil, Sur la science (1966) 104
contrles par les applications. Ds lors quelle importance peuvent bien avoir les spculations d'Einstein sur l'espace et le temps ? Les lettres des formules qu'il traduit par ces mots n'ont pas plus de rapport avec l'espace et le temps que les lettres hv avec l'nergie. L'algbre pure est devenue le langage de la physique, un langage qui a ceci de particulier qu'il ne signifie rien. Cette particularit le rend difficile traduire. Ce bouleversement de la physique est l'effet de deux changements, l'introduction du discontinu et le perfectionnement des instruments de mesure qui a modifi l'chelle des observations. La chimie est ne le jour o la balance a fait apparatre des rapports numriques simples et fixes entre substances distinctes qui se combinent ; un retour du discontinu et du nombre au premier plan de la science de la nature tait dj impliqu dans cette pese. D'autre part les appareils nous donnaient accs l'observation de phnomnes trs petits par rapport l'chelle de nos sens, tels que le mouvement brownien. Discontinu, nombre, petitesse, c'est assez pour faire surgir l'atome, et l'atome est revenu parmi nous avec son cortge insparable, savoir le hasard et la probabilit. L'apparition du hasard dans la science a fait scandale ; on s'est demand d'o il venait ; on n'a pas rflchi que l'atome l'avait amen ; on ne s'est pas souvenu que dj dans l'antiquit le hasard accompagnait l'atome, et l'on n'a pas song qu'il n'en peut tre autrement. On se trompe souvent sur le hasard. Le hasard n'est pas le contraire de la ncessit ; il n'est pas incompatible avec elle ; au contraire, il n'apparat jamais, sinon en mme temps qu'elle. Si l'on suppose un certain nombre de causes distinctes produisant des effets selon une ncessit rigoureuse ; si un ensemble d'une certaine structure apparat dans les effets ; si on ne peut pas grouper les causes en un ensemble de mme structure, il y a hasard. Un d, par sa forme, n'a que six manires de tomber ; il y a une varit illimite dans la manire de le jeter. Si je jette un d mille fois, les chutes du d se rpartissent en six classes qui ont entre elles des rapports numriques ; les jets ne peuvent pas se rpartir ainsi. Au reste, je n'imagine pas le moindre dfaut dans le tissu de ncessits mcanique qui dtermine chaque fois le mouvement du d. Si je jette le d une fois, j'ignore quel sera le rsultat, non pas cause d'une indtermination dans le phnomne, mais
Simone Weil, Sur la science (1966) 105
parce que c'est un problme dont j'ignore en partie les donnes. Ce n'est pas cette ignorance qui me donne le sentiment du hasard, mais uniquement l'image, qui accompagne mon mouvement, de pareils mouvements possibles en quantit indtermine et dont les effets se rpartissent en six classes. Il en est de mme si l'on considre l'ensemble des positions possibles d'un disque tournant et des impulsions qui peuvent lui tre imprimes, d'une part, d'autre part un petit nombre de couleurs sur lesquelles une aiguille peut s'arrter. Dans de tels jeux, l'ensemble des causes a la puissance du continu, c'est--dire que les causes sont comme les points d'une ligne ; l'ensemble des effets se dfinit par un petit chiffre de possibilits distinctes. Dans l'antiquit, l'image des atomes a aussitt voqu dans les esprits les jeux de hasard, et ce n'tait pas vainement, malgr les diffrences. Si je conois sous le nom d'univers un ensemble d'atomes en mouvement, chaque mouvement tant strictement dtermin, et si je me demande comment se drouleront les phnomnes une chelle suprieure aux yeux d'observateurs qui l'atome est invisible, je ne puis concevoir absolument aucun motif pour que leur droulement prsente aucune apparence de constance, de rgularit, de coordination, ou mme pour qu'il soit possible de recommencer deux fois une exprience. Il est clair que si l'on ne peut pas recommencer deux fois une exprience, il n'y a pas de physique. La conception des atomes fait aussitt apparatre le succs de la physique l'chelle humaine comme un hasard. Le lien des deux physiques, la physique des atomes et celle des phnomnes que nous percevons, ne peut tre tabli que par la probabilit. La probabilit est insparable du hasard, et par elle le hasard est une notion exprimentalement contrlable. Quand, dans les jeux de hasard, je considre l'ensemble continu des causes et le petit nombre de catgories entre lesquelles se rpartissent les effets, j'affirme que, bien que chaque effet dcoule rigoureusement d'une cause, il n'y a absolument rien dans l'ensemble des causes qui corresponde ces catgories ; affirmer le hasard, c'est cela. Ds lors ces catgories ont toutes un rapport identique l'ensemble des causes qui leur est pareillement indiffrent. C'est ce que j'exprime en disant qu'elles sont galement probables. La notion de probabilit implique toujours une rpartition entre Probabilits gales. Si je considre prsent un d dont cinq faces portent le chiffre un et la sixime le chiffre deux, il y a toujours six probabilits gales, mais cinq d'entre elles concident ; c'est ainsi
Simone Weil, Sur la science (1966) 106
seulement qu'on peut concevoir les probabilits ingales. Quant au rapport de la probabilit l'exprience, il est analogue au rapport de la ncessit l'exprience ; l'exprience prsente une image de ncessit quand, en faisant varier une cause, on obtient des effets qui varient comme une fonction ; elle prsente une image de la probabilit quand la rpartition des effets entre catgories se rapproche de plus en plus des proportions indiques par le calcul mesure que les effets s'accumulent. Si l'exprience refuse une telle image, on procde comme lorsqu'elle refuse une image de la ncessit ; on suppose qu'on a omis des facteurs dans le calcul. La tche de la physique classique transporte parmi les atomes tait difficile. Elle devait concevoir des particules trs petites et non divisibles, mues par des mouvements soumis aux ncessits de la mcanique classique ; ces mouvements devaient tre tels qu'ils fussent unis par des ncessits aux phnomnes observables l'chelle du microscope, et par des probabilits rigoureusement reconstruites aux phnomnes observables l'chelle humaine et dont les variations rgulires avaient fait jusque-l le seul objet de la physique. La physique classique regarde une pierre souleve comme un seul point dcrivant une trajectoire verticale rectiligne ; elle regarde, en somme, toute la pierre comme un seul atome, et c'est ainsi qu'elle calcule l'nergie. Si au lieu de cela on imagine les combinaisons compliques des mouvements que dcrivent les particules de la pierre et de l'air, il faut, grce aux notions de hasard, de probabilit, de moyenne, d'approximation, retrouver la formule prcdemment calcule. Il fallait ou tablir un tel lien, ou renoncer compltement l'une des deux physiques ; c'est du moins ce qui devait sembler vident ; mais l'vnement fut autre. On ne put tablir ce lien qu'en supposant les atomes soumis des ncessits diffrentes de celles de la physique classique. Comme la science tout entire se rduisait l'tude de l'nergie, ce fut dans cette tude, transporte par l'intermdiaire des hypothses l'chelle molculaire, qu'une si trange transformation apparut d'abord. Planck a racont comment cela s'est produit. Il cherchait l'expression d'une relation entre l'nergie et la temprature. cette fin, il considra un cas o le rgime des changes d'nergie entre des corps dpend seulement de la temprature et non de la nature des corps ; tel tait, d'aprs Kirchhoff, le cas du rayonnement noir, c'est--dire le cas
Simone Weil, Sur la science (1966) 107
d'une enceinte close o la temprature est uniforme. Ds lors il suffisait apparemment de reconstruire mathmatiquement un cas particulier de rayonnement noir favorable une telle reconstruction pour avoir la fonction liant l'nergie la temprature. Planck choisit cette fin les oscillateurs de Hertz ; une premire tentative choua ; puis, cherchant la relation, non plus entre l'nergie et la temprature, mais entre l'nergie et l'entropie, il trouva que la drive seconde de l'entropie par rapport l'nergie est proportionnelle l'nergie. Mais, si dans le cas des petites longueurs d'ondes cette relation se trouva vrifie par l'exprience, il apparut bientt que pour les grandes cette drive seconde tait proportionnelle au carr de l'nergie. Planck trouva facilement une formule enveloppant les deux relations ; mais cela ne le satisfit pas ; cette formule, il voulut la reconstruire. cette fin, il adopta le point de vue de Boltzmann, savoir que l'entropie, rapporte aux atomes, est la mesure d'une probabilit ; et il retrouva, pour cette probabilit, la formule mme qu'il cherchait retrouver, mais condition de tenir compte de deux constantes, dont l'une avait rapport la masse de l'atome, et dont l'autre, 6,55 X 10-27, n'tait autre que cette constante h devenue si clbre par la suite, et correspondait une nergie multiplie par un temps. Une telle constante n'avait aucun sens par rapport la mcanique classique, mais c'est seulement grce elle qu'on pouvait connatre les domaines ou intervalles indispensables pour le calcul des probabilits ; car le calcul de la probabilit d'un tat physique repose sur le dnombrement du nombre fini de cas particuliers galement probables par lesquels l'tat considr est ralis . Il apparat clairement dans ces lignes de Planck que ce qui introduit ici la discontinuit, ce n'est nullement l'exprience -bien que des mesures exprimentales aient d ncessairement intervenir dans la dtermination du chiffre 6,55 x 10-27 - mais uniquement l'usage de la notion de probabilit. Il y a une transition naturelle entre la notion d'entropie et celle de probabilit, par cette considration que, si un systme, suppos isol de l'extrieur, peut passer de l'tat A l'tat B, mais non pas inversement, par quelque chane d'intermdiaires que ce soit, l'tat B est plus probable que l'tat A par rapport ce systme. Or, au moment mme o s'laboraient ces conceptions apparaissait aussi le hasard li l'atome. L'observation du mouvement brownien montrait qu'un fluide qui est homogne et en repos l'chelle de nos
Simone Weil, Sur la science (1966) 108
yeux n'est ni homogne ni en repos l'chelle du microscope ; chose, certes, trs peu surprenante. Or un fluide en quilibre est parfaitement dfini, notre chelle, par les conditions de l'quilibre, au lieu que nous n'avons aucun moyen, en fait, de dfinir l'tat de mouvement de ce mme fluide l'chelle microscopique. D'une manire gnrale, un systme dfini notre chelle ne l'est pas l'chelle molculaire ; on peut seulement supposer le systme d'atomes qui, notre chelle, nous apparatrait comme un systme donn. Mais si l'on tablit cette espce de correspondance, un tat bien dfini d'un systme notre chelle correspond plus d'une combinaison d'atomes ; par suite, si l'on transporte la ncessit parmi les atomes, chacune de ces combinaisons possibles est susceptible d'entraner, un moment ultrieur, un tat diffrent du systme. Ainsi, la ncessit une fois transporte parmi les atomes, la relation entre deux tats d'un systme dfinis notre chelle ne constitue plus une ncessit, mais une probabilit ; cela non pas par suite d'une lacune dans la causalit, mais seulement par un effet invitable de l'oscillation de la pense entre deux chelles, et par un processus analogue celui du jeu de ds. Un mouvement naturel de la pense amena rapprocher les deux probabilits surgies simultanment dans les esprits, celle qui est lie l'entropie et celle qui est lie aux atomes et les regarder comme une seule et mme probabilit. Cette assimilation fut l'uvre de Boltzmann. On part de l'ide que parmi les atomes, pour lesquels on admet seulement les ncessits mcaniques, il n'y a que des ncessits, non des diffrences de probabilits, et que par suite toute combinaison d'atomes est galement probable. On considre un systme, un tat de ce systme dfini notre chelle, et la quantit de combinaisons d'atomes susceptibles de lui correspondre ; la probabilit de cet tat est une fonction de cette quantit, et l'on pose que l'entropie est une mesure de cette probabilit. Mais comme le calcul des probabilits est un calcul numrique, on admet, et c'est ici le moment de la rupture avec la science classique, que ces combinaisons d'atomes sont, comme on dit, discrtes, et que leur quantit est un nombre ; ainsi l'entropie est la fonction d'un nombre, elle qu'on a dfinie, quand on l'a invente, comme une fonction de l'nergie, qui augmente quand celle-ci prend au moins partiellement la forme de la chaleur. La contradiction est la mme que si l'on admettait, par exemple, qu'une quantit se dfinit comme une fonction de la distance parcourue par un coureur, et que
Simone Weil, Sur la science (1966) 109
cette mme quantit est fonction du nombre de ses pas. C'est cette contradiction qui apparat dans l'ide de quanta ou d'atomes d'nergie, et c'est elle qui a t la science, partir de 1900, la signification qu'elle avait eue au cours de quatre sicles, sans qu'on ait pu lui en donner aucune autre. La rupture entre la science du XXe sicle d'une part, la science classique et le sens commun de l'autre, tait totale ds avant les paradoxes d'Einstein ; une vitesse infinie et mesurable, un temps assimil une quatrime dimension de l'espace, ne sont pas choses plus difficiles concevoir qu'un atome d'nergie ; tout cela est galement impossible concevoir, quoique trs facile formuler, soit dans le langage algbrique, soit dans le langage commun. La science devait-elle invitablement prendre une telle direction si toutefois on peut parler de direction alors qu'elle a au contraire cess d'tre dirige ? Cela ne semble nullement vident. La cause de la rupture de continuit tant le caractre numrique du calcul des probabilits, il est difficile de comprendre, premire vue, pourquoi l'on n'a pas choisi de travailler sur le calcul des probabilits plutt que de bouleverser la physique. On peut concevoir des probabilits qui ne soient ni des nombres entiers ni des fractions. Si l'on suppose, par exemple, qu'on fasse tourner un disque porteur d'une aiguille, et que l'aiguille tourne sur une circonfrence immobile dont un arc soit trac en rouge, la probabilit pour que l'aiguille s'arrte sur du rouge sera mesure par le rapport de l'arc la circonfrence, rapport qui peut fort bien n'tre pas une fraction ; on peut donc facilement concevoir un calcul des probabilits dont la base soit non pas le nombre, mais le nombre gnralis. Pour appliquer un tel calcul la thorie de Boltzmann, il aurait fallu concevoir un ensemble continu de combinaisons d'atomes correspondant un systme dfini notre chelle, et trouver le moyen de faire correspondre un tel ensemble, compar d'autres ensembles de mme espce, une grandeur analogue une distance. premire vue, cela ne semble pas impossible. A-t-on essay d'laborer une telle thorie, et a-t-on chou ? En ce cas, quelle est la cause de l'chec ? Ou n'a-t-on mme pas song essayer, malgr l'extrme simplicit d'une telle ide ? Il est certain, en tout cas, que c'est l le point crucial dans tout examen critique de la thorie des quanta ; il est certain aussi que Planck a pu faire tout un livre, rcemment traduit, sur les rapports de la science contemporaine et de la philosophie, sans y faire mme une lointaine allusion.
Simone Weil, Sur la science (1966) 110
Quoique le bien ft absent de la science classique, aussi longtemps que l'intelligence l'uvre dans la science fut une forme seulement mieux aiguise de celle qui labore les notions de sens commun, il y eut du moins quelque liaison entre la pense scientifique et le reste de la pense humaine, y compris la pense du bien. Mais mme cette liaison si indirecte fut rompue aprs 1900. Des gens qui se disaient philosophes, fatigus de la raison, sans doute parce qu'elle est trop exigeante, triomphrent l'ide d'un dsaccord entre la raison et la science ; bien entendu, c'est la raison qu'ils donnaient tort. Ce qui leur procurait une joie particulire, c'tait de penser qu'un simple changement d'chelle apporte dans les lois de la nature une transformation radicale, tandis que la raison exige qu'un changement d'chelle change les grandeurs, non les rapports entre grandeurs ; ou encore ils taient heureux de penser que les ncessits regardes longtemps comme videntes deviennent, quand des instruments meilleurs permettent de pntrer plus avant, grce aux atomes, dans la structure des phnomnes, de simples peu prs. Leur joie n'tait pas seulement impie, tant dirige contre la raison, elle tmoignait aussi d'une incomprhension singulirement opaque. L'tude des atomes correspond dans la science, non seulement un changement d'chelle, mais aussi tout autre chose. Si l'on imagine un petit homme, semblable nous, de la dimension d'une particule atomique, vivant parmi les atomes, ce petit homme, par hypothse, sentirait de la chaleur, de la lumire, des sons, en mme temps qu'il verrait et accomplirait des mouvements ; mais, dans le monde d'atomes conu par les physiciens, il n'y a que des mouvements. En passant de notre monde celui des atomes, on transforme, entre autres, la chaleur en mouvement ; et pour notre sensibilit il y a une diffrence non de grandeur, mais de nature entre mouvement et chaleur. Il y a aussi une diffrence de nature entre chaleur et mouvement par rapport aux conditions de notre travail. Non seulement nous ne pouvons jamais esprer, quand nous faisons effort, obtenir par aucun procd un rsultat plus grand que ne comporte notre effort - le principe de la conservation de l'nergie nous interdit cet espoir - mais encore nous ne pouvons pas esprer recueillir tout le rsultat que notre effort comporte. Nous perdons de la peine quand nous faisons effort dans le monde, et cette peine perdue, origine de la notion d'entropie, se mesure par un chauffement ; il y a pour nous diffrence de nature entre cette peine perdue et la peine utile, par exemple,
Simone Weil, Sur la science (1966) 111
pour un ouvrier, entre l'chauffement de son outil et la fabrication des pices usines. C'est parce qu'il n'y a que du mouvement, non de la chaleur, dans le monde purement thorique des atomes, que par rapport ce monde seul l'entropie n'a aucun sens ; et c'est pourquoi, pour lui donner un sens par rapport ce monde et au ntre considrs ensemble, il a fallu faire intervenir cette probabilit qui a dtruit la physique classique. La cause n'en est pas dans un changement de dimensions, mais dans la tentative pour dfinit l'entropie, notion essentiellement trangre au mouvement, par le mouvement seul. Au reste un changement d'chelle doit ncessairement produire un bouleversement dans la physique en raison du rle jou par la notion de ngligeable. Quand on nonce des considrations gnrales sur la physique, on passe rapidement sur cette notion, comme par une sorte de refoulement ou de pudeur. Les physiciens non seulement ngligent ce qui est ngligeable, comme ils doivent faire par dfinition, mais ils sont enclins aussi ngliger, tout en en faisant usage, la notion mme de ngligeable, qui est trs exactement l'essentiel de la physique. Le ngligeable, ce n'est pas autre chose que ce qu'il faut ngliger pour construire la physique ; ce n'est nullement ce qui est de peu d'importance, car ce qui est nglig est toujours une erreur infinie. Ce n'est nglig est toujours aussi grand que le monde, exactement aussi grand, car un physicien nglige toute la diffrence entre une chose qui se produit sous ses yeux et un systme parfaitement clos, parfaitement dfini qu'il conoit dans son esprit et reprsente sur le papier par des images et des signes ; et cette diffrence, c'est le monde mme, le monde qui se presse autour de chaque morceau de matire, s'infiltre l'intrieur, met une varit infinie entre deux points si rapprochs soient-ils ; le monde qui empche absolument qu'il y ait aucun systme clos. On nglige le monde, parce qu'il le faut, et, ne pouvant appliquer la mathmatique aux choses un prix moindre, on l'applique au prix d'une erreur infinie. La mathmatique mme implique dj une erreur infinie pour autant qu'elle a besoin d'objets ou d'images. Si je vois deux toiles, je pense entre elles une droite, la plus pure possible, puisqu'elle n'est pas trace ; mais il s'en faut que ces toiles soient des points, elles qui sont plus grandes que notre terre. Si j'crase de la craie sur un tableau noir, j'obtiens - puisque ici il ne peut tre question de l'chelle des gran-
Simone Weil, Sur la science (1966) 112
deurs - quelque chose qui diffre d'une droite autant qu'un ocan tout entier, quelque chose qui diffre infiniment d'une droite. Et, cependant, quelque chose qui n'est pas sans rapport avec la droite ; le rapport consiste en ceci, que cette craie sur le tableau noir me permet d'imaginer la droite ; c'est en ce sens seulement que les figures sont les images des notions gomtriques, non pas qu'elles leur ressemblent, mais pour autant qu'elles nous permettent de les imaginer. C'est cela seulement qu'on veut dire quand on dit d'un peu de craie crase que c'est peu prs une droite. Or, en un sens, une observation, une exprience sont exactement pour un physicien ce qu'est une figure pour un gomtre. Platon, qui savait que la droite du gomtre n'est pas celle qui est trace, savait aussi que les astres qui dcrivent des mouvements circulaires et uniformes ne sont pas ceux que nous voyons la nuit ; et Archimde, qui avait lu Platon, savait certainement, sans avoir eu besoin d'observer le mouvement brownien, qu'il n'y a pas dans la nature de fluide homogne ni de fluide en repos ; il savait aussi que le flau d'une balance est de la matire et non pas une droite. notre poque aussi, l'entropie a t calcule d'aprs la relation entre l'nergie, le volume et la temprature dans les gaz parfaits, ainsi nomms parce qu'ils n'existent pas. Le gomtre, toutes les fois qu'il examine un problme, conoit un systme parfaitement dfini par quelques lments - positions, distances, angles - qu'il s'est lui-mme donns ; il trace une figure propre lui faire imaginer ces lments ; si elle le porte aussi, en mme temps, imaginer autre chose que ce qu'il s'est donn lui-mme, ou il en fait abstraction, ou il change la figure ; mais en aucun cas il ne se donne licence d'imaginer autre chose que ce qu'il s'est donn lui-mme et qui est exprimable en un petit nombre de phrases. De mme un physicien, quand il tudie un phnomne, conoit un systme parfaitement dfini, parfaitement clos, o il ne laisse entrer que ce qu'il s'est lui-mme donn et qui est exprimable en un petit nombre de phrases. Souvent il reprsente son systme, la manire du mathmaticien, par des figures, par des formules ; mais il le reprsente aussi par des objets, et c'est ce qu'on appelle faire une exprience. Son systme contient ou ne contient pas un facteur de changement ; dans le premier cas, le physicien, dans son esprit, conduit le systme dfini par lui d'un tat initial un tat final par l'intermdiaire de la ncessit ; et il cherchera un dispositif exprimental dont l'tat initial d'abord imite l'tat initial du systme clos comme un triangle la craie imite le triangle thorique, puis dont la transforma-
Simone Weil, Sur la science (1966) 113
tion ait avec celle du systme clos le mme rapport. S'il s'agit d'un tat d'quilibre, au contraire, le dispositif exprimental doit rester immobile. Bien entendu, tantt il y a russite et tantt non. S'il n'y a pas russite, le physicien peut modifier son dispositif exprimental pour mieux imiter le systme thorique, comme un gomtre efface sa figure et la recommence avec plus de soin ; aprs quoi, de nouveau, il russira ou non. Il peut aussi juger son systme impossible imiter avec des objets, et s'en donner un autre un peu diffrent partir duquel il espre russir une tentative du mme genre ; et, bien entendu, il tiendra compte pour se le donner de son chec prcdent. Mais l'ordre est toujours le mme ; le dispositif exprimental est toujours une imitation d'un systme purement thorique, et cela mme au cas o, aprs un chec, le systme a t refait d'aprs l'exprience. Il n'en peut tre autrement ; on ne peut pas autrement penser la ncessit. Car la ncessit est essentiellement conditionnelle, et elle apparat l'esprit de l'homme seulement la suite d'un petit nombre de conditions distinctes et parfaitement dfinies ; or c'est l'homme seul qui peut se donner lui-mme, dans son esprit, titre d'hypothse, un certain nombre de conditions parfaitement dfinies, car les conditions que le monde impose en fait son action sont en quantit illimite, non dnombrable, inexprimable, et c'est pourquoi il doit toujours s'attendre tre surpris. Au reste, se donner un systme parfaitement clos, c'est--dire o l'on ne laisse rien entrer, de conditions parfaitement dtermines et en nombre fini, et chercher quelles ncessits, quelles impossibilits y apparaissent, c'est faire de la mathmatique ; la mthode mathmatique, quelque objet qu'elle s'applique, n'est pas autre chose ; et par suite, dans toute la mesure o la notion de ncessit joue un rle en physique, la physique est essentiellement l'application de la mathmatique la nature au prix d'une erreur infinie. Mais quand on a compris que les lignes traces par le gomtre, que les choses objets de l'observation ou de l'exprimentation du physicien, sont des imitations des notions mathmatiques, on a compris bien peu de chose encore. Car on ignore en quoi consiste ce rapport que l'on peut nommer, faute de mieux, imitation. J'crase deux reprises de la craie sur un tableau noir ; j'obtiens deux fois quelque chose d'autre qu'une droite, autre et infiniment diffrent ; cependant il me semble avoir trac la premire fois peu prs une droite, la deuxime
Simone Weil, Sur la science (1966) 114
fois peu prs une ligne courbe. En quoi consiste la diffrence entre ces deux masses de craie ? Le gomtre peut laisser de ct une pareille question, lui qui s'intresse la droite ; le physicien ne le peut pas, car il s'intresse non pas aux systmes clos qu'il btit dans son esprit en s'aidant de signes et de figures, mais au rapport des choses avec ces systmes. Ce rapport est d'une obscurit impntrable. Si l'on examine l'exemple le plus simple, la droite, on trouve que ce qui porte l'homme penser la droite, c'est le mouvement dirig, c'est--dire le projet du mouvement ; les spectacles qui lui font penser la droite sont ou celui d'un point, c'est--dire d'un lieu, s'il pense y aller, ou celui de deux points, s'il pense un chemin menant de l'un l'autre, ou celui de la trace d'un mouvement accompli en pensant la droite, trace de craie sur un tableau noir, d'un crayon sur du papier, d'un bton sur le sable, ou toute autre trace. C'est parce que celui qui a cras de la craie sur un tableau noir pensait la droite en l'crasant que celui qui regarde la craie crase est amen par ce spectacle penser lui aussi la droite. Cette parent entre le mouvement et la vue, fondement de la perception, est un mystre ; il suffit de contempler certains dessins de Rembrandt ou de Lonard, par exemple, pour sentir combien ce mystre est mouvant. Ce n'est pas le seul mystre li la droite ; il y en a d'autres, tous impntrables, et auxquels on ne peut apporter de clart qu'en les nonant et en les sparant. Que la droite pure, l'angle pur, le triangle pur, soient des ouvrages de l'attention qui fait effort en se dtachant des apparences sensibles et des actions, nous en avons conscience toutes les fois que nous pensons ces notions, et ainsi il nous apparat que ces notions nous viennent de nous-mmes ; mais les ncessits, les impossibilits qui leur sont attaches, d'o nous viennent-elles, elles qui s'imposent notre esprit ? Par exemple, l'impossibilit de compter les points d'une droite, ou l'impossibilit de joindre deux points par plus d'une droite. Nous pouvons refuser d'admettre certaines d'entre elles, comme on a fait pour la seconde, comme on n'a pas os faire pour la premire ; mais mme pour le plus profond mathmaticien, les gomtries non euclidiennes ne sont pas sur le mme plan que la gomtrie euclidienne ; nous croyons celle-ci mme malgr nous, au lieu que nous ne pouvons pas tout fait croire aux autres, et devons, pour les laborer, imaginer des courbes quand nous parlons de droites. Deuximement, l'effort d'attention ncessaire pour se dtacher des
Simone Weil, Sur la science (1966) 115
choses et penser le point, la droite, l'angle purs ne peut tre accompli qu'en s'appuyant sur les choses, et la craie crase, le sable creus par des mouvements humains, ou certains objets, constituent des auxiliaires indispensables ; de plus n'importe quelle chose ne permet pas d'imaginer n'importe quelle notion, mais il y a pour notre imagination des liens entre telle chose et telles de ces notions que nous formons en nous arrachant aux choses. Enfin lorsque nous voyons un lieu o nous dsirons aller, nous nous mettons en marche en pensant une direction, c'est--dire une droite ; et bien que nous ayons conscience d'accomplir en mme temps des mouvements qui diffrent infiniment d'une trajectoire droite, nous parvenons fort souvent au lieu dsir. Une branche d'arbre agite par le vent, quoiqu'elle plie un peu, me porte penser la droite dans son rapport avec l'angle ; si je la casse, glisse un bout sous une pierre et appuie sur l'autre bout pour soulever la pierre, c'est encore en pensant la droite dans son rapport avec l'angle ; et quoiqu'il n'y ait rien de commun entre une branche d'arbre et une droite, et que je le sache, je russis souvent. La puret des notions mathmatiques, les ncessits et impossibilits qui y sont attaches, les images indispensables de ces notions fournies par des choses qui ne leur ressemblent pas, le succs des actions conduites en confondant, par une erreur volontaire, les choses avec les notions dont elles sont les images, ce sont autant de mystres distincts et irrductibles, et si l'on labore une solution pour l'un d'eux, on ne diminue pas, on paissit au contraire le mystre impntrable des autres. Par exemple, en admettant que les relations gomtriques sont rellement les lois de l'univers, on rend plus tonnante encore la russite d'actions rgles par une application dlibrment et infiniment errone de ces mmes relations ; si on admet qu'elles sont de simples rsums tirs de beaucoup d'actions russies, on ne rend pas compte ni de la ncessit qui leur est attache et n'apparat pas dans de tels rsums, ni de la puret qui leur est essentielle et les rend trangres au monde ; et ainsi de suite. En pensant la gomtrie, nous pensons toujours que la droite est quelque chose de pur, uvre de l'esprit, trangre aux apparences, trangre au monde ; que des ncessits lui sont attaches ; que ces ncessits sont rellement les lois mmes du monde ; que certaines choses dans le monde, qui nous portent imaginer la droite, et sans lesquelles nous ne pouvons la penser, sont infiniment autres u'elle ; qu'en agissant comme si elles taient des droites notre action sera efficace. Il y a l plus d'une contradiction. Chose trange, ces contradictions, impossibles limi-
Simone Weil, Sur la science (1966) 116
ner, sont ce qui donne la gomtrie une valeur. Elles refltent les contradictions de la condition humaine. Un physicien qui dispose un support, un flau de balance, des poids gaux ou ingaux aux deux bouts, pense une droite tournant autour d'un point fixe, tout en sachant qu'il n'a devant lui ni point fixe ni droite ; une droite n'est pas quelque chose qu'un choc puisse flchir ou briser, qu'un feu puisse fondre. Le physicien fait avec ce flau ce que fait le gomtre avec sa craie crase ; il fait aussi davantage. La craie suit la main du gomtre, et ce qu'il y a de craie crase sur le tableau reste immobile jusqu' ce qu'on l'enlve avec une ponge ; le gomtre fait de simples dessins sur une surface, soustraite tout changement, hors ses propres retouches, pendant la dure de sa mditation. Le physicien manie des objets dans l'espace trois dimensions, et, aprs les avoir manis, il les abandonne exposs au changement. Ainsi abandonns, ils continuent parfois voquer dans l'imagination du physicien les mmes notions mathmatiques qu'ils voquaient lorsqu'il les maniait ; l'exprience alors a russi. Cette manire de dfinit une exprience russie semble trange ; et pourtant il n'est pas possible de dfinir le rapport par lequel les objets sont les images de notions mathmatiques sans passer par l'imagination humaine. Si, comme on a voulu souvent l'affirmer, ce que le physicien nglige dans l'exprience tait une erreur que l'on peut rendre aussi petite que l'on veut, l'omission volontaire du ngligeable constituerait un passage la limite au sens du calcul intgral, et la notion de ngligeable aurait une signification mathmatique. Mais cela n'est pas vrai ; il n'en est jamais ainsi, mme dans les cas les plus favorables. En fait, il n'est pas vrai qu'on puisse force de soins obtenir une surface aussi lisse qu'on veut ; une poque donne, dans un tat de la technique donn, certaines surfaces bien dtermines, plus ou moins polies, sont ce qu'on a fait de mieux dans le genre, et on ne peut aller au-del ; il est toujours permis de supposer que peut-tre plus tard des procds techniques meilleurs produiront des surfaces plus polies, mais on n'en sait rien. Mais si l'on considre un flau de balance, il est tout fait clair qu'aucun progrs technique n'en fera jamais rien qui ressemble une droite tournant autour d'un point fixe. Si trange que cela paraisse, un physicien, regardant un flau de balance, sachant que ce n'est pas une droite, mais port par ce spectacle imaginer une droite, choisit d'accorder crdit son imagination plutt qu' sa raison. Ainsi fit Archimde, ngligeant
Simone Weil, Sur la science (1966) 117
la diffrence infinie qui spare un flau de balance d'une droite, et inventant ainsi la physique. Ainsi faisons-nous encore aujourd'hui. Mais, vrai dire, on avait dj fait ainsi depuis un nombre inconnu de sicles avant Archimde ; exactement depuis qu'on a commenc se servir de balances. L'homme a toujours tent de se donner lui-mme un univers ferm, limit, rigoureusement dfini ; il y russit parfaitement dans certains jeux o tous les possibles sont en quantit dnombrable et mme finie, tels que les jeux de ds, de cartes, d'checs. Les carrs blancs et noirs de l'chiquier, les pices du jeu, les mouvements possibles de chacune en vertu des rgles tant en nombre fini, et une partie d'checs tant quelque chose qui s'achve tt ou tard, toutes les parties d'checs possibles sont en nombre fini, quoiqu'une telle numration soit pratiquement beaucoup trop complique. Il en est de mme, par exemple, pour toutes les parties possibles de belote. La complication est essentielle l'intrt, et l'on ne jouerait pas si l'on pouvait avoir en fait dans l'esprit toutes les parties possibles ; mais quoiqu'elle dpasse la porte de l'esprit humain comme si elle tait infinie, elle est finie pourtant, et cela aussi est essentiel au jeu. Le joueur se donne un univers fini par des rgles fixes qu'il impose ses actions, et qui chaque fois qu'il va jouer lui donnent seulement le choix entre un petit nombre de possibles ; mais aussi par des objets solides, qu'il est port imaginer comme immuables, quoique rien ne soit immuable en ce monde, et qu'il dcide de considrer comme absolument immuables. S'il en est empch certains moments par le spectacle d'un pion d'checs bris, d'une carte dchire, il appelle cela un accident, et il y remdie par un nouvel objet, substitu celui qui a chang et considr comme ne faisant qu'un avec lui. Est nomm accident toute intervention de l'univers dans le systme clos du jeu, et les accidents sont ngligs par le joueur ; le jeu est ainsi le modle de la physique. Il y a d'autres jeux o les possibles ne sont pas en nombre fini, quoiqu'ils forment aussi un ensemble bien dfini ; dans ces jeux, le nombre gnralis joue le rle que joue dans les premiers le nombre proprement dit. Tels sont les jeux o interviennent des objets plus ou moins ronds regards comme des sphres et des surfaces plus ou moins unies regardes comme des plans, jeux de balles, de billes, de boules, billard. Dans ces jeux aussi des objets solides dont la forme est regarde comme immuable, des rgles fixes imposes aux mouvements et limi-
Simone Weil, Sur la science (1966) 118
tant les possibles, quoique l'ensemble des possibles y ait la puissance du continu, dterminent un systme clos, et les accidents sont ngligs. Les accidents peuvent tre ngligs dans les jeux, prcisment parce qu'il s'agit de jeux. Ils sont plus malaiss ngliger dans le travail, o la faim, le froid, le sommeil, le besoin fouettent sans cesse, o les rsultats sont ce qui importe, o un accident rend les efforts vains, cause le malheur ou la mort. Nanmoins la notion d'accident a aussi un sens pour le travailleur, elle est essentielle aussi au travail, et, comme un accident est toujours en un sens ce qu'on nglige, tout au moins dans le projet, on peut conjecturer que le travail a emprunt cette notion au jeu ; le travail en ce cas procderait du jeu, imiterait le jeu, imitation dont peut-tre on trouverait la marque, plus clairement que chez nous, dans les murs de certaines populations, dites primitives. Pour chaque tre humain en tout cas le jeu prcde le travail. Le travail est analogue aux jeux o les possibles forment un ensemble continu ; comme dans les jeux, des objets solides, dont la forme est considre comme immuable, dont toute dformation est considre comme un accident, servent d'instrument classer et dfinir les possibles, et comme dans les jeux certaines rgles dterminent les mouvements. Le travailleur aussi, comme le joueur, quoique un degr moindre - car il ne peut effacer chaque instant les rsultats de l'action passe et revenir au point de dpart - vit dans un monde ferm, limit et dfini, grce aux outils et aux rgles d'actions qu'il s'est donnes. je nue une bche en la tenant par le manche, en posant mon pied sur le fer, en imprimant mon corps, par rapport la bche, des attitudes dfinies ; je la manie en pensant la droite dans son rapport avec l'angle ; et toute la varit de matire que rencontre la bche s'ordonne en sries de grandeurs continues, selon le plus ou moins de rsistance que rencontre chaque mouvement. Quoi de plus incertain et vari que la mer et le vent ? Mais un bateau est un solide fixe, auquel on choisit seulement d'imprimer, en maniant la voilure et le gouvernail, des changements qui forment des sries continues, mais parfaitement dfinies ; il ne peut subir de changement qui soit hors de ces sries, sinon par l'effet d'un accident ; le matin, en maniant le bateau, en prouvant l'effort du vent sur les voiles, de l'eau sur le gouvernail, pense des orientations, des mouvements droits, la droite dans son rapport avec l'angle ; et les tats infiniment varis de la mer et de l'air
Simone Weil, Sur la science (1966) 119
s'ordonnent en sries dfinies par rapport l'tat des voiles et du gouvernail, l'orientation et la vitesse du bateau, qui correspondent chacun. Les outils sont tous des instruments ordonner les apparences sensibles, les combiner en systmes dfis, et en les maniant l'homme pense toujours la droite, l'angle, le cercle, le plan ; ces penses dirigent son action, au prix d'une erreur infinie qu'il nglige. L'homme doit se donner lui-mme des systmes dfinis en se fixant lui-mme des rgles pour ses mouvements, et en se fabriquant des objets solides, de forme bien dfinie, instruments de jeu ou de travail, ou encore, comme la balance, de mesure. Il ne trouve pas des systmes dfinis tout faits dans la nature autour de lui, ou plutt il en trouve un seul. C'est celui que constituent les astres. Les astres sont des objets spars, distincts ; l'apparence de beaucoup d'entre eux est immuable si elle n'est altre par l'accident des nuages ; le nombre de ceux qu'on voit l'il nu, ou qu'on voit avec des instruments donns, est fini, quoiqu'il soit trs grand ; les apparences du ciel nocturne correspondant aux diverses formes que prend la lune, telles et telles positions relatives du soleil, de la lune, des plantes, des toiles, s'ordonnent en sries parfaitement dfinies. Les apparences du ciel nocturne forment un systme si rigoureusement dfini, si bien clos, si bien dfendu contre les accidents, quoiqu'une part y soit faite aussi aux accidents grce aux comtes et aux toiles filantes, que certains jeux peuvent seuls fournir la pense humaine un ensemble de combinaisons aussi maniable ; mais le choix du joueur chaque coup met dans tout jeu une part d'arbitraire qui ne se trouve pas parmi les astres, et l'attente du joueur qui mdite son coup, la dure incertaine et variable d'une partie, empchent qu'il y ait dans aucun jeu le rythme invariable qui rgne dans le ciel. Les astres, ces objets merveilleux, brillants, inaccessibles, au moins aussi lointains que l'horizon, que nous ne pouvons jamais ni changer ni toucher, qui ne touchent en nous que les yeux, sont ce qu'il y a de plus loin et de plus prs de l'homme ; seuls dans l'univers ils rpondent au premier besoin de l'me humaine ; ils sont comme un jouet donn l'homme par Dieu. La divination, qui se sert parfois des cartes, se sert aussi parfois des astres ; entre un systme dfini de possibles et la divination, il y a une parent naturelle. Il y a aussi une parent naturelle entre de tels systmes et la science. Les astres, les jeux tels que billes , billard, ds, les instruments communs de mesure comme la balance, les outils et machines simples, toutes
Simone Weil, Sur la science (1966) 120
ces choses ont toujours t par excellence les objets de la mditation des savants. Mais plus les astres conviennent la science, plus ils sont mystrieux, car cette convenance est un don, un mystre, une grce. Les Grecs, qui leur attribuaient des mouvements circulaires et uniformes, n'expliquaient ces mouvements que par la perfection des astres et leur caractre divin. L'astronomie classique n'a pas fourni d'explication plus positive, car l'attraction distance dont parle Newton ne rpond nullement ce que demande la pense humaine dans la recherche des causes ; comment concevoir que l'espace qui spare deux astres, lieu sans doute comme tout espace d'vnements infiniment varis, ne dtermine jamais de changement dans le rapport qui les unit ? Et, malgr la perfection de nos tlescopes et les recherches raffines de la spectroscopie, nous n'en savons pas plus aujourd'hui ; nous ne pouvons pas en savoir plus ; la convenance des astres avec le besoin de l'imagination humaine est un mystre irrductible. Les jeux et les outils semblent d'abord moins mystrieux, puisqu'ils sont fabriqus par l'homme. Mais que nous puissions fabriquer de tels objets, les manier d'aprs la supposition qu'ils sont, sauf accidents, immuables, les manier en pensant leur place des sphres, des cercles, des plans, des points, des droites, des angles, et les manier ainsi efficacement, c'est une grce aussi extraordinaire que l'existence des astres. C'est une seule et mme grce, et, chose trange, l'objet tudi par la science n'est autre que cette grce. Nous refusons le monde pour penser mathmatiquement ; et l'issue de cet effort de renoncement le monde nous est donn comme par surcrot, au prix, il est vrai, d'une erreur infinie, mais rellement donn. Par ce renoncement aux choses, par ce contact avec la ralit qui l'accompagne comme une rcompense gratuite, la gomtrie est une image de la vertu. Pour poursuivre le bien aussi nous nous dtournons des choses, et recevons le monde en rcompense ; comme la droite trace la craie est ce qu'on trace avec la craie en pensant la droite, de mme l'acte de vertu est ce qu'on accomplit en aimant Dieu, et, comme la droite trace, il enferme une erreur infinie. La grce qui permet aux misrables mortels de penser, d'imaginer, d'appliquer efficacement la gomtrie, et de penser en mme temps que Dieu est un perptuel gomtre, la grce lie aux astres, aux danses, aux jeux et aux travaux est merveilleuse, mais n'est pas plus merveilleuse que l'existence mme de l'homme, car c'en nt une condition. L'homme tel
Simone Weil, Sur la science (1966) 121
qu'il est, livr aux apparences, aux douleurs, aux dsirs, et destin autre chose, infiniment diffrent de Dieu et oblig d'tre parfait comme son Pre cleste, n'existerait pas sans une telle grce. Le mystre de cette grce est insparable du mystre de l'imagination humaine , du mystre du rapport qui unit chez l'homme les penses et les mouvements, insparable de la considration du corps humain. La science de la nature, qui est un des effets de cette grce, n'tudie, en dehors des astres, que des objets fabriqus par le travail humain, et fabriqus d'aprs des notions mathmatiques. Dans un laboratoire de physicien, dans un muse de la physique tel que le Palais de la Dcouverte, tout est artificiel ; il n'y a que des appareils ; et dans la moindre partie d'un appareil, combien de travail, de peine, de temps, d'ingniosit et de soins dpenss par des hommes ! Ce n'est pas la nature qui est tudie l. Comment s'tonner que l'chelle du corps humain joue dans la science un rle qu' premire vue une chelle de grandeurs semblerait ne pas devoir jouer ? La physique explore le domaine o il est permis l'homme de russir en appliquant la mathmatique au prix d'une erreur infinie. Le XIXe sicle, ce sicle qui a cru au progrs illimit, qui a cru que les hommes s'enrichiraient de plus en plus, qu'une technique constamment renouvele leur permettrait de jouir de plus en plus en travaillant de moins en moins, que l'instruction les rendrait de plus en plus raisonnables, que la dmocratie pntrerait de plus en plus les murs publiques dans tous les pays, a cru aussi que ce domaine tait tout l'univers. Ce sicle, exclusivement attach des biens prcieux, mais non pas suprmes, des valeurs subordonnes, a cru y trouver l'infini ; il tait moins malheureux que le ntre, mais touffant ; le malheur vaut mieux. En dpit de l'orgueil que nous avons hrit de ce sicle, et dont malgr notre misre nous n'avons pas encore pris la peine de nous dpouiller, il vaut souvent mieux, mme aujourd'hui, s'adresser un vieux paysan qu' un institut de mtorologie si l'on est curieux de savoir le temps qu'il fera le lendemain. Les nuages, les pluies, les orages, les vents, sont encore aujourd'hui en grande partie hors du domaine o nous pouvons substituer aux choses, avec succs, des systmes dfinis par nous ; et qui sait si ce n'est pas pour toujours ? Dans les domaines o, au milieu du XIXe sicle, de telles substitutions taient possibles, les savants taient parvenus tablir une certaine unit, une certaine cohrence. Cela ne s'tait pas fait sans beaucoup
Simone Weil, Sur la science (1966) 122
d'efforts et de ttonnements. La pense humaine a non pas toute licence, mais parfois une certaine licence dans le choix du systme rigoureusement dfini qu'elle substitue aux choses l'occasion de tel ou tel phnomne, et peut ainsi choisir en vue de la plus grande cohrence possible entre les diffrents systmes ; la pense peut dans une certaine mesure choisir ce qu'elle dcide de ngliger. L'histoire des ttonnements de la science est en grande partie, peut-tre tout entire, l'histoire des applications diffrentes et successives de la notion de ngligeable.
Simone Weil, Sur la science (1966) 123
Sur la science [crits publis entre 1932 et 1942.] (1932-1942)
L'avenir de la science
Retour la table des matires
Cet ouvrage 29 est dirig contre l'esprit qu'on nomme scientisme. vrai dire, il y a deux scientismes distincts : celui du XIXe sicle, reprsent par la pitoyable trinit Taine, Renan, Berthelot, dont Bergson a contribu nous dlivrer, mais trs vivant encore dans la masse, chez les successeurs de M. Homais, de Bouvard et Pcuchet, et mme chez beaucoup d'honntes gens ; et le scientisme contemporain, qui a perdu toute rigidit, mais par un singulier paradoxe n'en est pas moins troit. Il s'accommode fort bien de l'antinationalisme, de l'antiintellectualisme, du surralisme, de tout absolument, except de ce qui est d'ordre authentiquement spirituel. C'est particulirement le cas en France, o existe une cole de sociologie grce laquelle on peut tudier les mythes, le folklore, les civilisations antiques et celles des populations de couleur sans trouver nulle part aucune trace de spiritualit. L'exposition de 1937, dj si loin de nous, fut pour une part une manifestation du scientisme contemporain ; un homme fort cultiv et haut plac dans la hirarchie universitaire souhaitait srieusement, aprs l'avoir visite, que dans chaque village de France on remplat l'glise par un Palais de la Dcouverte en miniature.
29 L'Avenir de la science, par Louis de Broglie, Andr Thrive, Rayrnond Char-
met, Pierre Devaux, Daniel-Rops, le R. P. Sertillanges (Paris, Plon, collection Prsences , 1941).
Simone Weil, Sur la science (1966) 124
La collection Prsences , on le sait, est d'inspiration catholique. Il est juste que les catholiques remettent le Palais de la Dcouverte sa place lgitime par rapport l'glise. Ils n'ont que trop tard ; ils ne se laissent que trop imprgner par l'atmosphre mme qu'ils veulent abolir, tant est grand l'empire de l'poque o l'on vit. Ainsi le R.P. Sertillanges, dans un essai plein de bon sens, montre qu'aucun homme de talent n'a t pleinement scientiste, parce que les limites de la science sont videntes. Mais il ajoute : Renan a eu raison d'crire : Le grand rgne de l'esprit ne commencera que quand le monde matriel sera parfaitement soumis l'homme. Or telle est l'oeuvre de la science. Trs probablement le R.P. Sertillanges veut dire seulement que la contemplation exige du loisir, et que parmi les conditions du loisir se trouve la technique. Mais en fait il dit tout autre chose ; et on serait tent de lui demander si la domination du monde par l'esprit humain n'est pas ce qui dfinissait le Paradis terrestre, si l'homme n'est pas devenu soumis la chair et la matire, qui lui imposent entre autres contraintes celle du travail, en mme temps qu'il est devenu pcheur, et si ce qu'a fait le pch peut tre dfait autrement que par la grce. Daniel-Rops expose de nouveau, avec beaucoup de clart et de talent, les conceptions nagure diffuses par le groupe Ordre Nouveau . Elles sont simples. La technique actuelle tend rduire presque rien la part du labeur humain dans la fabrication des produits, et du mme coup aussi le profit du capital et la valeur des marchandises fabriques en sries. Favorisons cette volution ; que tout travail de manuvre soit aboli, l'exception d'une courte priode de service civil impose au peuple entier ; que la fabrication des produits ncessaires la vie soit socialise, et que ces produits soient distribus gratuitement. Les loisirs seront librement employs des travaux qualifis pour lesquels la loi de l'offre et de la demande subsistera. Pour dcrire ainsi l'avenir, Daniel-Rops emploie, comme ferait n'importe quel marxiste, des verbes au futur ; un musulman lui apprendrait qu'il est imprudent d'employer un verbe au futur sans ajouter inch' Allah , s'il plat Dieu . Si les passions tenaient aussi peu de place dans l'organisation sociale que le suppose ce plan, on pourrait obtenir une organisation quitable mme avec une faible technique. Les gens de l' Ordre Nouveau , d'ailleurs trs sympathiques, oubliaient qu'en toute affaire humaine le problme des stimulants est capital, aussi im-
Simone Weil, Sur la science (1966) 125
portant que celui de la source d'nergie pour un moteur. Ils auraient d le comprendre pourtant quand ils ont tent d'organiser une bauche de service civil volontaire et qu'ils ont chou ; ils ont chou parce que rien ne poussait les gens les suivre. Un peuple soumis une courte priode de travail obligatoire et non rmunr ne travaillera vritablement que sous la pression d'un pouvoir central despotique et sous la menace de chtiments terribles, moins qu'on ne dcouvre d'autres stimulants vraiment efficaces ; il faudrait une vritable dcouverte. Quant aux longues annes de loisir, il faut tre naf, surtout aujourd'hui, pour ne pas penser que certains les consacreraient au seul jeu vraiment passionnant pour les hommes, le jeu qui a pour objet la domination sur les hommes ; quand on est entr dans ce jeu, on en sort malaisment ; comme ce jeu exige des ressources illimites, en armes et autrement, la priode de travail forc impos au peuple aurait bientt la longueur d'une vie entire. Daniel-Rops, cdant sans s'en rendre compte au prestige du marxisme, qui fait partie pourtant de ce scientisme qu'il combat, croit que les guerres proviennent des difficults conomiques ; mais ce sont les difficults conomiques qui proviennent avant tout de la volont de puissance dont la guerre est un aspect. Ces problmes demandent tre examins de prs, car si les esprances de Daniel-Rops sont effectivement illusoires, ces illusions, au moment o nous sommes, sont trs dangereuses. Andr Thrive a crit quelques pages amusantes concernant les diffrentes formes du roman scientifique, de Cyrano de Bergerac jusqu' Huxley. Pierre Devaux fait un tableau des inventions passes et venir, fort intressant en ce qui concerne le pass. Raymond Charmet, au sujet de ce qu'il nomme le mythe moderne de la science , fait un certain nombre de citations dont plusieurs sont des perles de sottise pure ; ainsi celle-ci, (de J. Perrin, dans la prface des Atomes : Le Destin vaincu semble permettre enfin un Espoir sans limites. L'essai le plus intressant du volume est naturellement celui de Louis de Broglie. Il est limit, clair, parfaitement prcis, et chaque mot instruit. D'une manire gnrale, la comparaison entre les savants contemporains, autant que leurs crits destins au public permettent de les apprcier, et des esprits tels que Lavoisier, Lagrange, Ampre, sans parler de Galile ou Archimde, est profondment attristante ; mais un savant comme Louis de Broglie apporte quelque rconfort.
Simone Weil, Sur la science (1966) 126
Pourtant ce qu'il dit de la philosophie tmoigne d'une navet qui est bien de notre poque. Tous les apports de la science la philosophie qu'il croit discerner sont illusoires, en ce sens que ce qu'il croit nouveau ne l'est pas. La mcanique quantique a, il est vrai, achev de dlivrer la philosophie du scientisme la mode du XIXe sicle ; mais, sans l'aide des quantas, un peu d'intelligence pouvait suffire aux philosophes pour une telle dlivrance. On se doutait, avant les quantas, qu'il n'y a pas seulement de la continuit dans l'univers, mais aussi de la discontinuit ; dj les pythagoriciens, par exemple, attachaient de l'importance aux nombres. La notion de changement qualitatif a toujours impliqu certaines actions impossibles reprsenter dans notre cadre spatio-temporel usuel . Un physicien seul peut parler du dterminisme apparent de l'chelle macroscopique ; l'chelle de nos sens, il n'y a apparence de dterminisme que dans le laboratoire. Qu'on demande un mtorologue ou un paysan s'ils aperoivent beaucoup de dterminisme dans les orages ou la pluie ; qu'on regarde la mer, et qu'on se demande si les formes des vagues laissent apparatre une ncessit trs rigoureuse ! vrai dire, les physiciens ont cru, au XIXe sicle, qu'il n'y avait pas plus de choses dans le ciel et la terre que dans leur laboratoire ; encore faudrait-il dire, leur laboratoire au moment o une exprience russissait. L'obsession professionnelle tait leur excuse ; ceux qui, sans cette excuse, partageaient leur croyance taient des sots. Les physiciens d'aujourd'hui n'ont plus cette illusion ; tant mieux ; mais ils ont tort de supposer que par l ils apportent quelque chose de nouveau. Le dterminisme, dit M. de Broglie, ne peut tre maintenu qu' titre de postulat mtaphysique . Mais il n'a jamais t autre chose pour aucun homme de quelque intelligence. Il n'tait pas autre chose pour Lucrce. La mcanique quantique a de mme dissip, concernant la notion si importante de ngligeable , une confusion que le moindre effort critique pouvait abolir aussi bien. On nglige en fait ce qui est trs petit par rapport l'objet qu'on poursuit. Les physiciens ont voulu rendre ngligeable en droit ce qu'ils ngligeaient en fait, par une assimilation avec l'infiniment petit de la mathmatique. Plus une plaque de mtal est lisse, plus lentement diminue la vitesse de la bille qui y
Simone Weil, Sur la science (1966) 127
roule horizontalement. je ne peux pas rendre la plaque de mtal aussi lisse que je veux ; mais aprs m'tre procur ce qu'il y a de plus lisse sur le march, je peux imaginer que dans vingt ans on en fabriquera de plus lisses. D'autre part, plus je pousse loin la srie 1,999 etc., moins la quantit obtenue diffre de 2, et pour cette raison je dis que 1,999 ... 9 est gal 2. Par analogie, je dis aussi que la bille roule sur une plaque lisse avec une vitesse uniforme. Mais il y a en ralit une grande diffrence entre les deux passages la limite ; la quantit que les mathmaticiens nomment infiniment petite peut tre diminue par le calcul, n'importe quel moment, exactement autant qu'on veut ; la quantit que les physiciens nomment ngligeable ne peut pas tre prsentement diminue plus que ne le permet l'tat prsent de la technique, et pour la diminuer davantage il faudra un progrs technique actuellement incertain. Il n'y a donc pas d'infiniment petit en physique. Cela est vident, mais on l'avait oubli, et la mcanique quantique a forc de le reconnatre. On s'est aperu rcemment que les procds d'observation et de mesure ont une action sur les phnomnes observs ; ainsi nous ne pouvons pas saisir un phnomne tel qu'il serait si nous ne l'observions pas. Cette vrit vidente n'a jamais t ignore, mais on pensait que cette action pouvait tre indfiniment diminue par les progrs de la technique exprimentale, et ainsi on l'assimilait en droit un infiniment petit. Aujourd'hui la mcanique quantique pose tort ou raison qu'il y a une limite infranchissable au progrs technique dans le sens de l'exactitude. Ds lors il y a l une cause d'erreur irrductible. Mais quand ! mme on franchirait un jour la limite pose aujourd'hui par la mcanique quantique, il resterait vrai que l'observation trouble le phnomne observ, et que ce trouble n'est pas infiniment petit. M. de Broglie signale une ide philosophique nouvelle invente par les physiciens, ou plutt par un physicien, M. Bohr. M. Bohr l'a nomme complmentarit et en donne pour exemple l'aspect ondes et l'aspect corpuscule de la matire, l'aspect vital et l'aspect physico-chimique dans la description des tres vivants. Plus on va loin dans la prcision l'gard d'un de ces aspects, moins on va loin l'gard de l'aspect qui lui est li, et rciproquement.
Simone Weil, Sur la science (1966) 128
Cette complmentarit n'est pas autre chose que l'antique corrlation des contraires, celle qui tait la base de la pense d'Hraclite et de Platon. Il n'y a pas l de nouveaut du point de vue philosophique, mais l'intrt de cette conception n'en est pas moindre, car rien n'a tant d'intrt en philosophie que l'invention rcente d'une ide ternelle. Mais du point de vue de la science il y a l une grande nouveaut ; car depuis la Renaissance on avait tent de rduire toute la science l'unit. Ambition folle. Aujourd'hui l'on est contraint d'y introduire la corrlation des contraires ; heureuse contrainte ; car nulle pense humaine n'est valable si la corrlation des contraires n'y est pas reconnue. Mais c'est une relation difficile bien manier, et si les savants veulent dsormais en faire usage, il leur faudra une formation philosophique srieuse. Hraclite, Platon, Kant pourront leur servir d'instituteurs, non pas les auteurs contemporains. En revanche, la science ne peut pas dans son progrs apporter quelque chose de nouveau la philosophie. Cela pour deux raisons. D'abord la science ne peut pas tre autre chose pour le philosophe qu'une matire de rflexion. Le philosophe trouve s'instruite auprs des savants comme auprs des forgerons, ou des peintres, ou des potes, mais non pas davantage, ni surtout d'une autre manire. Mais la raison principale, c'est qu' proprement parler il n'y a pas de nouveaut possible en philosophie. Quand un homme introduit dans la philosophie une pense nouvelle, ce ne peut gure tre qu'un accent nouveau imprim une pense non seulement ternelle en droit, mais antique en fait Les nouveauts de cette espce, qui sont d'un prix infini, ne sont produites que par la longue mditation d'un grand esprit. Mais des nouveauts au sens o on l'entend d'ordinaire, il n'y en a pas. La philosophie ne progresse pas, n'volue pas ; c'est pourquoi les philosophes sont mal leur aise aujourd'hui, car ils doivent trahir leur vocation ou n'tre pas la mode. La mode aujourd'hui est de progresser, d'voluer. C'est mme quelque chose de plus contraignant qu'une mode. Si le grand public savait que la philosophie n'est pas susceptible de progrs, il souffrirait mal sans doute qu'elle ait part aux dpenses publiques. Il n'est pas dans l'esprit de notre poque d'inscrire au budget ce qui est ternel. Aussi la plupart des philosophes contemporains ne se rclament-ils pas de cette ternit qui est leur privilge. C'est pourquoi, si les conceptions de Louis de Broglie concernant les rapports de la science et de la philosophie ne sont pas dignes d'un esprit
Simone Weil, Sur la science (1966) 129
comme le sien, ce n'est pas lui qu'il faut en faire grief, c'est aux philosophes que les hasards de la vie lui ont fait rencontrer. Quoi qu'il en soit, ce livre apporte un rconfort. Il montre qu'aujourd'hui encore il est possible de rflchir, et de publier des livres qui donnent rflchir. mile NOVIS 30
30 Voir la Note de l'diteur.
Simone Weil, Sur la science (1966) 130
Sur la science [crits publis entre 1932 et 1942.] (1932-1942)
Rflexions propos de la thorie des quanta
31
Retour la table des matires
Deux notions ont mis un abme entre ce que l'on entendait par science depuis la Grce antique et ce que l'on entend aujourd'hui sous ce nom ; ces notions sont celles de relativit et de quanta. La premire a fait beaucoup de bruit dans le grand public ; le nom de la seconde y est peine connu. Toutes deux datent du dbut de ce sicle, et furent subversives de la mme manire, savoir en introduisant dans la science une contradiction accepte et affirme. En ce qui concerne la relativit, il ne s'agit pas ici de la relativit gnralise, qui consiste tendre tous les mouvements possibles la notion de relativit que la mcanique classique n'appliquait qu'aux mouvements rectilignes et uniformes ; ide certainement propre au
31 Max Planck, Initiations la physique. Flammarion, 1941. On ne peut s'emp-
cher de signaler ici certaines ngligences dans l'dition : aucune date n'est indique, et les formules algbriques mises en note sont pleines de fautes d'impression. (Note de S. W.)
Simone Weil, Sur la science (1966) 131
moins fournir des thmes de rflexion extrmement fconds. Il s'agit de la relativit restreinte, fort mal nomme, car elle n'a gure de rapport avec la notion de relativit du mouvement. C'est une thorie fort simple ds qu'on renonce la comprendre. D'une part, les travaux de Copernic, Kepler, Galile, Newton, ont amen attribuer certains mouvements la terre et aux diffrents corps clestes ; d'autre part, une srie d'expriences a abouti une certaine mesure de la vitesse de la lumire ; enfin certaines expriences de la fin du XIXe sicle firent regarder la vitesse de la lumire comme constante dans toutes les directions. Ces rsultats sont contradictoires ; une vitesse finie ne peut pas tre constante dans toutes les directions si on la mesure partir d'un systme qui se trouve lui-mme en mouvement dans une certaine direction. Nanmoins Einstein traduisit en formules algbriques ces conclusions inconciliables entre elles, combina les formules comme si elles pouvaient tre vraies en mme temps et en tira des quations. Il se trouve que dans ces quations la lettre qui reprsente le temps et chacune de celles qui correspondent aux trois coordonnes de l'espace figurent d'une manire symtrique. La traduction de ces quations en langage vulgaire a produit les paradoxes qui ont procur Einstein une renomme d'assez mauvais aloi, tel que celui du temps regard comme une quatrime dimension. Le paradoxe des quanta n'est pas moins violent, il l'est peut-tre davantage, quoique moins frappant au premier abord ; de plus, il est antrieur en date. La thorie des quanta, dont Planck est le premier auteur, et qui constitue aujourd'hui encore la proccupation principale des physiciens, porte sur la notion centrale de la science, la notion d'nergie. Elle consiste considrer l'nergie, ou bien l'action, produit de l'nergie par le temps, comme une grandeur qui varie d'une manire discontinue, par bonds successifs, et ces bonds sont ce qu'on nomme les quanta. Or tout l'effort de la science, depuis Galile, a consist ramener tous les phnomnes sans exception des changements dans les rapports d'espace et de temps, n'admettre comme facteurs variables que les distances, les vitesses et les acclrations ; l'espace et le temps ne peuvent pas se reprsenter autrement que comme des grandeurs continues ; et l'nergie est prcisment la notion au moyen de laquelle on ramne tout l'espace et au temps. Si je suis deux kilomtres d'un lieu, et qu'aprs avoir march Je ne me trouve plus qu' un kilomtre, quelque chemin que j'aie pris, quelques d-
Simone Weil, Sur la science (1966) 132
tours que j'aie pu faire, j'ai pass par toutes les distances intermdiaires entre deux kilomtres et un kilomtre, sans aucune exception. On peut mettre en doute cette proposition, comme n'importe quelle autre, mais il est impossible de se reprsenter la proposition contraire. Or la science concerne les phnomnes, et par suite, contrairement la pense mtaphysique ou mystique, se trouve au niveau de la reprsentation, ou immdiatement au-dessus ; une explication scientifique qui n'est aucunement reprsentable est vide de signification. On peut se convaincre en ouvrant n'importe quel manuel que la notion d'nergie drive de la notion de travail et s'y ramne, et que le travail se dfinit par l'lvation d'un certain poids une certaine hauteur. Dire qu'il y a diffrence d'nergie entre tel et tel tat d'un systme, c'est dire qu'on peut se reprsenter une transformation o d'une part le systme passerait de l'un l'autre tat, et o en contrepartie tel poids monterait ou descendrait de telle hauteur. Ds la premire tude des phnomnes mcaniques, on y trouva un invariant dfini par le produit conventionnel d'une force et d'une distance. Archimde a fond la mcanique en dmontrant qu'une balance symtrique reste en quilibre si, d'un ct du point d'appui, on modifie le poids tout en le changeant de place, condition que le produit du poids par la distance au point d'appui reste invariable. Galile montra qu'une bille tant successivement lche d'une mme hauteur sur des plans d'inclinaisons diffrentes, le produit de la distance qu'elle parcourt par la force qui la pousse est chaque fois le mme. Il posa comme loi gnrale de l'quilibre que, lorsque deux corps, entrans chacun par une force, sont maintenus en repos par leur liaison mutuelle, les produits respectifs de la force et de la distance qui serait parcourue sans cette liaison sont gaux. Il fit voir, et Descartes aprs lui, qu'un tel produit est aussi la clef des machines simples, lesquelles, bien qu'elles pargnent de la peine aux hommes, ne changent jamais, en aucun cas, le produit de la force vaincre par le dplacement accomplir. Au reste la balance, sous le nom de levier, est une machine simple, et de mme le plan inclin lorsqu'on y fait monter un poids. Plus tard, on se servit de ce mme produit comme clef de tous les phnomnes de dynamique, sous le nom d'nergie cintique ou de force vive. La formule du mouvement uniformment acclr ou re-
Simone Weil, Sur la science (1966) 133
tard montre que lorsqu'une bille, roulant vitesse uniforme sur un plan horizontal, rencontre un plan inclin et monte une certaine hauteur, le travail ainsi accompli, c'est--dire le produit de cette hauteur par le poids de la bille, est gal au demi-produit de sa masse par le carr de la vitesse avec laquelle elle roulait sur le plan horizontal. Ainsi l'nergie cintique d'un corps en mouvement, autrement dit ce demi-produit, est le travail que ce corps peut accomplir, dans certaines conditions, grce sa seule vitesse. L'nergie potentielle est le travail qu'un corps peut accomplir, grce sa seule position, au moyen d'une impulsion infiniment petite, comme lorsqu'une bille se trouve sur une table ; le thorme de la conservation de l'nergie pose que, dans un systme purement mcanique, la somme de l'nergie cintique et de l'nergie potentielle reste constante tant qu'aucun travail n'est accompli par l'extrieur sur ce systme ou par ce systme sur l'extrieur. La grande ide du XIXe sicle fut d'assimiler des travaux, au moyen d'quivalences numriques, les changements autres que des dplacements. Joule commena. Si on laisse tomber d'un mtre un poids d'un kilo qui dans sa chute, au moyen d'une poulie, fasse tourner un petit moulin palettes plac dans un rcipient plein d'eau, la temprature de l'eau s'lve ; l'nergie calorifique qui produit cette lvation de temprature est gale un kilogrammtre. Joule vrifia que plusieurs procds mcaniques diffrents permettent toujours, au moyen de la mme dpense d'nergie mcanique, d'lever la mme masse d'eau de 0o 1o. Aprs beaucoup d'expriences analogues, les savants du XIXe sicle posrent que dans tout phnomne il y a accroissement ou diminution d'une nergie quivalente de l'nergie mcanique ; ce principe trouve un grand nombre d'heureuses applications dans l'tude des phnomnes chimiques et lectriques. Le principe fondamental de la science du XIXe sicle est qu'on doit pouvoir, au sujet de tout phnomne, se reprsenter au moins thoriquement soit la production de ce phnomne au moyen du dplacement d'un poids, soit le dplacement d'un poids au moyen de ce phnomne. Le mot d'nergie n'a pas d'autre sens, et c'est pourquoi toute espce d'nergie se mesure en ergs, unit dfinie par l'lvation d'un poids. Un poids ne peut pas avoir d'abord telle hauteur, puis telle autre, sans passer par toutes les hauteurs intermdiaires, sans exception. La distance est une grandeur continue ; aucune gomtrie, mme non eu-
Simone Weil, Sur la science (1966) 134
clidienne, ne la reprsente autrement. Le temps, qui, pour les physiciens, se reprsente par le mouvement uniforme, c'est--dire par la distance, est une grandeur continue. Il en est de mme pour la vitesse, rapport de la distance au temps, pour l'acclration, rapport de la vitesse au temps. Dans aucune dfinition de l'nergie mcanique il n'entre d'autres grandeurs que distance, vitesse, acclration, combines la masse ; l'action est un produit de l'nergie et du temps. L'nergie non mcanique, c'est ce qui, dans tous les phnomnes non mcaniques, est pos comme quivalent l'nergie mcanique. Il est facile ds lors de sentir combien il est extraordinaire de parler de quanta d'nergie ou d'action. Le plus singulier est que, lorsque Planck affirma : La matire ne peut mettre l'nergie radiante que par quantits finies proportionnelles la frquence , il ne fut pas conduit cette proposition par l'tude des phnomnes microscopiques ou l'exprience permet de mesurer des seuils, mais par celle d'un phnomne macroscopique, le rayonnement noir. La notion d'irrversibilit avait t introduite dans la conception de l'nergie par le deuxime principe de la thermodynamique, le principe de Clausius, dit principe de la dgradation de l'nergie. Cette notion avait amen celle de probabilit, par l'ide simple qu'un passage d'un tat plus probable un tat moins probable est pratiquement irrversible ; si on balaie de la main des caractres d'imprimerie qui formaient un vers de Valry, on les mettra en dsordre, et si on les balaie encore de la main un grand nombre de fois, on ne reformera pas un vers de Valry. Le physicien Boltzmann, contemporain de Planck, avait interprt ainsi les phnomnes irrversibles tels que la transformation de l'nergie mcanique en nergie calorifique dans le frottement. Planck tenta de reconstruire au moyen de probabilits, et d'une manire conforme aux donnes de l'exprience, le phnomne dit du rayonnement noir. C'est dans les formules de ces probabilits qu'il trouva de la discontinuit ; il introduisit la discontinuit dans l'nergie parce que ces probabilits sont fonctions de l'nergie. On ne peut s'empcher de se demander s'il n'aurait pas pu faire autrement. L'exprience ne le contraignait certainement pas ; car, comme les mesures n'taient pas microscopiques, elles ne pouvaient
Simone Weil, Sur la science (1966) 135
fournir des seuils, mais seulement des points de repre entre lesquels il fallait interpoler. On est toujours libre d'interpoler au moyen de fonctions soit discontinues, soit continues. Il semble donc que Planck aurait pu trouver des fonctions autres vrai dire que celles qui sont exiges par la mcanique classique, puisque celles-ci taient en dsaccord avec l'exprience, mais continues. On est tent de se demander si ce n'est pas la nature mme du calcul des probabilits, lequel a pour point de dpart le jeu de ds, et par suite des relations numriques, qui a amen Planck introduite des nombres entiers dans ses formules. Ce serait certes une origine bien trange pour une si grande rvolution. En tout cas il introduisit la discontinuit dans l'nergie, l'gard du cas particulier du rayonnement noir, pour une commodit de calcul. Son innovation eut une fortune prodigieuse, puisqu'on a admis par la suite que ses formules sont valables pour tous les changes d'nergie qui ont lieu parmi les atomes et les radiations, c'est--dire partout. Ainsi le mot d'nergie n'a plus aucun rapport avec les poids et les distances, ou avec les masses et les vitesses ; mais il n'a pas non plus rapport autre chose, car on n'a pas labor une autre dfinition de l'nergie ; il n'a rapport rien. Cela n'empche pas qu'on continue parler d'nergie cintique. Le papier, comme on dit, supporte tout. C'est le rle diffrent de l'algbre qui fait l'abme sparant la science du XXe sicle de celle des sicles antrieurs. L'algbre en physique ne fut d'abord qu'un procd pour rsumer les rapports tablis entre les notions physiques par le raisonnement appuy sur l'exprience ; procd extrmement commode l'gard des calculs numriques ncessaires pour les vrifications et les applications. Mais le rle de l'algbre n'a cess de crotre en importance ; finalement, au lieu qu'autrefois l'algbre constituait le langage auxiliaire et les mots le langage essentiel, c'est aujourd'hui exactement le contraire. Certains physiciens tendent mme faire de l'algbre le langage unique ou presque, de sorte qu' la limite, limite bien entendu impossible atteindre, il n'y aurait plus que des chiffres tirs des mesures exprimentales et des lettres combines en formules. Or ce ne sont pas les mmes exigences logiques qui accompagnent le langage ordinaire et le langage algbrique ; les rapports entre notions ne sont pas reflts tout entiers par les rapports entre lettres ; notamment des affirmations incompatibles peuvent avoir pour quivalents des quations qui ne le sont nullement. Quand, aprs avoir traduit des rapports de notions en
Simone Weil, Sur la science (1966) 136
algbre, on manipule les formules en tenant compte seulement des donnes numriques de l'exprience et des lois propres l'algbre, on peut obtenir des rsultats qui, une fois traduits nouveau en langage parl, heurtent violemment le sens commun. Il en rsulte une forte apparence de profondeur ; car les profondes mditations philosophiques ou mystiques comportent elles aussi des contradictions, des trangets et une difficult insurmontable dans l'expression verbale. Pourtant, dans le cas de l'algbre, i1 s'agit de tout autre chose. Si une pense profonde est inexprimable, c'est parce qu'elle embrasse la fois plusieurs rapports verticalement superposs et que le langage commun reflte mal les diffrences de niveau ; mais l'algbre y est moins propre encore, elle met tout sur le mme plan. Dmonstrations, constatations, hypothses, conjectures presque arbitraires, approximations, vues concernant la convenance, la commodit, la probabilit, toutes ces choses, une fois traduites en lettres, jouent le mme rle dans les quations. Si l'algbre des physiciens produit les mmes effets que la profondeur, c'est seulement parce qu'elle est tout fait plate ; la troisime dimension le la pense en est absente. Cette fausse profondeur a des effets bien plaisants, dont certains mettraient en joie Rabelais ou Molire. Car les philosophes, pleins d'un zle respectueux, s'extnuent interprter ce qu'ils ne peuvent comprendre, et traduire les quations en philosophie ; en gnral, les commentateurs profanes et mme quelques savants cherchent avec une persvrance touchante la signification profonde, la conception du monde contenue dans la science contemporaine. Bien vainement, car il n'y en a pas. La science ressemble cet gard l'empereur du conte d'Andersen ; deux artisans lui promirent des vtements faits d'un tissu invisible pour les sots, de sorte qu'il marcha nu dans les rues de sa capitale sans que ni lui-mme ni aucun des spectateurs ost reconnatre qu'il tait nu. Tout homme un peu cultiv craindrait de passer pour un sot en avouant aux autres ou lui-mme qu'il est incapable d'entrevoir la moindre signification philosophique lie aux innovations de la science contemporaine ; il prfre leur en inventer une, ncessairement trs nuageuse. Le dernier livre de Planck traduit en franais, sous le titre Initiations la physique , livre plus qu'aux trois quarts rempli de considrations philosophiques, a fourni une nouvelle illustration au conte d'Andersen. Car certains critiques, sur la foi de la re-
Simone Weil, Sur la science (1966) 137
nomme scientifique de l'auteur, ont cru voir dans ce livre une pense profonde ; ils ont fait quelques citations pour appuyer leur jugement, et ces citations taient des lieux communs d'une rare platitude. Si l'on faisait abstraction de la personne de l'auteur, ce livre serait vrai dire, sauf quelques pages, presque vide d'intrt. Tout ce qui s'y rapporte la philosophie gnrale, Dieu, l'me humaine, la libert, la connaissance, l'existence du monde extrieur, est fort mdiocre, gnralement sens, mais banal, vague et superficiel. On y voit avec vidence que Planck n'tait pas un grand esprit. On y voit aussi, chose fort piquante, que cet auteur responsable d'une si grande rvolution tait non seulement un fort honnte homme, mais aussi ce qu'on appelle un homme bien pensant, trs attach la religion et tout ce qui est par tradition objet de respect. Mais les pages vritablement prcieuses de ce livre sont celles o Planck fait, navement et sans y penser, certains aveux qui donnent de singulires clarts sur le mystrieux processus d'laboration de la science ; ils dtruisent compltement le lieu commun, souvent rpt par Planck lui-mme avec emphase, selon lequel la science serait une chose universelle planant au-dessus des savants de tous les temps et de tous les pays. Voici quelques extraits de ces pages : Contrairement ce que l'on soutient volontiers dans certains milieux de physiciens, il n'est pas exact que l'on puisse n'utiliser pour l'laboration d'une hypothse que des notions dont le sens puisse tre dfini par des mesures, indpendamment de toute thorie... Il n'y a absolument aucune grandeur qui puisse tre mesure directement. Une mesure ne reoit au contraire son sens physique qu'en vertu d'une interprtation qui est le fait de la thorie... Mme dans le cas des mesures les plus directes et les plus exactes, par exemple celles du poids ou de l'intensit d'un courant, les rsultats ne peuvent tre utilisables qu'aprs avoir subi nombre de corrections dont le calcul est dduit d'une hypothse. Les formules suivantes sont plus rvlatrices encore : Le crateur d'une hypothse dispose de possibilits pratiquement illimites, il est aussi peu li par le fonctionnement des organes de ses sens qu'il ne l'est par celui des instruments dont il se sert... On peut mme dire qu'il se cre une gomtrie sa fantaisie. Avec des instruments d'une exactitude idale... il peut en pense excuter les mesures les plus dlicates
Simone Weil, Sur la science (1966) 138
et tirer de leurs rsultats les conclusions les plus gnrales ; ces conclusions n'ont, au moins directement, rien voir avec des mesures vritables. C'est pourquoi aussi jamais des mesures ne pourront confirmer ni infirmer directement une hypothse ; elles pourront seulement en faire ressortir la convenance plus ou moins grande. Mais voici le plus beau : Les grandes ides scientifiques n'ont pas coutume de conqurir le monde du fait que leurs adversaires finissent par les adapter peu peu et qu'ils finissent par se convaincre de leur vrit... Ce qui arrive le plus souvent, c'est que les adversaires d'une ide nouvelle finissent par mourir et que la gnration montante y est acclimate. Ainsi les thories scientifiques disparaissent la manire des modes masculines au XVe sicle ; les costumes style Louis XIII disparurent quand les derniers vieillards qui avaient t jeunes sous Louis XIII furent morts. Qui aura bien mdit ces formules ne dira jamais : La Science affirme que... La Science est muette ; ce sont les savants qui parlent. Ce qu'ils disent n'est certes pas indpendant du temps, puisque, de l'aveu de Planck, les partisans de telle ou telle manire de voir se taisent au moment prcis o la mort leur impose silence. Quant aux lieux, il est vrai que les savants appartiennent divers pays. Mais les voyages, la correspondance, les communications sont si faciles et si rapides de nos jours en temps de paix que les savants d'une mme spcialit, quoique disperss travers le globe terrestre, constituent un minuscule village, o tout le monde se connat, o l'on est au courant de la vie prive de chacun, o circulent sans cesse des anecdotes qu'ailleurs on nommerait des cancans. Dans les villes o se trouvent plusieurs d'entre eux, ils se voient sans cesse, sauf s'ils sont brouills, et leurs femmes mmes ne se voient gure qu'entre elles. Ce village est clos ; on n'y pntre pas du dehors. Et-on tudi vingt ans les livres des savants, quand on n'est pas soi-mme un savant par profession, on est un profane l'gard de la science ; et les opinions des profanes n'ont aucun crdit dans le village, nul n'y porte la moindre attention, sinon parfois pour emprunter quelques formules qui plaisent et flattent. Un lecteur cultiv, un artiste, un philosophe, un paysan, un Polynsien, sont tous au mme degr, c'est--dire absolument, en dehors de la science, et les savants mmes sont en dehors pour toutes les spcialits autres que la leur.
Simone Weil, Sur la science (1966) 139
On sort rarement du village ; beaucoup de savants, leur spcialit mise part, sont borns et peu cultivs, ou, s'ils s'intressent quelque chose en dehors de leur travail scientifique, il est trs rare qu'ils mettent cet intrt en relation, dans leur esprit, avec celui qu'ils portent la science. Les habitants du village sont enclins l'tude, brillants, exceptionnellement dous ; mais enfin, jusqu' un ge o l'esprit et le caractre sont en grande partie forms, ils sont au lyce comme les autres et se nourrissent de manuels mdiocres. jamais nul ne s'est particulirement attach dvelopper leur esprit critique. aucun moment de leur vie on ne les prpare particulirement mettre le pur amour de la vrit au-dessus des autres mobiles ; nul mcanisme d'limination ne fait d'une disposition naturelle en ce sens une condition de l'entre dans le village. Il y a des mcanismes d'limination, au nombre desquels les examens et concours, mais ils ne portent pas sur l'intensit ou la puret de l'amour pour la vrit. Cet amour, le got de l'exactitude et du travail bien fait, le dsir de faire parler de soi, la convoitise de l'argent, de la considration, de la rputation, des honneurs, des titres, les antipathies, les jalousies, les amitis, tous ces mobiles et d'autres encore se mlangent chez les habitants de ce village, comme chez tous les hommes, en proportion variable. Ce village, comme tous les autres villages, est fait d'humanit moyenne, avec quelques carts vers le haut et vers le bas. Il a des traits singuliers ; ainsi le fait d'tre priodiquement boulevers par les changements de mode ; tous les dix ans peu prs une gnration nouvelle s'y enthousiasme pour de nouvelles opinions. Comme ailleurs, la lutte des gnrations et des personnes y produit chaque moment une opinion moyenne. L'tat de la science un moment donn n'est pas autre chose ; c'est l'opinion moyenne dans le village des savants. Cette opinion, il est vrai, s'appuie sur des expriences ; mais il s'agit toujours d'expriences excutes dans ce village, sans aucun contrle extrieur, avec des appareils coteux et compliqus qui ne se trouvent que l ; expriences prpares, recommences, rectifies par les seuls habitants du village, et surtout interprtes par eux seuls, et cela avec une libert dont les phrases de Planck cites plus haut donnent la mesure. Il n'est donc pas vrai que la science soit une espce d'oracle surnaturel, source de sentences diffrentes, certes, d'anne en anne, mais ncessairement : de plus en plus sages. Car c'est ainsi qu'on se la reprsente communment aujourd'hui, et l'ivresse que nous prouvons crier :
Simone Weil, Sur la science (1966) 140
La Science dit que... n'est mme pas refroidie par la certitude qu'elle ne le dira plus dans cinq ans. On croirait - cet gard comme plusieurs autres - que l'actualit a pour nous valeur d'ternit. Valry lui-mme a parl plus d'une fois de la science conformment la superstition commune. Quant aux savants, ils sont, bien entendu, les premiers faire passer leurs propres opinions pour des sentences dont ils ne seraient pas responsables, dont ils n'auraient rendre aucun compte, manes d'un oracle. Cette prtention n'est pas tolrable, car elle n'est pas lgitime. Il n'y a aucun oracle, mais seulement les opinions des savants, lesquels sont des hommes. Ils affirment ce qu'ils croient devoir affirmer, en quoi ils ont raison, mais ils sont euxmmes les auteurs responsables de tout ce qu'ils affirment, et ils en doivent compte. Ils ne rendent pas ce compte ; mais ils ont tort ; ils se font tort d'abord eux-mmes, car ils ne le rendent pas non plus eux-mmes. Ils doivent compte avant tout de leur rupture avec la science classique. Non qu'elle soit un malheur. La science classique, parvenue son apoge et se prtendant capable d'expliquer toute chose sans exception, tait devenue intellectuellement irrespirable, et c'est pourquoi Bergson, Einstein, tous ceux qui ont fait par violence des trous dans cette enceinte close ont t salus comme des librateurs. D'ailleurs les notions premires de la science classique, inertie, mouvement uniforme, force, acclration, nergie cintique, travail, sont obscures ds qu'on les considre avec attention. N'est-il pas singulier que le mouvement uniforme rectiligne, le plus simple de tous les mouvements en vertu du principe d'inertie, ne puisse tre mesur, quant au temps, que par le mouvement diurne des toiles, c'est--dire un mouvement circulaire ; et ne puisse tre reprsent que par l'exemple d'une bille roulant sur un plan, mouvement qui enferme une rotation ? N'est-il pas singulier que ce mouvement, qui s'accomplit sans intervention d'aucune force, enferme une nergie ? N'est-il pas trange que la notion de travail, emprunte l'exprience humaine, soit dfinie de telle manire qu'un homme qui porte cinquante kilos pendant dix kilomtres n'accomplit aucun travail ? Et que lorsque deux corps identiques franchissent la mme distance rectiligne dans le mme temps, il y ait travail dans un cas et non dans l'autre, si le mouvement de l'un est uniforme et non celui de l'autre ? On trouverait bien d'autres trangets.
Simone Weil, Sur la science (1966) 141
Mais ce qui est plus grave, c'est que la science classique a prtendu rsoudre les contradictions, ou plutt les corrlations de contraires, qui font partie de la condition humaine et dont il n'est pas permis l'homme de se dgager. Elle a cru y parvenir en supprimant l'un des termes. Par exemple, le continu et le discontinu nous sont donns ; nous pensons l'espace et le nombre ; nous ne pouvons passer d'un ct l'autre d'un fleuve sans le traverser, et nous ne connaissons pas d'intermdiaire entre le fer et l'or. La physique classique a voulu supprimer le discontinu ; il tait ncessaire qu'elle s'y heurtt, et cela en son centre mme, dans sa branche principale, dans l'tude de la notion mme d'nergie qui devait servir cette suppression, autrement dit dans la thermodynamique. Nous ne concevons clairement que des transformations susceptibles de se reproduire en sens contraire, et pourtant nous sommes soumis un temps dont le cours est irrparable ; nous vieillissons, nous mourons, la cendre ne devient pas bois, la rouille ne devient pas fer, et d'une manire gnrale les choses facilement et rapidement dtruites sont soit impossibles soit difficiles et longues reconstruire ou remplacer. La tentative d'expliquer un monde fait de la sorte par un monde d'atomes soumis la seule nergie mcanique, laquelle ne comporte aucune irrversibilit, devait tre impossible. La science classique a voulu tenir compte seulement de la ncessit aveugle, et abolir compltement la notion d'ordre ; celle-ci est reparue sous le dguisement de la probabilit dont Boltzmann a fait usage pour passer du rversible l'irrversible ; car regarder la chose de prs, on ne peut dfinir la faible probabilit que par un ordre. La science classique a voulu, du double rapport qui subordonne l'ensemble aux parties et les parties l'ensemble, ne retenir que le premier, le second semblant, comme la notion d'ordre, entach de finalit ; et de nos jours mathmatique, physique et biologie s'orientent vers l'tude des ensembles considrs comme tels. En eux-mmes ces changements sont heureux, car les esprances de la science classique taient la fois absurdes et impies. Absurdes, car on ne peut pas raisonnablement esprer rendre compte d'un monde o nous trouvons des contraires en corrlation par la suppression d'un terme sur deux ; l'autre ft-il regard comme une illusion, encore faut-il rendre compte de cette illusion, et on ne le peut pas au moyen du terme contraire ; des notions qui sont donnes l'homme, l'homme ne peut en supprimer aucune, il peut seulement les mettre en place. Impies, parce qu'il n'est pas permis l'homme sur cette terre de se dlivrer des contradic-
Simone Weil, Sur la science (1966) 142
tions, mais seulement d'en faire bon usage ; comme Platon le savait, tout ce que l'intelligence humaine peut se reprsenter enferme des contradictions qui sont le levier par lequel elle s'lve au-dessus de son domaine naturel. Ce qui constitue un malheur, ce n'est pas l'abandon de la science classique, c'est la manire dont on l'a abandonne. Elle se croyait tort capable d'un progrs illimit ; elle s'est heurte ses limites vers 1900 ; les savants, au lieu de s'arrter avec elle pour contempler ces limites, y rflchir, tenter de les dcrire, de les dfinir, d'en rendre compte, et d'en tirer des vues d'ensemble, ont pass outre dans un furieux lan, laissant la science classique derrire eux. Quoi d'tonnant ? Ne sont-ils pas pays pour aller toujours de l'avant ? On n'acquiert ni avancement, ni rputation, ni prix Nobel en s'arrtant. Il faudrait un savant brillamment dou, pour s'arrter volontairement, une sorte de saintet ou d'hrosme ; et pourquoi serait-il un saint ou un hros ? Les hommes des autres professions, sauf de rares exceptions, ne le sont pas non plus. Les savants ont donc couru en avant, sans rien rviser, car toute rvision aurait sembl un retour en arrire ; ils ont ajout seulement. Quand ils se sont heurts au discontinu, ils n'ont pas renonc pour autant tout ramener des variations d'nergie ; ils ont simplement mis la discontinuit dans l'nergie elle-mme, lui tant ainsi toute signification, mais ils ont nanmoins continu la mettre au centre de toute tude, sous l'effet de l'lan acquis au cours des sicles antrieurs. La difficult d'tablir par la notion de probabilit un pont entre le monde qui nous est donn et le monde hypothtique et purement mcanique des atomes ne les a pas embarrasss ; les consquences de la thorie des quanta, laquelle a sa source dans l'tude de la probabilit, les ont amens loger la probabilit parmi les atomes eux-mmes. Ainsi les trajectoires des particules atomiques ne sont plus ncessaires, mais probables, et la ncessit n'est nulle part. Pourtant la probabilit ne peut se dfinir que comme une ncessit rigoureuse dont certaines conditions sont connues et les autres inconnues ; la notion de probabilit, spare de celle de ncessit, n'a aucun sens. La probabilit ainsi spare n'est plus que le rsum des statistiques, et la statistique mme ne se justifie par rien, sinon par l'utilit pratique ; on donne raison mille faits contre un fait, par une sorte de transposition du suffrage ou du plbiscite. Il ne reste plus alors que l'exprience brute, et pourtant la science, comme tout effort de pense, consiste
Simone Weil, Sur la science (1966) 143
interprter l'exprience. Au reste on n'a jamais interprt autant qu'aujourd'hui ; jamais on n'a fait autant d'hypothses ; jamais il n'a t permis d'en faire avec une telle licence. Si trange que puisse paratre, aujourd'hui encore, l'expression d'une telle incertitude, il est douteux que les savants puissent continuer longtemps aller de l'avant dans de telles conditions. Car ils n'ont presque plus rien qui les contrle dans les dmarches de leur pense. Ils n'ont gure que l'algbre, qui contrle seulement comme peut le faire un simple instrument auquel on se conforme pour le manier, et qui est un instrument fort souple. On a tort de croire que l'exprience puisse servir cet usage, car toute pense humaine, y compris les croyances nos yeux les plus absurdes, a pour objet l'exprience et y trouve un appui et une confirmation. Le prestige des sorciers s'appuie sur l'exprience ; une croyance non exprimentalement vrifie n'est viable dans aucun milieu humain. Toute pense est un effort d'interprtation de l'exprience, interprtation pour laquelle l'exprience ne fournit ni modle, ni rgle, ni critrium ; on y trouve les donnes des problmes, mais non pas la manire de les rsoudre ni mme de les formuler. Cet effort a besoin, comme tous les autres, d'tre orient vers quelque chose ; tout effort humain est orient ; quand l'homme ne va pas quelque part, il reste immobile. Il ne peut se passer de valeurs. l'gard de toute tude thorique, la valeur a nom vrit. Les hommes faits de chair, sur cette terre, ne peuvent sans doute avoir une reprsentation de la vrit qui ne soit pas dfectueuse ; mais il leur en faut une ; image imparfaite de la vrit non reprsentable que nous avons vue, comme dit Platon, de l'autre ct du ciel. Les savants de la priode classique avaient une reprsentation de la vrit scientifique certes fort dfectueuse, mais ils en avaient une ; et ceux d'aujourd'hui n'ont dans l'esprit aucune chose, ft-elle vague, lointaine, arbitraire, impossible, vers laquelle ils puissent se tourner la nommant vrit. plus forte raison n'ont-ils pas l'image d'un chemin qui y conduirait et auquel ils compareraient, pour la contrler, chaque dmarche de leur pense. Ils sont encore pousss par l'impulsion des gnrations antrieures, et suivent par vitesse acquise des directions qui aujourd'hui ne rpondent plus rien ; mais cette impulsion s'puisera. La licence est chose enivrante, et nous nous en sommes sols en
Simone Weil, Sur la science (1966) 144
tous domaines, mais la licence absolue arrte beaucoup plus srement qu'aucune chane. Il est donc prvoir que dans un temps assez proche, deux ou trois gnrations peut-tre, peut-tre moins, les savants s'arrteront. C'est prvoir, non pas craindre. Pourquoi souhaiterions-nous pour la science un progrs sans obstacle ? Nous n'avons aucun bonheur esprer du dveloppement de la technique, tant qu'on ne sait pas empcher les hommes d'employer la technique pour la domination de leurs semblables et non de la matire ; quant nos connaissances, le progrs scientifique ne peut pas y ajouter, puisqu'il est reconnu aujourd'hui que les profanes ne peuvent rien comprendre la science, et que les savants mmes sont profanes hors de leur domaine spcial. Un arrt forc contraindrait peut-tre les savants faire un travail de rcapitulation et de rvision, constituer, selon le modle immortel laiss par Archimde, une axiomatique de la physico-chimie ; non pas pour fabriquer une cohrence artificielle, mais pour faire honntement le bilan des axiomes, des postulats, des dfinitions, des hypothses, des principes, sans omettre ceux qui sont impliqus dans la technique exprimentale elle-mme, par exemple dans l'usage de la balance. Un tel travail demi peut-tre de la science une connaissance, en laissant apparatre clairement les difficults, les contradictions, les impossibilits, qu'on se hte aujourd'hui de dissimuler sous des solutions derrire lesquelles l'intelligence ne peut plus rien apercevoir. Mais ce travail, il faudrait le commencer bientt. Sans quoi l'arrt de la science peut provoquer, non pas un renouvellement, mais la disparition de l'esprit scientifique sur le globe terrestre pour plusieurs sicles, comme ce fut le cas quand l'empire romain eut tu la science grecque. Quelque chose d'infiniment plus prcieux que la science mme est compromis dans cette crise ; c'est la notion de vrit, que le XVIIIe sicle et surtout le XIXe ont trs troitement lie la science ; bien tort, mais nous avons conserv cette habitude. La disparition de la vrit scientifique a fait disparatre nos yeux la vrit elle-mme, accoutums que nous sommes prendre l'une pour l'autre. Ds que la vrit disparat, l'utilit aussitt prend sa place, car toujours l'homme dirige son effort vers quelque bien. Mais cette utilit, l'intelligence n'a plus alors qualit pour la dfinir ni pour en juger, elle a seulement licence de la servir. D'arbitre elle devient servante, et les dsirs lui don-
Simone Weil, Sur la science (1966) 145
nent des ordres. De plus l'opinion publique devient matresse souveraine des penses au lieu de la conscience, car toujours l'homme soumet ses penses un contrle suprieur, soit en valeur, soit en puissance. Nous en sommes l aujourd'hui. Tout est tourn vers l'utile, sans qu'on songe le dfinir ; l'opinion publique rgne souverainement, dans le village des savants comme dans les grandes nations. Nous sommes comme revenus l'poque de Protagoras et des sophistes, l'poque o l'art de persuader, dont les slogans, la publicit, la propagande par runions publiques, journal, cinma, radio, constituent l'quivalent moderne, tenait lieu de pense, rglait le sort des villes, accomplissait les coups d'tat. Aussi le IXe livre de la Rpublique de Platon semble-t-il dcrire les faits contemporains. Mais ce n'est pas aujourd'hui la Grce, c'est le globe terrestre qui est en jeu. Et il nous manque Socrate, Platon, Eudoxe, la tradition pythagoricienne, l'enseignement des Mystres. Nous avons la tradition chrtienne, mais elle ne peut rien pour nous tant qu'elle n'est pas redevenue vivante en nous.
Depuis longtemps dj, dans tous les domaines sans exception, les gardiens en titre des valeurs spirituelles les avaient laiss se dgrader, par leur propre carence et sans nulle contrainte extrieure. Une sorte de crainte nous empche de le reconnatre, comme si nous risquions ainsi de porter atteinte ces valeurs elles-mmes ; mais loin de l, dans la priode peut-tre fort longue de douleur et d'humiliation o nous sommes engags, nous ne pouvons retrouver un jour ce qui nous manque que si nous sentons de toute notre me quel point nous avons mrit notre sort. Nous voyons la force des armes asservir de plus en plus l'intelligence, et la souffrance rend aujourd'hui cet asservissement sensible tous ; mais l'intelligence s'tait dj abaisse jusqu' l'tat de servitude avant d'avoir personne qui obir. Si quelqu'un va s'exposer comme esclave sur le march, quoi d'tonnant qu'il trouve un matre ?
La tempte qui nous entoure a dracin les valeurs, en a dfait la hirarchie, et les met toutes en question pour les peser sur la balance toujours fausse de la force. Nous du moins, pendant ce temps, mettons-les toutes en question nous aussi, chacun de nous pour son
Simone Weil, Sur la science (1966) 146
compte, pesons-les en nous-mmes dans le silence de l'attention, et souhaitons qu'il nous soit accord de faire de notre conscience une balance juste.
mile NOVIS
Simone Weil, Sur la science (1966) 147
Sur la science [crits publis entre 1932 et 1942.] (1932-1942)
Extraits de lettres et de brouillons de lettres A. W.
(Janvier-avril 1940)
I. Extrait de lettre
Retour la table des matires
[...] J'ai russi me procurer le livre sur la mathmatique babylonienne et gyptienne. [...] J'ai envie d'crire l'auteur concernant une question qu'il laisse non rsolue, celle des moyens par lesquels les gyptiens ont pu, avec une gomtrie d'aprs lui extrmement grossire et empirique, trouver une approximation remarquablement prcise de savoir surface du cercle = d
8 2 9
Cela me parat assez facile imaginer, si on suppose que les mthodes sont trs grossires. Si on divise le carr circonscrit en 81 petits carrs, on peut considrer que pour avoir la surface du cercle il faut retrancher dans chaque coin trois de ces carrs, plus peu prs la valeur de trois demi-carrs.
Simone Weil, Sur la science (1966) 148
Il y a un problme babylonien vraiment savoureux. On donne les dimensions d'un canal creuser, la productivit d'un ouvrier par jour en volume de terre dplace, et la somme des jours de travail et des ouvriers. On doit trouver le nombre des jours de travail et celui des ouvriers. je me demande ce que diraient les parents d'lves si on posait aujourd'hui un examen un problme formul d'une manire analogue ? Ce serait amusant d'en faire l'exprience. Drles de gens, ces Babyloniens. Moi, je n'aime pas beaucoup cet esprit d'abstraction - les Sumriens devait tre beaucoup plus sympathiques. D'abord, c'est eux qui ont invent tous les mythes msopotamiens, et des mythes, c'est autrement intressant que l'algbre. Mais toi, tu dois descendre des Babyloniens en ligne directe. Pour moi, je pense bien que Dieu, selon la parole pythagoricienne, est un gomtre perptuel - mais non pas un algbriste. Quoi qu'il en soit, je me suis flicite, en lisant la dernire lettre que j'ai reue de toi, de voir que tu te dfendais d'appartenir l'cole abstraite. Je me souviens qu' Chanay ou Dieulefit tu disais que ces tudes sur l'gypte et Babylone jettent un doute sur le rle de crateurs attribu jusqu'ici aux Grecs en matire mathmatique. Mais je crois qu'on y trouve plutt, jusqu'ici (sous rserve de dcouvertes ultrieures) une confirmation de ce rle. Les Babyloniens semblent s'tre attachs des exercices abstraits concernant les nombres, les gyptiens avoir procd d'une manire purement empirique. L'application d'une mthode rationnelle des problmes concrets et l'tude de la nature semble avoir t le propre des Grecs. (Il est vrai qu'il faudrait connatre l'astronomie babylonienne pour pouvoir juger.) Le singulier est que les Grecs devaient connatre l'algbre babylonienne, et pourtant on n'en trouve pas trace chez eux avant Diophante (qui est, si je ne me trompe, du IVe sicle aprs J.-C.) ; car la gomtrie algbrique des pythagoriciens est tout autre chose. Il doit y avoir l-dessous des conceptions religieuses ; apparemment la religion secrte des pythagoriciens devait s'accommoder de la gomtrie et non de l'algbre. Si l'Empire romain n'avait pas dtruit tous les cultes sotriques, on comprendrait peut-tre quelque chose ces nigmes.
Simone Weil, Sur la science (1966) 149
II. Extrait de lettre
Retour la table des matires
[...] Je ne suis pas sre que la dcouverte des incommensurables soit une explication suffisante du refus obstin des Grecs l'gard de l'algbre. Ils ont d connatre l'algbre babylonienne ds les premiers temps. La tradition attribue Pythagore un voyage d'tudes Babylone. Bien entendu, ils ont transpos cette algbre en gomtrie, longtemps avant Apollonius. Les transpositions de ce genre trouves dans Apollonius concernent sans doute les quations biquadratiques ; celles du 2e degr peuvent toutes tre rsolues une fois connues les proprits du triangle inscrit dans le demi-cercle, dcouverte attribue Pythagore. (On trouve ainsi deux quantits dont on connat la somme et le produit, ou la diffrence et le produit.) Mais ce qui est singulier, c'est que cette transposition de l'algbre en gomtrie semble tre, non pas un -ct, mais le ressort mme de l'invention gomtrique dans toute l'histoire de la gomtrie grecque. La lgende concernant la dcouverte de la similitude des triangles par Thals ( l'heure o l'ombre de l'homme est gale l'homme, l'ombre de la pyramide est gale la pyramide) rapporte cette dcouverte au problme d'une proportion dont un terme est inconnu. On ne sait rien de la dcouverte suivante, celle, par Pythagore, des proprits du triangle rectangle. Mais voici mon hypothse, qui est certainement d'accord avec l'esprit des recherches pythagoriciennes. C'est que cette dcouverte a pour origine le problme d'une moyenne proportionnelle entre deux quantits connues. Deux triangles semblables ayant deux cts non homologues gaux reprsentent une proportion trois termes :
Simone Weil, Sur la science (1966) 150
Si on construit les deux termes extrmes sur une mme droite, la figure devient un triangle rectangle (puisque l'angle entre a et b devient un angle plat, dont la moiti est un angle droit). La proprit essentielle du triangle rectangle est d'tre form par la juxtaposition de deux triangles semblables lui-mme et entre eux. Je pense que Pythagore a dcouvert cette proprit la premire. Le triangle rectangle fournit aussi la solution du problme inverse : connaissant la moyenne proportionnelle et la somme ou la diffrence des extrmes, trouver les extrmes. Quant aux coniques et leurs proprits, l'inventeur en cette matire est, dit-on, Mnechme, lve de Platon, l'un des deux gomtres qui ont rsolu le problme de la duplication du cube pos par Apollon (l'autre est Archytas ; il l'a rsolu par le tore). Mnechme a rsolu ce problme par les coniques (deux paraboles, ou une parabole et une hyperbole). Il me parat donc non douteux qu'il les a inventes cet effet. Or le problme de la duplication du cube se ramne celui de trouver deux moyennes proportionnelles entre deux quantits connues. Il est facile d'imaginer le processus de la dcouverte. Car le cne est constitu par un cercle de diamtre variable, et la parabole fournit la srie de toutes les moyennes proportionnelles entre un terme fixe et un autre variable. On a donc une srie continue de problmes proportion quatre termes dont un inconnu - progression gomtrique trois termes dont celui du milieu inconnu - progression quatre termes dont les deux termes moyens inconnus. Comme les proprits du triangle rectangle permettaient de rsoudre les problmes du 2e degr, celles des coniques permettaient de rsoudre ceux du 3e et 4e . remarquer qu'alors que nous rsolvons les quations en suppo3 sant que les expressions , etc., ont un sens, les Grecs leur donnaient un sens avant de s'attaquer aux quations de degr correspondant.
Simone Weil, Sur la science (1966) 151
A remarquer aussi que l'assimilation de l'inconnue une variable remonte tout le moins Mnechme, sinon plus haut. On ne peut gure supposer que les Babyloniens, avec leurs quations numriques, aient eu cette notion. Les Grecs du Ve sicle possdaient la notion de fonction et celle de la reprsentation des fonctions par des lignes. L'histoire de Mnechme donne l'impression que les courbes taient pour eux un moyen d'tudier des fonctions, bien plutt qu'un objet d'tude. Dans tout cela, on aperoit un progrs qui ne prsente aucun moment une rupture de continuit due au drame des incommensurables. Certes, il y a eu un drame des incommensurables, et d'une porte immense. La vulgarisation de cette dcouverte a fait tomber sur la notion de vrit un discrdit qui dure encore ; elle a fait natre, ou au moins a contribu faire natre, l'ide qu'on peut dmontrer galement bien deux thses contradictoires ; les sophistes ont diffus ce point de vue dans les masses, ainsi qu'un savoir de qualit infrieure, dirig uniquement vers la conqute de la puissance ; il en est rsult, ds la fin du Ve sicle, la dmagogie et l'imprialisme qui en est insparable, dont les consquences ont ruin la civilisation hellnique ; c'est par ce processus (auquel ont contribu, bien entendu, d'autres causes, notamment les guerres mdiques) que les armes romaines ont pu enfin tuer la Grce sans rsurrection possible. J'en conclus que les dieux ont eu raison de faire prir dans un naufrage le pythagoricien coupable d'avoir divulgu la dcouverte des incommensurables. Mais chez les gomtres et les philosophes, je ne crois pas qu'il y ait eu drame. Le pythagorisme a t ruin par tout autre chose (dans la mesure o il l'a t), savoir par le massacre massif des pythagoriciens en Grande Grce. D'ailleurs, le pentagone toil, qui reprsente un rapport entre incommensurables (division d'une ligne en extrme et moyenne raison) fut un des symboles des pythagoriciens. Mais Archytas (un des survivants) fut un grand gomtre, et il fut le matre d'Eudoxe, auteur de la thorie des nombres rels, de la notion de limite et de la notion d'intgration telles qu'elles sont exposes dans Euclide. Rien ne donne penser que les pythagoriciens, en parlant de nombre, aient entendu par l seulement les nombres entiers. Tout au contraire, en disant que la justice, etc., sont des nombres, ils faisaient clairement apparatre, il me semble, qu'ils employaient ce mot pour dsigner
Simone Weil, Sur la science (1966) 152
toute espce de proportion. Es taient certainement capables de concevoir le nombre rel. mon avis, le point essentiel de la dcouverte des incommensurables est extrieur la gomtrie. Il consiste en ceci, que certains problmes concernant les nombres sont parfois susceptibles d'une solution et parfois insolubles : ainsi celui d'une moyenne proportionnelle entre deux nombres donns. Cela seul suffit pour que le nombre au sens troit du mot ne puisse pas tre la clef de tout.Or cela, quand s'en est-on aperu ? je ne sais pas s'il existe des renseignements ce sujet. En tout cas on a pu s'en apercevoir avant toute gomtrie ; il suffisait d'tudier spcialement les problmes de proportion. Et en ce cas le procd gomtrique pour trouver des moyennes proportionnelles (hauteur du triangle rectangle) apparaissait immdiatement, aussitt dcouvert, comme ne comportant aucune semblable limitation. C'est au point qu'on peut se demander si les Grecs n'ont pas tudi le triangle pour trouver des proportions exprimables autrement qu'en nombres entiers, s'ils n'ont pas par suite ds l'origine conu la droite comme une fonction, comme ils ont fait plus tard pour la parabole. On peut trouver cette thse des objections, mais qui tombent mon avis si on se rappelle le rle du secret chez les penseurs grecs et leur coutume de ne diffuser qu'en dnaturant. Si Eudoxe est l'auteur de la thorie parfaite et acheve du nombre rel, cela n'exclut nullement que les gomtres aient entrevu cette notion ds le dbut et se soient constamment efforcs de la saisir. On peut se demander pourquoi les Grecs se sont ainsi attachs l'tude de la proportion. Il s'agit certainement d'une proccupation religieuse, et par suite (puisqu'il s'agit de la Grce), pour une part, esthtique. Le lien entre les proccupations mathmatiques d'une part, philosophico-religieuses de l'autre, lien dont l'existence est historiquement connue pour l'poque de Pythagore, remonte certainement beaucoup plus haut. Car Platon est traditionaliste l'extrme, et dit souvent : Les hommes anciens, qui taient beaucoup plus prs que nous de la lumire... (faisant videmment allusion une antiquit bien plus recule que celle de Pythagore) ; d'autre part il affichait la porte de l'Acadmie : Nul n'entre ici s'il n'est gomtre et disait : Dieu est un perptuel gomtre . Il y aurait contradiction entre les deux attitudes - ce qui est exclu -si les proccupations d'o est issue la
Simone Weil, Sur la science (1966) 153
gomtrie grecque ( dfaut de cette gomtrie mme) ne dataient d'une haute antiquit ; on peut supposer qu'elles viennent, soit des habitants pr-hellniques de la Grce, soit d'gypte, soit des deux. Au reste l'orphisme (qui a cette double origine) a inspir le pythagorisme et le platonisme (qui sont pratiquement quivalents) au point qu'on peut se demander si Pythagore et Platon ont fait beaucoup plus que le commenter. Thals a presque srement t initi des mystres grecs et gyptiens, et par suite baignait, au point de vue philosophique et religieux, dans une atmosphre analogue celle du pythagorisme. Je pense donc que la notion de proportion tait depuis une antiquit assez recule l'objet d'une mditation qui constituait un des procds de purification de l'me, peut-tre le procd principal. Il est hors de doute que cette notion tait au centre de l'esthtique, de la gomtrie, de la philosophie des Grecs. Ce qui fait l'originalit des Grecs en matire mathmatique, ce n'est pas, je crois, leur refus d'admettre l'approximation. Il n'y a pas d'approximation dans les problmes babyloniens ; et pour une raison bien simple : c'est qu'ils sont construits partir des solutions. Ainsi on a des dizaines (ou des centaines, je ne sais plus) de problmes du 4e degr 2 inconnues qui ont tous la mme solution. Cela montre que les Babyloniens ne s'intressaient qu' la mthode, et non rsoudre des problmes rellement poss. De mme, pour le problme du canal que je t'ai cit, la somme des ouvriers et des jours de travail n'est videmment jamais donne. Ils s'amusaient supposer inconnu ce qui est donn, et connu ce qui ne l'est pas. C'est un jeu, videmment, qui fait le plus grand honneur leur sens de ]a recherche dsintresse (avaient-ils, pour les stimuler, des bourses et des mdailles ?). Mais ce n'est qu'un jeu. Ce jeu devait sembler profane aux Grecs, ou mme impie ; sans quoi pourquoi n'auraient-ils pas traduit les traits d'algbre qui devaient exister en babylonien, en mme temps qu'ils les transposaient en gomtrie ? L'ouvrage de Diophante aurait pu tre crit bien des sicles plus tt. Mais les Grecs n'attachaient pas de prix une mthode de raisonnement considre en elle-mme ; ils y attachaient du prix pour autant qu'elle permettait d'tudier efficacement des problmes concrets ; non pas qu'ils fussent avides d'applications techniques, mais parce que leur objet unique tait de concevoir de plus en plus clairement une identit de structure entre l'esprit humain et l'univers.
Simone Weil, Sur la science (1966) 154
La puret d'me tait leur unique souci ; imiter Dieu en tait le secret ; l'tude de la mathmatique aidait imiter Dieu pour autant qu'on regardait l'univers comme soumis aux lois mathmatiques, ce qui faisait du gomtre un imitateur du lgislateur suprme. Il est clair que les jeux mathmatiques des Babyloniens, o on se donnait la solution avant les donnes, taient inutiles cet effet. Il fallait des donnes rellement fournies par le monde ou l'action sur le monde ; il fallait donc trouver des rapports de quantits tels que les problmes n'eussent pas besoin d'tre artificiellement prpars pour tomber juste , comme c'est le cas pour les nombres entiers. C'est pour les Grecs que la mathmatique tait vraiment un art. Son objet tait le mme que l'objet de leur art, savoir rendre sensible une parent entre l'esprit humain et l'univers, faire apparatre le monde comme la cit de tous les tres raisonnables . Et elle avait vraiment une matire dure, une matire qui existait, comme celle de tous les arts sans exception, au sens physique du mot ; cette matire, c'tait l'espace rellement donn, impos comme une condition de fait toutes les actions des hommes. Leur gomtrie tait une science de la nature ; leur physique (je pense la musique des pythagoriciens, et surtout la mcanique d'Archimde et son tude des corps flottants) tait une gomtrie o les hypothses taient prsentes comme des postulats. Je crains qu'on ne se rapproche plutt aujourd'hui de la conception des Babyloniens, c'est--dire qu'on ne fasse du jeu plutt que de l'art. je me demande combien de mathmaticiens, aujourd'hui, regardent la mathmatique comme un procd en vue de purifier l'me et d' imiter Dieu ? D'autre part il me semble que la matire manque. On fait beaucoup d'axiomatique, ce qui semble rapprocher des Grecs ; mais ne choisit-on pas les axiomes dans une large mesure volont ? Tu parles de matire dure ; mais cette matire n'est-elle pas essentielle ment constitue par l'ensemble des travaux mathmatiques accomplis jusqu' ce jour ? En ce cas la mathmatique actuelle constituerait un cran entre l'homme et l'univers (et par suite entre l'homme et Dieu, conu la manire des Grecs) au lieu de les mettre en contact. Mais je la calomnie peut-tre.
Simone Weil, Sur la science (1966) 155
propos des Grecs, as-tu entendu parler d'un certain Autran, qui vient de publier un livre sur Homre ? Il a mis une thse sensationnelle, savoir que les Lyciens et les Phniciens du deuxime millnaire avant notre re seraient des Dravidiens. Ses arguments, qui sont philologiques, ne semblent pas mprisables, autant qu'on peut juger sans connatre les langues dravidiennes et les inscriptions qu'il cite. Mais la thse est bien sduisante -trop sduisante, mme - en ce sens qu'elle donne une explication extrmement simple des analogies entre la pense de la Grce et celle de l'Inde. Le climat expliquerait peuttre assez les diffrences. Quoi qu'il en soit, comment ne pas avoir de nostalgie pour une poque o une mme pense se retrouvait partout, chez tous les peuples, dans tous les pays, o les ides circulaient dans une tendue prodigieuse, et o on avait toute la richesse que procure la diversit ? Aujourd'hui, comme sous l'Empire romain, l'uniformit s'est abattue partout, a effac toutes les traditions, et en mme temps les ides ont presque cess de circuler. Enfin ! Dans 1000 ans cela ira peut-tre un peu mieux.
II bis. Brouillon d'une partie de la lettre prcdente
Retour la table des matires
[...] Les rapports mathmatiques entre la Grce et Babylone enferment sans aucun doute quelque mystre. Il est infiniment probable, tant donn l'intensit extraordinaire des changes intellectuels dans le monde mditerranen de cette poque, que les Grecs ont connu l'algbre babylonienne longtemps avant Apollonius. La tradition attribue Pythagore un sjour Babylone. (D'ailleurs il n'y a pas besoin de coniques pour reprsenter des quations du second degr. N'importe quelle quation du second degr peut se rsoudre une fois connues les proprits du triangle inscrit dans le demi-cercle et de sa hauteur (dcouvertes attribues Pythagore), puisqu'on peut ainsi trouver deux quantits dont on connat soit le produit et la somme, soit le produit et la diffrence. C'est sans doute les quations biquadratiques des Babyloniens qui sont traduites en coniques dans Apollonius.) Il est singu-
Simone Weil, Sur la science (1966) 156
lier que les principales tapes de la gomtrie grecque semblent lies des problmes au fond algbriques. La tradition concernant la dcouverte de la similitude des triangles par Thals ( l'heure o l'ombre de l'homme est gale l'homme, l'ombre de la pyramide est gale la pyramide ) voque une proportion dont un terme est inconnu. Je suis convaincue (bien qu'il ne puisse naturellement y avoir aucune preuve) que la dcouverte des proprits du triangle rectangle par Pythagore a pour origine la recherche d'une moyenne proportionnelle entre deux quantits connues. Deux triangles semblables ayant deux cts non homologues gaux reprsentent une proportion entre trois quantits.
Si on construit les deux termes extrmes sur une mme droite, la figure, au lieu d'un quadrilatre, donne un triangle rectangle, triangle dont la proprit essentielle consiste en ce qu'il est la somme (si on peut s'exprimer ainsi) de deux triangles semblables entre eux et luimme. Il est vident que les triangles forms en mettant b dans le prolongement de a sont des triangles rectangles, puisque l'angle entre a et b devient ainsi un angle plat, dont la moiti est un angle droit. J'imagine l un procd de dcouverte, bien entendu, non de dmonstration. L'invention des coniques se rattache la recherche (ordonne par Apollon) de la duplication du cube, laquelle se ramne celle de deux moyennes proportionnelles. Archytas (pythagoricien) avait trouv une solution par le tore. Mnechme, lve de Platon, en a trouv une par les coniques, et il est d'autre part l'inventeur des coniques. Je ne crois pas qu'on puisse voir l une concidence ; je pense qu'il a invent les coniques pour rsoudre les quations qui se rapportent la recherche de deux moyennes proportionnelles. Car le cne est constitu par un cercle dont le diamtre varie indfiniment, et la parabole (une de ses solutions de la duplication du cube repose sur l'intersection de deux paraboles) fournit la srie des moyennes proportionnelles entre une quantit fixe et une autre variable.
Simone Weil, Sur la science (1966) 157
Il me semble donc que l'ide de construire des lignes pour reprsenter des fonctions, considre gnralement comme datant de deux ou trois sicles, est prsente dans toute la gomtrie grecque depuis le dbut. On ne voit pas que la dcouverte des incommensurables ait opr une rupture dans la continuit du dveloppement. Cette dcouverte n'a d'ailleurs certainement pas ruin le pythagorisme , comme tu dis. Car autrement les pythagoriciens n'auraient srement pas eu pour symbole le pentagone toil (division d'une ligne en extrme et moyenne raison). Si l'on suppose qu'aprs avoir eux-mmes dcouvert les incommensurables ils ont gard cette dcouverte secrte parce qu'elle ruinait leur doctrine, il est puril d'imaginer qu'en pareil cas l'image de cette dcouverte leur aurait servi de signe de reconnaissance. Ils taient parfaitement capables de concevoir le nombre rel, tout en gardant au terme de nombre la signification de nombre entier pour les initis du 1er degr. je ne doute pas un instant qu'ils ne l'aient fait ; d'ailleurs Eudoxe, qui sont attribus la dfinition du nombre rel et les thormes qui s'y rapportent dans le livre V d'Euclide, tait un lve d'Archytas. Aristote dit de Platon que sa doctrine est purement et simplement celle des pythagoriciens, laquelle il n'aurait chang qu'un mot, en disant ides au lieu de nombres . Ce qui a caus la ruine des pythagoriciens, ce ne sont pas les incommensurables, c'est simplement le massacre des pythagoriciens vers le milieu du Ve sicle. Il est vrai, assurment, que la dcouverte des incommensurables a cr un drame, et le discrdit o est tombe de ce fait la notion de vrit est sans doute pour beaucoup dans les diverses doctrines pragmatistes qui ont surgi cette poque ; ces doctrines, jointes la diffusion des connaissances par les sophistes, sous une forme vulgaire, parmi les non-initis , ont considrablement contribu susciter la dmagogie, et par suite l'imprialisme, lequel a ruin la civilisation hellnique. Mais il se peut fort bien que le drame n'ait t vraiment un drame que pour les non-initis . Les pythagoriciens n'ont pas d douter de la raison pour avoir trouv des rapports non exprimables en nombres entiers. En tout cas il est remarquable que l'tude des rapports de grandeur dans les lignes et non dans les nombres ait prcd la dcouverte des
Simone Weil, Sur la science (1966) 158
incommensurables, laquelle, autrement, n'aurait jamais eu lieu. (A ce propos, il est singulier peut-tre que les problmes qui ont pouss en avant la gomtrie grecque soient ceux que notre algbre lmentaire ne considre pas comme des problmes. Quand en rsolvant une quation un lve de lyce obtient ab , 3 abc , il ne se croit pas en prsence d'un problme, mais d'une solution ; au lieu que la proccupation essentielle des Grecs fut de donner un sens ces expressions.) Dans les tablettes babyloniennes tudies par N[eugebauer], les quations du 2e, 3e, 4e degrs sont construites partir de leur solution (c'est vident du fait qu'on en a des sries qui ont toutes la mme solution). Cela montre que les Babyloniens ne s'intressaient qu' la mthode, et non rsoudre des problmes rellement poss. Il est vident, de mme, que la somme des ouvriers et des jours de travail n'est jamais donne. Ils s'amusaient chercher le connu, suppos inconnu, partir de l'inconnu, suppos connu. C'est un jeu qui fait le plus grand honneur leur conception de la recherche dsintresse . (Avaient-ils des mdailles et des bourses ?) Mais ce n'est qu'un jeu. Si jusqu' Diophante il n'y a pas trace d'algbre chez les Grecs (sinon traduite en gomtrie), c'est certainement que l'algbre pure tait leurs yeux interdite. Sans quoi pourquoi n'auraient-ils pas crit en grec des traits d'algbre ct des traits de gomtrie ? Pour n'avoir que des problmes admettant comme solution des nombres entiers, il leur aurait suffi, comme aux Babyloniens, de construire les problmes partir des solutions. je crois que l'explication ne peut tre trouve que dans une interdiction de nature philosophico-religieuse. Les jeux de ce genre devaient leur sembler impies. Car pour eux les mathmatiques constituaient, non un exercice de l'esprit, mais une clef de la nature ; clef recherche non pas en vue de la puissance technique sur la nature, mais afin d'tablir une identit de structure entre l'esprit humain et l'univers. C'est ce qui est exprim par la formule : (en grec dans le texte). Les mathmatiques taient aux yeux des pythagoriciens (et de Platon) une condition de la plus haute vertu (et gardes secrtes ce titre). Il est clair que l'algbre pur n'est pas utile cet effet. Ce qui est utile cet effet, c'est l'tude - rigoureusement mathmatique, c'est-dire mthodique et sans approximation -des problmes rellement poss par le monde et l'action sur le monde. La gomtrie est de la science applique, bien qu'il s'agisse d'une application thorique, si l'on peut s'exprimer ainsi. Et les dbuts de la physique, dans Archi-
Simone Weil, Sur la science (1966) 159
mde, sont de mme espce : application d'une mthode mathmatique des problmes rels au moyen d'une axiomatique. Je crains qu'aujourd'hui on ne soit retomb la conception babylonienne de la mathmatique. Il est vrai qu'on s'occupe beaucoup d'axiomatique ; mais ne choisit-on pas les axiomes dans une certaine mesure volont ? Tu parles d'art et de matire dure ; mais je ne puis concevoir en quoi consiste cette matire. Les arts proprement dits ont une matire qui existe au sens physique du mot. La posie mme a pour matire le langage regard comme ensemble de sons. La matire de l'art mathmatique est une mtaphore ; et quoi rpond cette mtaphore ? La matire de la gomtrie grecque tait l'espace, mais l'espace trois dimensions, rellement donn, condition impose en fait toutes les actions des hommes. Il n'en est plus ainsi. La matire de ton travail, ne serait-ce pas l'ensemble des travaux mathmatiques antrieurs, avec le langage et le systme de signes qui en rsulte ? Si l'objet de la science et de l'art sont de rendre intelligible et sensible l'unit entre
III. Extrait d'un brouillon de lettre
Retour la table des matires
La dcouverte des incommensurables comporte deux dcouvertes distinctes : 1 qu'il y a des oprations sur les chiffres ( 2 ) qui ne comportent pas de rsultats en nombres rationnels ; 2 qu'en revanche, ces rsultats impossibles trouver, correspondent des segments. On prsente la chose, gnralement, dans l'ordre inverse ; on suppose qu'on a d'abord trouv que la diagonale du carr est 2 et qu'ensuite on a cherch 2 ; ou en tout cas que c'est en cherchant une commune mesure des segments qu'on s'est aperu que dans certains cas la mesure n'existe pas. Que l'aspect gomtrique de cette notion ait t tudi avant l'aspect arithmtique, c'est une supposition arbitraire et tout fait invraisemblable ; car les nombres ont t tudis longtemps
Simone Weil, Sur la science (1966) 160
avant les lignes. Les Babyloniens ont d ncessairement s'apercevoir que leurs mthodes algbriques conduisaient une solution seulement dans le cas o les donnes taient convenablement choisies - aussi choisissaient-ils les donnes partir de la solution. Qu'ont-ils pens des autres cas ? Nous ne pouvons pas savoir s'ils se sont crus arrts par une trop grande complication dans les calculs ou par une impossibilit. Mais pour les pythagoriciens ou pr-pythagoriciens, la chose est beaucoup plus claire. Puisqu'ils tudiaient les proportions numriques et toutes les espces de moyennes entre nombres, ils ont d chercher la moyenne gomtrique entre un nombre et son double, comme ils ont fait pour la moyenne harmonique et la moyenne arithmtique. (Peut-tre ont-ils donn ce problme la forme de la duplication du carr ; le problme de Dlos le suggre, par analogie.) La moyenne gomtrique entre un nombre et son double dut leur sembler difficile trouver en nombres rationnels. Mais ils nommaient l'arithmtique science du pair et de l'impair , ce qui suggre qu'ils devaient se demander si un nombre form d'une manire dtermine est pair ou impair. Ds lors, on peut supposer qu'ils se sont pos cette question pour la moyenne proportionnelle entre un nombre et son double, lorsque cette moyenne est un nombre entier. Il leur tait facile de dmontrer que cette moyenne est paire et qu'elle est impaire ; il suffit de savoir que seul le carr d'un nombre pair peut tre pair, ce qui est presque immdiat, notamment si on reprsente un nombre carr avec des points. Donc une telle moyenne (en nombres entiers) n'existe jamais. Il est facile d'en conclure qu'elle n'existe jamais non plus sous forme de fraction. Aristote dit qu'on dmontre l'incommensurabilit de la diagonale par l'absurde : si elle tait commensurable, le pair serait gal l'impair. C'est le texte le plus ancien sur cette question. Que racine n.2n n'existe pas, cela peut avoir t angoissant. Mais rien n'empchait Pythagore de le savoir avant d'avoir form sa doctrine. Imaginons qu'il en ait t ainsi ; en ce cas, la dcouverte de la diagonale du carr aurait t de nature bouleverser, non d'angoisse,
Simone Weil, Sur la science (1966) 161
mais de joie. Car d'abord un rapport numrique, impossible exprimer en nombres, existe nanmoins, dfini par des quantits parfaitement dtermines. Puis ce rapport, pour tre saisi comme tel, exige un exercice de l'intelligence bien plus pur et plus dpouill de tout secours des sens que n'importe quelle relation entre nombres. Un pareil choc, une pareille joie ont bien pu mener la formule tout est nombre , i.e. : il y a en toutes choses sans exception des rapports analogues aux rapports entre nombres. Car autrement cette formule serait stupide, vu que tout n'est pas nombre. Je pense que les choses se sont passes ainsi. Car la dcouverte des incommensurables a eu un retentissement immense ; on le sent par le nombre et la nature des allusions qui y sont faites. Elle est cite sans cesse comme un exemple de choix. Mais si ce retentissement avait t douloureux, cela se sentirait dans les allusions. Or on sent le contraire. Ainsi dans le Mnon, Socrate, pour prouver que toutes les mes viennent du ciel intelligible et se ressouviennent , interroge un esclave sur la duplication du carr. Ce problme est donc li une connaissance qui tmoigne minemment de l'origine divine de l'me. L'Epinomis (apocryphe de Platon) dit : Ce qu'on appelle d'un nom tout fait ridicule gomtrie, et qui est l'assimilation (en grec dans le texte ) des nombres ( en grec dans le texte) non semblables entre eux par nature (en grec dans le texte), assimilation rendue manifeste par la nature (en grec dans le texte) des choses planes ; merveille non humaine, mais divine, comme il est vident quiconque peut la comprendre. Ce texte, mon avis, dfinit la gomtrie comme la science du nombre rel. Je ne vois pas d'autre interprtation. Platon met aussi les incommensurables en tte du Thtte, le dialogue qui concerne le savoir. Thals a pu avoir une connaissance intuitive de son thorme en reprsentant sur un plan l'image de proportions numriques
Simone Weil, Sur la science (1966) 162
Si, comme je le suppose, Pythagore a constitu un triangle rectangle avec deux triangles semblables pour former des moyennes proportionnelles, s'il a obtenu ainsi ce qu'il savait ne pas pouvoir obtenir en nombres, une moyenne proportionnelle entre un nombre et son double - alors le ton d'exaltation qui marque toute vocation de la gomtrie, et notamment des incommensurables, se conoit trs bien. Trouver dans les nombres des rapports permettant de connatre d'avance les caractres (pair, impair, carr, etc.) de nombres qu'on n'a pas forms trouver des rapports non numriques aussi exacts que les rapports entre nombres - voil deux choses enivrantes. Ces suppositions impliquent, bien entendu, que la notion de proportion telle qu'elle est dans le livre V d'Euclide serait trs antrieure Eudoxe. C'est ce que je voulais suggrer en indiquant qu'Eudoxe est d'origine pythagoricienne. La philosophie de Platon est inintelligible sans une telle thorie. Eudoxe tait son contemporain ; mais aucune tradition, aucune internal evidence (il me semble) n'indique qu'il ait reu au cours de sa vie une rvlation d'un contemporain. Aurait-il mis dans la bouche de Socrate l'allusion que Je t'ai rappele la diagonale du carr si celle-ci avait t, du temps de Socrate, un objet de scandale ? Que les dmonstrations datent des incommensurables, voil en revanche ce que je crois volontiers. Note qu'il a trs bien pu y avoir catastrophe et scandale chez les esprits peu scientifiques et peu philosophiques. C'est mme plus que probable. Qui sait si la dmonstration sur le pair gal l'impair n'a pas t le modle des dmonstrations prouvant une thse et son contraire (base de la sophistique), qui ont pullul au Ve sicle et ont dmoralis Athnes ? - Nous ne sommes pas prs de nous entendre sur Nietzsche. Il ne m'inspire aucune inclination le traiter lgrement ; seulement une
Simone Weil, Sur la science (1966) 163
rpulsion invincible et presque physique. Mme quand il exprime des choses que je pense, il m'est littralement intolrable. J'aime mieux croire sur parole qu'il est un grand homme que d'y aller voir ; pourquoi m'approcherais-je de ce qui me fait mal ? Mais je ne vois pas comment un amant de la sagesse qui finit comme il a fini peut tre regard comme ayant russi. En admettant que des facteurs physiques aient jou dans son cas, un peu d'humilit sied aux malheureux, non un orgueil sans mesure. Si le malheur suscite l'orgueil comme une sorte de compensation, il y a l un phnomne qui mrite la piti, non l'estime, moins encore l'admiration. Comment surtout admettre qu'il ait pu comprendre quelque chose la Grce ? (D'abord, mettre son espoir en Wagner pour la ressusciter !...) Il s'est videmment dcrit lui-mme sous le nom d'homme dionysiaque, mais s'il avait vu juste, la Grce aurait sombr comme lui. Il s'est compltement tromp sur Dionysos - sans parler de l'opposition avec Apollon, qui est de la pure fantaisie, car les Grecs les mlaient dans les mythes et semblent parfois les identifier. Que n'a-t-il tenu compte de ce que dit Hrodote - et celui-l savait ce qu'il disait que Dionysos, c'est Osiris ? Ds lors, c'est le Dieu que l'homme doit imiter pour sauver son me, qui a rejoint l'homme dans la souffrance et la mort, et que l'homme peut et doit rejoindre dans la perfection et la flicit. Exactement comme le Christ. La dmesure, l'ivresse cosmique et Wagner n'ont rien voir ldedans. Je ne puis accepter aucune interprtation catastrophique de la Grce et de son histoire, ni qu'on dise qu'ils s'attachaient dsesprment la proportion et avaient un sentiment intense de la disproportion entre l'homme et Dieu (ce n'taient pas des Hbreux !). Certes ils avaient une conception douloureuse de l'existence, comme tous ceux qui ont les yeux ouverts ; mais leur douleur avait un objet ; elle avait un sens par rapport la flicit pour laquelle l'homme est fait, et dont le privent les dures contraintes de ce monde. Ils n'avaient aucun got du malheur, de la catastrophe, du dsquilibre. Au lieu que chez tant de modernes (Nietzsche notamment, je crois) il y a une tristesse lie
Simone Weil, Sur la science (1966) 164
la privation du sens mme du bonheur ; ils ont besoin de s'anantir. mon avis, il n'y a aucune angoisse chez les Grecs. C'est ce qui me les rend chers. Jamais, en luttant contre l'angoisse, on ne produit de la srnit ; la lutte contre l'angoisse ne produit que de nouvelles formes d'angoisse. Eux avaient la grce au dpart. Pour rpondre la question du mysticisme en Grce, il faut s'entendre. Il y a des gens qui ont simplement des tats d'extase ; il y en a d'autres qui font de ces tats un objet presque exclusif d'tude, les dcrivent, les classent, les provoquent dans la mesure du possible. Ce sont les seconds qu'on appelle gnralement mystiques ; c'est pourquoi saint Franois, je crois, n'est pas considr comme tel. En ce second sens, la mystique s'est introduite dans la civilisation hellnique avec les gnostiques et les no-platoniciens -peut-tre, comme tu supposes, non sans influence des gymnosophistes . Il est possible qu' haute poque les Grecs se soient abstenus de ce genre d'tudes volontairement, considrant qu'il y a des choses qu'il ne faut pas formuler, et tendant le secret, pour certaines choses, mme au dialogue de l'me avec elle-mme. En ce cas ils auraient eu mon avis, par parenthse, tout fait raison ; j'admire sainte Thrse, mais si elle n'avait rien crit elle mriterait mon sens plus d'admiration. Mais quant au fait d'avoir des tats d'extase et de leur attacher un haut prix, il ne peut y avoir aucun doute cet gard. Les crits de Platon en tmoignent assez. (D'ailleurs, le rle qu'il attribue l'amour est suffisamment caractristique.) Et quand, faisant l'loge de la en grec dans le texte) 32 issue des dieux, il dit que Dionysos inspire la (en grec dans le texte)des mystres, je ne vois pas comment interprter ce passage sans supposer des tats extatiques. Car il ne peut s'agir d'tats collectifs semi-dlirants. Quand des rites combins avec des instructions s'accompagnent d'tats extatiques, cela implique, il me semble, des pratiques mystiques. ce propos, on ne peut sparer Eschyle du reste de la pense grecque du fait qu'il a t initi leusis ; car c'tait le cas de pratiquement tout le monde. Diogne le Cynique ne l'a pas t ; cela faisait partie de son cynisme. C'est bien un signe que tout le monde l'tait. Je parle de ceux qui comptent.
32 Folie.
Simone Weil, Sur la science (1966) 165
Il y a dans le Philbe un passage bien singulier. C'est un prsent des dieux aux hommes, il me semble, qui est tomb du ciel grce quelque Promthe en mme temps que quelque feu trs lumineux ; et les anciens (en grec dans le texte), valant mieux que nous et habitant plus prs des dieux, nous ont transmis cet oracle ; savoir que toutes les choses qu'on dit tre toujours sont composes de l'un et du plusieurs, et ont comme [proprits] inhrentes la limite et l'illimit. (La suite explique que dans chaque sujet de recherche il faut saisir l'ide unique qui le domine, puis passer au plusieurs , c'est--dire poser un certain nombre d'ides permettant de qualifier et ordonner toutes les choses embrasses par cette ide unique ; et ce travail une fois achev, alors seulement passer la diversit illimite des choses en question. Ex. : 1 le son ; 2 le grave et l'aigu, les intervalles, etc. ; 3 les sons. Il dit que les modernes ne savent pas se servir de cette mthode.) Ce passage sonne pythagoricien ; mais les pythagoriciens taient trop rcents pour tre ces ( en grec dans le texte). Il s'agit donc ou des habitants pr-hellniques de la Grce, ou d'un pays tranger, sans doute I'gypte. Mais le ton (dieux, Promthe, oracle, etc.) suggre une transmission religieuse. Sans doute s'agit-il de l'orphisme ; peut-tre, par suite, de la doctrine des mystres. On a l la preuve en tout cas (que personne n'a releve ma connaissance) que ce qui forme la partie la plus originale nos yeux des doctrines pythagoricienne et platonicienne est d'origine trs antique. Cette conception du nombre comme formant une sorte de moyenne entre l'unit (qui est le propre de la pense) et la quantit illimite [en grec dans le texte] qui est donne dans l'objet est singulirement lumineuse. Le sens indiqu (un - plusieurs - illimit) exclut compltement ce que nous nommons induction et gnralisation. Il est remarquable que cette mthode ait t scrupuleusement observe par la science grecque. De la mme manire, la proportion, dans les choses visibles, permet la pense de saisir d'un seul coup une diversit complexe o, sans le secours de la proportion, elle se perdrait. L'me humaine est exile dans le temps et l'espace qui la privent de son unit ; tous les procds de purification reviennent la dlivrer des effets du temps, de manire qu'elle parvienne se sentir presque chez elle dans le lieu de son exil. Le seul fait de pouvoir saisir d'un coup une multiplicit de points de vue d'un mme objet rend l'me heureuse ; mais il faut que
Simone Weil, Sur la science (1966) 166
la rgularit et la diversit soient combines de telle sorte que la pense soit sans cesse sur le point de se perdre dans la diversit et sans cesse sauve par la rgularit. Mais les objets fabriqus cet effet ne suffisent pas ; la pense aspire concevoir le monde mme comme analogue une uvre d'art, l'architecture, la danse, la musique. cet effet il faut y trouver la rgularit dans la diversit, c'est--dire des proportions. On ne peut admirer une uvre d'art sans s'en croire l'auteur de quelque faon, et, en un sens, le devenir ; de mme, en admirant l'univers la manire d'une uvre d'art, on en devient d'une certaine manire l'auteur. Il en rsulte une purification des passions et des dsirs, qui se rapportent la situation particulire d'un petit corps humain dans le monde, et qui n'ont plus de sens quand la pense prend pour objet le monde mme. Mais les proportions sont indispensables cet effet, sans quoi il ne peut y avoir quilibre entre la pense et une matire diverse, complexe et changeante. D'autre part elles n'ont aucun prix en elles-mmes, mais seulement pour autant qu'elles sont appliques dans les arts d'une part, dans les sciences de la nature de l'autre. Ainsi appliques, elles arrachent l'esprit aux dsirs pour l'amener la contemplation, qui exclut les dsirs. (Tout cela, bien entendu, ne s'appuie pas sur des textes, ou de loin.) La mesure, l'quilibre, la proportion et l'harmonie constituaient aux yeux des Grecs le principe mme du salut de l'me, parce que les dsirs ont pour objet l'illimit. Concevoir l'univers comme un quilibre, une harmonie, c'est aussi en faire comme un miroir du salut. Dans les rapports entre hommes aussi, le bien consiste liminer l'illimit ; c'est cela la justice (qui ne peut alors se dfinir que par l'galit). De mme dans les rapports d'un homme avec lui-mme. Sur l'galit gomtrique comme loi suprme de l'univers en mme temps que condition du salut de l'me, il y a un texte dans le Gorgias. Ces notions constituent, il me semble, l'atmosphre mme des tragdies d'Eschyle. Si par le sentiment de disproportion entre la pense et le monde tu entendais le sentiment d'tre exil dans le monde, alors oui, les Grecs ont eu intensment le sentiment que l'me est exile. C'est de chez eux qu'il est pass dans le christianisme. Mais un tel sentiment ne comporte aucune angoisse, de l'amertume seulement. D'autant plus que si comme j'en suis convaincue - les stociens n'ont rien invent, mais re-
Simone Weil, Sur la science (1966) 167
produit en leur langage la pense de l'orphisme, de Pythagore, Socrate, Platon, etc., on peut dire que pour l'me ce lieu de son exil est prcisment sa patrie, si seulement elle sait la reconnatre. Qui sait si, dans l'Odysse, l'histoire d'Ulysse se rveillant Ithaque et ne la reconnaissant pas n'est pas un symbole cet effet ? L'Odysse est videmment farcie de symboles philosophiques (Sirnes, etc.). Les Grecs ont eu plus que tout autre peuple le sentiment de la ncessit. C'est un sentiment amer, mais qui exclut l'angoisse. Jamais je n'admettrai d'ailleurs que qui que ce soit au XIXe sicle ait compris quoi que ce soit la Grce. Beaucoup de questions se trouvent ainsi rgles. Ta thse, que la doctrine d'un artiste n'a pas d'effet sur son art, ne me parat pas soutenable. Qu'il ait dans les yeux et les mains des problmes qui exigent une attention exclusive de sa part, d'accord. Mais ce sont ces problmes qu'ils ont dans les yeux et les doigts qui, je pense, dpendent de leur conception du monde et de la vie humaine. Cela ne s'applique, il est vrai, qu' ceux de tout premier ordre. Mais moi, les autres ne m'intressent gure. Je ne crois pas qu'on puisse soutenir que l'art de Giotto, pour ne citer que lui, est sans rapports avec l'esprit franciscain. Pour la science, de mme, je ne pense pas qu'on puisse regarder comme indiffrent le fait que Galile tait platonicien. D'une manire gnrale, je ne pense pas qu'un homme de tout premier ordre accepte une conception de la vie. humaine, du bien, etc., du dehors, au hasard (bien qu'il puisse accepter ainsi une tiquette), ni que chez un tel homme aucune forme d'activit soit sans relations troites avec toutes les autres. Le mystre du trs grand art, prcisment, c'est que la doctrine de l'artiste passe dans ses mains. Peu importe qu'en mme temps il puisse ou non l'exprimer en paroles. ...........................................................
Simone Weil, Sur la science (1966) 168
III bis.Variante d'une partie du texte prcdent
Retour la table des matires
qui concerne le savoir. ( ce propos, Th. ne dmontre pas seulement l'irrationalit des racines jusqu' 17 , mais,ensuite, de toutes les racines de nombres non carrs. Il devait dmontrer qu'une fraction qui, leve au carr, gale un nombre entier, est toujours rductible un nombre entier. Mais cela est prsent comme un exercice d'colier, il me semble, non comme une dcouverte.) Thals a pu avoir une connaissance intuitive de son thorme en reprsentant sur un plan des images de proportions numriques :
Si, comme je le suppose, Pythagore a constitu un triangle rectangle avec deux triangles semblables en vue de former des moyennes proportionnelles ; s'il a obtenu ainsi une moyenne entre un nombre et son double, sachant dj qu'il ne pouvait l'obtenir en nombres ; s'il a conu le rapport entre cette moyenne et ce nombre comme un rapport exact, ce qui semblait indiquer que le pouvoir de l'intelligence s'tend tout ce qui ne se compte pas -alors le ton d'exaltation extatique qui marque toute vocation de la gomtrie, et notamment des incommensurables, se conoit trs bien. Non autrement.
Simone Weil, Sur la science (1966) 169
Trouver dans les nombres des lois permettant de dfinir d'avance les caractres (pair, impair, carr, etc.) de nombres qu'on n'a pas forms - trouver, l o le nombre ne peut fournir aucun secours, des rapports numriques aussi exacts que les rapports entre nombres - voil deux choses enivrantes, mais la seconde bien plus. Je pense donc que la notion de proportion, telle qu'elle est dans le livre V d'Euclide, est trs antrieure Eudoxe. (C'est ce que je voulais suggrer en indiquant qu'Eudoxe est de filiation pythagoricienne.) La philosophie de Platon est inintelligible si on n'admet pas qu'il ait eu cette notion. Il aurait pu, la rigueur, l'emprunter Eudoxe, son contemporain - mais aucune tradition, ni, je crois, aucune internal evidence n'indique qu'il ait reu une rvlation d'un contemporain. Aurait-il mis dans la bouche de Socrate l'allusion que je t'ai rappele la diagonale du carr si celle-ci avait t, du temps de Socrate, un objet de scandale et le signe d'une faillite ? Note qu'il y a trs probablement eu bouleversement et scandale chez tous les esprits un peu grossiers. Qui sait si la dmonstration qu'un mme nombre est pair et impair n'a pas servi de modle toutes ces dmonstrations prouvant une thse et son contraire (base de la sophistique) qui ont pullul au Ve sicle et dmoralis Athnes ? - Nous ne sommes pas prs de nous entendre sur Nietzsche. Il ne m'inspire aucune inclination le traiter avec lgret, mais une rpulsion invincible et presque physique ; et cela mme quand il exprime des choses que je pense. J'aime mieux croire sur parole qu'il est un grand homme que d'y aller voir ; pourquoi m'approcherais-je de ce qui me fait mal ? Mais un amant de la sagesse qui finit comme lui, il me parat difficile de considrer qu'il a russi. En admettant que des facteurs physiques aient jou contre lui, qu'il ait lutt toute sa vie contre le malheur pour tre finalement vaincu, alors un peu d'humilit sied aux malheureux, non un orgueil sans mesure. Si le malheur produit un tel orgueil par compensation, le malheureux peut tre lgitimement un objet de piti, non d'estime, moins encore d'admiration. Il s'est videmment dcrit lui-mme sous le nom d'homme dionysiaque ; mais s'il avait vu juste, la Grce aurait sombr comme lui.
Simone Weil, Sur la science (1966) 170
C'est assez pour montrer qu'il ne l'a pas comprise. D'ailleurs, compter sur Wagner pour la ressusciter ! Il s'est compltement tromp sur Dionysos (sans compter que l'opposition avec Apollon est de pure fantaisie, je crois). Que n'a-t-il cout Hrodote - un homme qui, lui, sait de quoi il parle -quand il dit que Dionysos, c'est Osiris ? Ds lors, il s'agit du Dieu dont l'imitation constitue le salut de l'me ; qui a rejoint l'homme dans l'humiliation, la souffrance et la mort ; que l'homme peut et doit rejoindre dans la perfection (c'est--dire la puret, la justice, la vrit) et dans la flicit. Exactement comme le Christ. La dmesure, l'ivresse cosmique, Wagner n'ont rien voir ldedans. Je ne puis admettre aucune explication catastrophique de la Grce et de son histoire. Ils avaient certes une conception douloureuse de l'existence humaine, comme tous ceux qui ont les yeux ouverts. Mais leur douleur avait un objet ; elle avait un sens par rapport la flicit qui est le partage naturel de l'me, et dont elle est prive par les dures contraintes de ce monde. La douleur n'apparat jamais chez eux que comme l'chec d'une aspiration la flicit. C'est en ce sens seulement que (comme dit Nietzsche) il a pu y avoir chez eux mlange de douleur et de joie ; car le sentiment d'tre n pour la flicit est encore un sentiment heureux, mme s'il reste misrablement impuissant, et il apparat plus pur dans le malheur. Au contraire, chez tant de modernes - N. notamment, je crois - il y a une tristesse en soi, une tristesse lie l'absence du sens mme du bonheur. Chez eux, le mlange de la douleur et de ce qu'ils nomment joie vient de ce que la catastrophe les attire ; ils y trouvent leur volupt ; ils ont besoin de s'anantir. mon sens, la folie est essentiellement la privation totale de la joie et de l'ide mme de la joie. mon avis, il n'y a aucune angoisse chez les Grecs. C'est ce qui me les rend chers. Jamais, en luttant contre l'angoisse, on ne produit de la srnit ; la lutte contre l'angoisse ne produit que de nouvelles formes d'angoisse. Eux taient sur un autre plan ; ils avaient la grce.
Simone Weil, Sur la science (1966) 171
Ce qu'ils ont eu intensment, c'est le sentiment de l'exil, le sentiment que l'me est exile dans le monde. C'est de chez eux qu'il est pass dans le christianisme. Mais un tel sentiment ne comporte aucune angoisse, de l'amertume seulement. Ils ont eu de mme, plus que tout autre peuple, le sentiment de la ncessit et de son empire impossible combattre. Mais ce sentiment, le plus amer de tous, exclut l'angoisse. Les stociens n'ont, je pense, rien invent, mais transmis seulement, en enseignant que ce monde est la patrie de l'me ; elle doit apprendre reconnatre sa patrie dans le lieu mme de son exil. Qui sait si l'histoire d'Ulysse se rveillant Ithaque sans la reconnatre n'est pas un symbole cet effet ? L'Odysse est videmment farcie de symboles philosophiques (Sirnes, etc.). Pour le problme du mysticisme en Grce, il faut s'entendre. Il y a des gens qui ont simplement des tats d'extase ; il y en a qui, de plus, tudient ces tats d'une manire presque exclusive, les dcrivent minutieusement, les classent, les provoquent dans une certaine mesure. Ce sont les seconds qu'on appelle gnralement mystiques ; ainsi saint Franois, je crois, n'est pas regard comme tel. En ce sens il n'y a pas trace de mystique avant les no-platoniciens et les gnostiques. Il a trs bien pu y avoir, dans la priode classique et prclassique, une sorte d'interdiction cet gard ; on a pu juger peu convenable de formuler en paroles ce qu'il y a de plus prcieux. Ils ont pu tendre la notion du secret jusqu' prserver mme l'gard de soi-mme le secret des choses les plus leves, et les recouvrir d'un silence complet. La vertu du silence, laquelle les pythagoriciens attachaient tant de prix, ne devait pas concerner seulement les rapports avec les profanes. Mais si l'on nomme mystique le fait d'avoir des tats d'extase, de leur attacher un haut prix, et sinon de les provoquer, du moins de chercher se mettre dans une disposition d'esprit o ils sont possibles - alors Platon, tout d'abord, est un mystique. Le rle qu'il attribue l'amour est significatif cet gard ; et il ne manque pas chez lui d'allusion des tats extatiques. De plus quand, faisant l'loge de la ( en grec dans le texte 33 inspire par les dieux, il dit que Dionysos inspire
33 Folie.
Simone Weil, Sur la science (1966) 172
celle des mystres, il tmoigne de l'existence d'une tradition mystique. Car cette ( en grec dans le texte) ne peut consister qu'en tats extatiques ; il ne saurait tre question d'tats collectifs semi-dlirants. Quand des rites combins des enseignements s'accompagnent d'tats d'extase, il doit y avoir des pratiques mystiques. ce propos, on ne peut sparer Eschyle du reste de la pense grecque parce qu'il tait initi leusis. Cela semble avoir t le cas, pratiquement, de tout le monde ; tous ceux qui comptaient. Il y a un texte trs singulier dans le Philbe. C'est un prsent des dieux aux hommes, je crois, qui est tomb de chez les dieux, grce quelque Promthe, en mme temps que quelque feu trs lumineux ; et les anciens (en grec dans le texte), valant mieux que nous et habitant plus prs des dieux, nous ont transmis cet oracle ; savoir que toutes les choses qu'on dit tre toujours sont composes de l'un et du plusieurs, et ont comme proprits intrinsques (en grec dans le texte) la limite et l'illimit (en grec dans le texte). La suite explique que, pour toute recherche sur un sujet quelconque, il faut saisir l'ide unique qui embrasse tout le sujet - puis les ides, en nombre limit, qui permettent de qualifier, classer, mettre en ordre les choses embrasses par l'ide unique - et seulement une fois toutes ces ides trouves, passer la varit illimite des choses dont il est question. Ex. 1o le son ; 2o le grave, l'aigu, les intervalles, etc. ; 3o les sons. Platon dit que les savants (en grec dans le texte) modernes ne savent plus employer convenablement cette mthode.
III ter. Autre variante du mme texte
Retour la table des matires
Mon ide, sur la dcouverte des incommensurables, est que les Grecs ont commenc par dcouvrir, non pas que la diagonale du carr est incommensurable, mais qu'il n'y a pas de moyenne proportionnelle entre deux nombres dont l'un est le double de l'autre. Comme indication historique, je ne connais que deux textes. L'un, de Platon, dans le
Simone Weil, Sur la science (1966) 173
Mnon, o Socrate, pour prouver que toute me - y compris celle d'un esclave - vient du ciel intelligible , interroge un esclave sur la duplication du carr, et lui fait trouver (par des questions bien choisies) qu'on obtient le double d'un carr en prenant la diagonale comme ct. Il n'y a rien d'autre ; mais le choix de ce problme (duplication du carr) suggre qu'il est li une connaissance qui tmoigne minemment de l'origine divine de l'intelligence humaine ; et que serait cette connaissance, sinon celle des incommensurables ? L'autre texte est d'Aristote ; il dit qu'on dmontre l'incommensurabilit de la diagonale par l'absurde : car si la diagonale tait commensurable, le pair serait gal l'impair. Le nombre la fois pair et impair est videmment celui qui mesure la diagonale. Comme les pythagoriciens (auteurs de la dcouverte) nommaient l'arithmtique l'tude du pair et de l'impair, il n'y a rien d'invraisemblable, tout au contraire, ce que cette dmonstration soit la leur. Cherchant une moyenne proportionnelle entre un nombre et son double, ils ont pu, avant de la trouver, se demander si elle tait paire ou impaire ; voir qu'elle est ncessairement l'un et l'autre la fois ; en conclure qu'il n'y en a pas. Tu n'ignores pas qu'ils faisaient des recherches d'arithmtique (ils ont dmontr que tout carr entier est la somme des n premiers nombres impairs). Cette voie me parat extrmement naturelle. Quant la raison pour laquelle ils se sont intresss la moyenne proportionnelle entre un nombre et son double, je pense que cela tenait l'intrt qu'ils portaient aux sries. La moyenne arithmtique et la moyenne harmonique entre un nombre et son double sont signales comme quelque chose d'admirable dans un texte de l'Epinomis (apocryphe de Platon) qui semble inspir d'eux. Le texte du Mnon et l'histoire de Dlos suggrent que ce problme a pu prendre la forme du problme de la duplication du carr. Reprsenter la moyenne proportionnelle en question par la diagonale du carr devait venir immdiatement l'esprit, soit en remarquant que le carr construit sur la diagonale est double, soit par la proprit du ct droit du triangle rectangle, qui est moyenne proportionnelle entre l'hypotnuse et le segment dtermin sur l'hypotnuse par la hauteur. En disant qu'il n'y a pas eu de drame des incommensurables, je ne veux pas dire que les Grecs n'aient pas t bouleverss d'motion par cette dcouverte. je sais qu'ils l'ont t ; on en voit partout des traces.
Simone Weil, Sur la science (1966) 174
(Par parenthse, si la transcendance d'e et a laiss les gens indiffrents, c'est que nous sommes abrutis.) Mais je pense que cette motion a t joie et non pas angoisse. Comme tu peux voir de ce qui prcde, je pense qu'ils ont t, non pas stupfaits qu'il y ait des rapports indfinissables par les nombres, mais intensment heureux de voir que mme ce qui ne se dfinit pas par nombres est encore rapport. L'Epinomis, dj cit, dit ... ce qu'on appelle, d'un nom tout fait ridicule, gomtrie, et qui est l'assimilation (en grec dans le texte) des nombres (en grec dans le texte) non semblables entre eux par nature, assimilation rendue manifeste par la ncessit (en grec dans le texte) des choses planes ; merveille non humaine, mais divine, comme il est vident quiconque peut la comprendre. Les esprits de second ordre ont pu tre consterns ; les autres ont d tre dans le ravissement, en s'levant une notion du rapport qui demande un exercice de l'intelligence plus dpouill que le rapport numrique. La dcouverte des incommensurables exige seulement le raisonnement prouvant que si
n m = , m est pair et impair, et l'application m 2n
au demi-carr des proprits du triangle rectangle. L'un et l'autre taient la porte de Pythagore. Je pense que loin que cette dcouverte ait pu porter le trouble dans la doctrine que tout est nombre , elle en est l'explication. Car dire que tout est nombre, au sens littral, est une stupidit vidente. Car tout n'est pas nombre. Mais si on a dcouvert, dans un certain cas, que mme ce qui n'est pas nombre est nanmoins encore nombre en un sens, on peut dire alors que tout est nombre - c'est--dire rapport. Sans doute les Pythagoriciens taient heureux de trouver dans les sons, par exemple, des rapports numriques. Mais il aurait fallu qu'ils fussent idiots s'ils avaient cru pouvoir en trouver partout. Ce que je dis suppose, videmment, qu'ils aient eu une ide nette des rapports irrationnels. Mais si l'on avait attendu Eudoxe pour cela, la philosophie de Platon ne serait pas intelligible. En te signalant qu'Eudoxe tait l'lve d'un gomtre pythagoricien, je voulais suggrer qu'il a pu hriter et non dcouvrir une partie de ce qu'on rapporte lui. Il a trouv l'axiome dit dArchimde ; c'est dj assez beau ; je ne puis croire qu'il ait trouv la notion de nombre rel ; car autrement, jusqu' lui, l'incommensurabilit de la diagonale aurait t un scan-
Simone Weil, Sur la science (1966) 175
dale, et on ne l'aurait pas voque complaisamment comme l'exemple par excellence d'une vrit saisie par l'intelligence pure. La manire dont Platon et Aristote y font allusion montre que c'tait dans ces milieux l'exemple classique. Eudoxe est contemporain de Platon ; on pourrait la rigueur supposer que Platon a modifi sa philosophie en consquence de sa dcouverte ; mais Aristote ne dirait pas alors qu'il n'a chang qu'un mot la doctrine des pythagoriciens. Quoi qu'il en soit, je pense que les incommensurables ont donn aux Grecs l'ide d'intelligible pur, ou, pour parler avec plus de prcision, leur ont procur des vrits qui exigent, pour tre saisies, une sparation plus nette entre l'intelligence et l'usage des sens que les propositions concernant les nombres ; c'est pourquoi cela leur a sembl un prsent des dieux. Je ne peux admettre aucune interprtation catastrophique de la pense grecque ou de son histoire. je ne traiterais pas lgrement la Naissance de la Tragdie ; ce livre m'est seulement trs souvent odieux. Je ne puis supporter Nietzsche ; il me rend malade, mme quand il exprime des choses que je pense. J'aime mieux admettre, sur la foi de sa rputation, que c'est un grand homme, que d'y aller voir. Pourquoi approcherais-je ce qui me fait mal ? Mais pour Dionysos, il s'est compltement tromp ; pourquoi n'a-t-il pas tenu compte de ce que dit Hrodote (qui savait de quoi il parlait), que Dionysos, c'est Osiris ? L'un et l'autre reprsentent donc le Dieu qu'il faut imiter (comme dit Platon) pour que l'me soit sauve ; exactement comme le Christ. Mais il serait trop long de s'tendre l-dessus. Je ne puis admettre qu'on dise que les Grecs se sont attachs dsesprment la proportion (c'tait bon pour Nietzsche de s'attacher dsesprment , parce qu'il sentait qu'il allait devenir fou), ou qu'ils aient eu un sentiment si intense de la disproportion entre l'homme et Dieu. Tous les hommes ont le sentiment la fois d'une distance infinie et d'une unit absolue entre l'homme et Dieu ; ces deux sentiments contradictoires se combinent partout en nuances infinies. Chez les Grecs l'angoisse et le dsespoir n'avaient pas part au sentiment de leur rapport avec le monde, en ce sens qu'ils conservaient toujours le sens du bonheur. Chez des hommes comme Nietzsche - qui se dcrit luimme sous le nom d'homme dionysiaque ; comment ds lors pouvait-
Simone Weil, Sur la science (1966) 176
il voir juste ? Car s'il avait vu juste, la Grce aurait comme lui sombr dans la folie - l'ide de bonheur n'voque rien ; la catastrophe et le dsquilibre les attirent ; ils ont besoin de s'anantir. Les Grecs avaient une conception douloureuse de la vie, car ils savaient que la ncessit crase l'homme ; mais ils savaient aussi que l'homme est cras par des forces extrieures, et qu'en lui se trouve un principe de bonheur. Leur conception du bonheur tait l'quilibre, quilibre entre les parties de l'me, quilibre entre les hommes, quilibre entre la pense et le monde. La parent entre la gomtrie et la justice, l'ide que le monde est constitu par une harmonie comme l'me quand elle est ce qu'elle doit tre, sont voques par Platon comme le trsor d'une antique sagesse. Il n'est pas facile de concevoir et d'exprimer en quoi a pu consister au juste le rle de la proportion. En ce qui concerne l'art, la proportion permet la pense de saisir et d'ordonner d'un coup la diversit. Si la proportion est employe judicieusement - c'est--dire de manire laisser subsister le sentiment de la diversit - la pense se trouve dans la situation la plus heureuse, qui consiste pour elle se sentir chez soi au milieu de la matire. On pourrait dfinir l'objet de l'art comme tant d'amener l'me se sentir chez elle dans le lieu de son exil. Mais les objets fabriqus ne suffisent pas ; la pense dsire pouvoir apercevoir le monde lui-mme comme une uvre d'art ; il s'agit l, non plus d'tablir, mais de trouver des proportions. Plus on en aperoit, plus l'univers devient le contraire d'un cauchemar. La purification consiste en ce que l'ordre de l'univers devient objet d'amour (c'est la conception stocienne ; je pense qu'ils n'ont rien invent) et en ce que l'esprit d'un homme, condamn presque tout subir, devient d'une certaine manire l'auteur mme de l'univers. On ne peut admirer une uvre d'art sans s'en croire l'auteur de quelque faon ; admirer l'univers comme une oeuvre d'art, c'est s'assimiler de quelque faon Dieu. Les mathmatiques sont utiles cet effet comme science de la nature. Il semble clair que retrouver, dans des apparences changeantes et diverses o l'homme se perd, quelques rapports simples donne un bonheur de ce genre. Un rapport qui se retrouve identique dans des choses diverses, c'est la notion mme de proportion. Ds lors qu'il est question d'imitation de Dieu (le mot est de Platon), la mystique est proche. Bien que le terme soit vague, je pense
Simone Weil, Sur la science (1966) 177
qu'on s'accorderait gnralement l'appliquer certains passages de Platon. D'ailleurs le rle assign par lui l'amour (le mme que dans d'autres dialogues il assigne la mathmatique !) semble caractristique cet gard. D'autre part, quand il dit, faisant l'loge de la (en grec dans le texte) issue des dieux, que Dionysos inspire la (en grec dans le texte) des mystres, cela semble indiquer des pratiques mystiques chez les initis. Du moins je ne vois pas d'autre interprtation possible. Car il ne s'agit certainement pas d'tats semi-dlirants ; il ne peut s'agir que d'extase. Je ne serais pas surprise que l'emploi actuel du mot mystique vnt des premiers auteurs chrtiens, dont certains, tout en polmiquant contre les mystres, aimaient reprsenter le christianisme comme le vrai mystre . propos des mystres, on ne peut pas faire de diffrence entre l'esprit d'Eschyle et celui des autres Grecs du fait qu'il tait initi leusis ; car tout le monde pratiquement (ceux qui comptaient) tait dans le mme cas. Platon fait citer par Socrate une formule des mystres. Que Platon et Pythagore se soient troitement inspirs des mystres, cela ne semble pas douteux. Hrodote, Sophocle taient aussi initis, etc. Il y a dans le Philbe une formule bien curieuse. C'est un prsent (il s'agit d'une route que Socrate va expliquer) des dieux aux hommes, ce qu'il me semble, qui est tomb de chez les dieux, grce quelque Promthe, en mme temps que quelque feu trs lumineux ; et les anciens (en grec dans le texte), valant mieux que nous et habitant plus prs des dieux, nous ont transmis cet oracle ; savoir que toutes les choses qu'on dit tre toujours sont composes de l'un et du multiple et ont la limite et l'illimit [comme proprits] inhrentes (en grec dans le texte). Il nous faut donc, puisque les choses sont ainsi ordonnes, poser une seule ide chaque fois pour toute investigation concernant un sujet quelconque ; on la trouvera, puisqu'elle y est ; quand nous l'aurons saisie, aprs une seule en examiner deux, s'il y en a deux, ou sinon trois ou tout autre nombre, et de mme pour chacune d'elles, jusqu' ce que cette chose qui tait d'abord une, on voie non seulement qu'elle est une et multiple et illimite, mais aussi quel est son nombre ; il ne faut pas expliquer la multitude l'ide de l'illimit
Simone Weil, Sur la science (1966) 178
avant d'avoir parfaitement vu le nombre intermdiaire entre l'illimit et l'un. (Ainsi le grave, l'aigu, les intervalles, etc. sont les notions intermdiaires entre le son et la varit illimite des sons.) Ce passage sonne pythagoricien (Philolas dit que tout est un tissu de limit et d'illimit), mais les anciens ne peuvent gure tre les pythagoriciens, vu qu'un sicle peine spare Platon de Pythagore. Ce prsent des dieux transmis par les anciens , il me semble que ce ne peut tre qu'une allusion l'orphisme. Ou aux gyptiens ? ( cause d' habitant plus prs des dieux ). Ou aux deux peut-tre. En tout cas il devait y avoir quelque chose dans les mystres sur l'un, le multiple et l'illimit. Je crois volontiers que pour beaucoup de sculpteurs et peintres il est indiffrent qu'ils aient telle ou telle conception du monde ; ce sont, je pense , ceux qui ne m'intressent pas. Mais il me parat difficile de soutenir que l'admiration de Giotto pour saint Franois n'a eu aucun rapport avec son art - ou, pour Lonard, les conceptions platoniciennes - ou, pour les cathdrales, le catholicisme (y compris les hrsies). Non que je croie que les artistes se dtournent des problmes qu'ils ont dans les yeux et les doigts pour se livrer des spculations abstraites (quoique cela puisse aussi se produire), mais je pense que les problmes qu'ils ont dans les yeux et les doigts dpendent de la conception qu'ils se font de la vie humaine et du monde. Ceci ne s'applique qu' ceux de tout premier ordre. D'une manire gnrale je pense que chez les hommes de tout premier ordre aucune espce d'activit n'est sans liens intimes avec toutes les autres. Bien entendu, l'tiquette qu'ils se laissent parfois coller en raison du temps et du milieu o ils vivent peut tre indiffrente ; une tiquette n'est pas une doctrine. Il est clair que le mystre du trs grand art, c'est que la doctrine de l'artiste passe dans ses mains. J'en dirais autant de la science. Mais il est peu de trs grands hommes (on peut diffrer aussi sur la classification) et pour tous les autres ce que tu dis est tout fait juste. Remarque, soit dit en passant, que la plupart des doctrines tant quivalentes en ce qu'elles ont d'essentiel, les diffrences de doctrine souvent n'existent pas l o on croit en voir. [...] l'ide de l'art comme d'une chose qui rend fou, ou qui convient aux fous, est une des pires impits qu'on puisse prononcer. .......................
Simone Weil, Sur la science (1966) 179
Sur la science [crits publis entre 1932 et 1942.] (1932-1942)
Extraits de lettres A. W.
(Marseille, 1941-1942) I
Retour la table des matires
[...] Figure-toi que ces jours-ci, en essayant de retrouver la mthode mcanique d'Archimde pour la quadrature de la parabole, j'ai trouv un autre procd que le sien, analogue, et qu'il aurait trs bien pu employer aussi ; il consiste employer, pour faire l'intgration, le volume de la pyramide au lieu du centre de gravit du triangle. Tu verras sans doute ce que je veux dire, si tu as prsent l'esprit le passage d'Archimde en question ; mais peu importe ! Voici o je voulais en arriver. Le centre de gravit du triangle n'est pas autre chose que le point de rencontre des mdianes. Ce point de rencontre, tout comme le volume de la pyramide, fournit le rapport
1 . De mme, le point de 3 1 rencontre des mdianes du paralllogramme fournit le rapport tout 2
comme la surface du triangle.
Simone Weil, Sur la science (1966) 180
Les thormes concernant les points de rencontre des mdianes du paralllogramme et du triangle doivent donc impliquer quelque chose qui corresponde aux intgrations par lesquelles on arrive respectivement aux formules
1 2 1 2 x et 3 x . Mais de quelle manire ? C'est ce que 2
je ne vois pas. Qu'est-ce que tu en penses ? Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Peux-tu me faire savoir si Neugebauer a publi de nouveaux ouvrages sur la mathmatique ou l'astronomie antique, depuis celui que j'ai eu entre les mains (et qui date, je crois, de 1934) ? ...................... II J'aurais eu bien besoin d'un physicien, ces jours-ci, pour lui poser la question suivante. Planck motive l'introduction des quanta d'nergie par l'assimilation de l'entropie une probabilit (exactement, le logarithme d'une probabilit), parce que, pour calculer la probabilit d'un tat macroscopique d'un systme, il faut supposer un nombre fini d'tats microscopiques correspondants (tats discrets). Le motif est donc que le calcul des probabilits est numrique. Mais qu'est-ce qui empchait de faire usage d'un calcul des probabilits continu, o le nombre gnralis remplacerait le nombre ? (Vu qu'il y a des jeux de hasard o la probabilit est continue.) On aurait vit les quanta. Qu'est-ce qui a empch de tenter cela ? Planck n'en dit rien. T. ne connat pas de physicien ici capable de m'clairer. Toi, que penses-tu de cela ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. III Ta rponse concernant Planck ne m'a pas satisfaite. D'abord, les raisons de Planck n'ont en effet qu'un intrt historique ; mais les raisons qu'on a aujourd'hui d'adopter la thorie des quanta n'ont galement qu'un intrt historique, car le moment prsent sera bientt de l'histoire.
Simone Weil, Sur la science (1966) 181
Deuximement, la question, mon sens, se pose ainsi. On a deux tats macroscopiques A et B, ; il y a un rapport entre leurs entropies respectives, entre leurs probabilits respectives en liant les deux notions, entre les quantits d'tats microscopiques correspondant chacun en interprtant ainsi la probabilit. Cette quantit, selon la mcanique classique, est infinie ; il faut donc trouver un rapport de grandeur dtermin entre deux infinis. Il existe de tels rapports ; ainsi entre deux segments, si on regarde chacun comme un ensemble de points. Dans une roulette foraine, l'aiguille peut s'arrter sur n'importe quel point du disque ; la quantit des cas possibles est infinie ; la probabilit que l'aiguille s'arrte sur du vert ou du rouge (par exemple) est proportionnelle aux longueurs des arcs ainsi colors. Pour appliquer la notion de probabilit continue, il faut trouver une certaine reprsentation de la relation entre tats microscopiques et macroscopiques, une image, une analogie, telle que les quantits infinies d'tats microscopiques correspondant un tat macroscopique aient entre elles des rapports finis mesurables par des nombres irrationnels. L'exprience, il me semble, ne peut pas fournir des mesures assez prcises pour exclure cette possibilit. (Cela me semble vident, puisque les nombres rationnels et irrationnels peuvent tre infiniment voisins.) J'ai lu un recueil de confrences de Planck dont l'une est intitule Gense de la thorie des quanta ; j'ai lu aussi la partie concernant les quanta de son manuel de physique en 4 volumes ; dans les deux il dit explicitement que c'est la probabilit qui exige le discontinu ; il ne fait aucune allusion la moindre tentative pour utiliser la probabilit en conservant la continuit. S'il avait fait une telle tentative et si elle avait chou, il me semble qu'il en aurait dit un mot. Si je suis parvenue rendre intelligible la question que j'ai dans l'esprit, j'aimerais que tu la poses un physicien. ...................... En ce qui concerne Stvin, j'avais dj tudi fond son Arithmtique en 1934 ou 1935, et j'ai quelque part un cahier tout plein de rsums et d'extraits du dit ouvrage ; je n'ai pas lu ses travaux de mcanique, mais j'ai vu l'expos de certaines de ses ides par Lagrange.
Simone Weil, Sur la science (1966) 182
...................... IV ...................... As-tu lu saint jean de la Croix ? C'est en ce moment ma principale occupation. On m'a donn aussi un texte sanscrit de la Gta, transcrit en lettres latines. Ce sont deux penses extraordinairement semblables. La mystique de tous les pays est identique. Je crois que Platon aussi doit y tre rang, et qu'il prenait les mathmatiques comme matire de contemplation mystique. .....................
Simone Weil, Sur la science (1966) 183
Sur la science [crits publis entre 1932 et 1942.]
FRAGMENTS (Sciences)
Rverie propos de la science grecque 34
Retour la table des matires
Les hommes ont forg bien des savoirs diffrents pour atteindre l'univers qui nous entoure. La science europenne du XXe sicle n'est pas celle d'avant 1900 ; la science grecque est encore autre chose ; la magie, les techniques, l'alchimie, l'astrologie, tout cela, ce sont des savoirs dont on peut chercher dterminer la valeur, auxquels on peut trouver une valeur plus ou moins grande, condition d'appliquer un critrium, mais dont aucun n'est sans valeur, car chacun correspond un certain rapport entre l'homme et ses propres conditions d'existence. Chacun, d'ailleurs, est mystrieux, impntrable du dehors, la science dite profane aussi bien que les connaissances dites occultes. Que peuton dire de srieux, du dehors, concernant un de ces savoirs ? Il est bon cependant d'essayer de les deviner.
34 Voir La Science et nous, pp. 134 et suivantes.
Simone Weil, Sur la science (1966) 184
Chacun d'eux a pour objet, pour modle et pour principe, le rapport entre une aspiration de la pense humaine et les conditions effectives de sa ralisation, rapport d'aprs lequel on reconstruit tout l'univers en essayant de le lire travers les apparences. Par exemple la magie et la science europennes d'aprs la Renaissance ont en commun le choix de l'aspiration ; il s'agit de l'aspiration au pouvoir sur la matire pour la ralisation de n'importe quel dsir. Mais la magie considre comme conditions des rites et des signes, lesquels sont en effet des conditions pour la russite de toute action humaine, quoique variables selon les socits ; la science occidentale classique considre comme conditions des ncessits analogues celles qu'un effort d'attention fait apparatre clairement dans le travail le plus simple, le travail du manuvre. La science du XXe sicle considre comme condition l'usage de formules algbriques qui traduisent approximativement les rapports de quantits observs dans des expriences de laboratoire conues, interprtes et corriges d'aprs des hypothses qui ont pour fin la construction de telles formules. Un savoir tel que l'alchimie s'oppose galement la magie et la science occidentale par l'aspiration laquelle il semble avoir gard ; d'aprs les textes des alchimistes, il s'agissait de pouvoirs sur la matire lis une transformation intrieure dans le sens de la sagesse et de la plus haute vertu, analogues par suite aux pouvoirs particuliers que possde, par exemple, un trs grand peintre sur les couleurs et les pinceaux qu'il manipule. Par la nature des choses, les conditions du succs sont mystrieuses, car l o il y a marche vers le bien il peut et doit y avoir une mthode, mais, comme l'exemple de l'art le fait clairement apparatre, il ne peut y avoir de recettes. Autant il peut y avoir de semblables rapports susceptibles d'tre conus par l'homme entre une aspiration et des conditions d'accomplissement, autant il peut y avoir d'espces diffrentes de savoirs, et la valeur de chacun est la valeur du rapport qui lui sert de principe, exactement, ni plus ni moins. Parmi toutes les formes diffrentes de la connaissance du monde, la science grecque, si merveilleusement claire, est pour nous une nigme. En un sens, elle est le commencement de la science positive ; premire vue la destruction de la Grce par la guerre semble avoir dtermin seulement une interruption de dix-sept sicles, non un changement d'orientation. Toute la science classique - si l'on convient de nommer ainsi la science occidentale des XVIe, XVIIe, XVIIIe et
Simone Weil, Sur la science (1966) 185
XIXe sicles - est dj contenue dans les ouvrages grecs, non seulement en germe, mais bien plus qu'en germe. La thorie du nombre gnralis labore par Weierstrass la fin du XIXe sicle est identique celle que conut Eudoxe, ami de Platon, lve d'un des derniers pythagoriciens authentiques, et que nous trouvons dans Euclide ; il dfinit avec toute la rigueur et la clart qu'une me humaine peut dsirer la possibilit d'appliquer les oprations arithmtiques aux quantits non assimilables des nombres, telles que les longueurs. Le mme Eudoxe inventa, dit-on, le calcul intgral, et sa dfinition de la notion de limite qui en fait le centre, dfinition qui nous a t transmise par Archimde et reste connue sous le nom d'axiome d'Archimde, n'a jamais t dpasse en prcision et en rigueur. Il conut aussi, pouss par Platon, une combinaison de mouvements circulaires et uniformes qui rendait parfaitement compte de tous les faits concernant les astres connus son poque. La conception de plusieurs mouvements simples et dfinis se composant pour dterminer la trajectoire d'un mobile est la base de notre mcanique ; c'est elle qui rend possible la traduction des mouvements en formules algbriques. La seule diffrence entre Eudoxe et la mcanique classique est que celle-ci part de mouvements droits, soit uniformes, soit acclrs ; cela seul, au fond, spare l'astronomie d'Eudoxe de celle de Newton, car, quoique Newton ait beaucoup parl de force d'attraction, la gravitation n'est pas autre chose qu'un mouvement uniformment acclr dans la direction du soleil. L'absence d'algbre dans la science grecque ne doit pas nous faire croire l'ignorance de ce qui, pour nous, est l'instrument par excellence de la recherche scientifique ; on peut difficilement supposer que les Grecs aient ignor l'algbre enseigne il y a quatre mille ans aux coliers babyloniens et qui comportait la solution d'quations numriques du deuxime, quatrime et mme troisime degr. Qu'on substitue dans cette algbre le nombre gnralis au nombre arithmtique et la notion de fonction celle d'quation, et l'on obtient notre algbre. Les Grecs possdaient, maniaient et appliquaient les notions de nombre gnralis et de fonction, mais ils n'ont jamais voulu les exprimer sous forme d'quations ; ils n'ont pas admis pour les relations algbriques d'autres symboles que les figures de la gomtrie. Il faut trs probablement voir l un parti pris li leur conception gnrale de la science.
Simone Weil, Sur la science (1966) 186
Leur part dans l'laboration de notre science ne se limite pas, il s'en faut, la mathmatique et l'astronomie. Archimde fonda la mcanique par sa thorie purement mathmatique de la balance, du levier, du centre de gravit ; cette thorie et celle des mouvements combins dEudoxe il reste seulement ajouter, pour obtenir notre mcanique, la notion de mouvement droit uniforme accompli par inertie et celle de mouvement uniformment acclr, aperues toutes deux par Galile, la notion de travail, dfinie par Descartes propos des machines simples, la notion d'nergie, issue d'un rapprochement entre les trois prcdentes. Mais si Lagrange, continuant et couronnant les efforts des Bernoulli, de d'Alembert et de plusieurs autres, donna la mcanique classique son unit, ce fut en ramenant autant que possible la dynamique la statique et en dfinissant la cohsion d'un systme de corps ou de points matriels en mouvement comme un quilibre identique celui du levier. La thorie purement mathmatique de l'quilibre des corps flottants, conue par Archimde, et qui revient considrer les fluides comme un ensemble de leviers superposs o un axe de symtrie jouerait le rle de point d'appui, contient en puissance toute la physique classique ; celle-ci n'est pas autre chose qu'un effort pour concevoir toutes choses dans la nature comme des systmes de leviers, ainsi qu'Archimde avait fait pour l'eau. Il est malheureux que dans l'enseignement ces conceptions merveilleuses d'Archimde soient abaisses jusqu' paratre des observations banales et sans intrt. Quant la biologie, les Grecs avaient conu la vie et la sant de l'tre vivant comme un quilibre, d'une part entre les parties, les organes, les fonctions dont se compose le corps, d'autre part entre le corps et le milieu ; il est singulier qu'on trouve dans Aristote des allusions des thories concernant l'analogie entre la slection pratique par les leveurs et l'limination naturelle des organismes non conformes aux conditions d'existence imposes par le milieu, ce qui est la conception essentielle de Darwin. Enfin Hippocrate a dfini la mthode exprimentale aussi bien qu'on l'a jamais fait par la suite. Mais si la science grecque est dj la science classique, elle est aussi, en mme temps, tout autre chose. La fameuse formule de Platon, Nul n'entre ici s'il n'est gomtre , suffit le montrer. Ce qu'on venait chercher quand on allait chez Platon, c'tait une transformation de l'me permettant de voir et d'aimer Dieu ; qui songerait aujourd'hui employer la mathmatique un tel usage ? En Europe, depuis l're
Simone Weil, Sur la science (1966) 187
chrtienne, la priode par excellence o l'on a cherch Dieu, et que nous nommons le Moyen ge, s'est termine quand on a rnov l'tude de la mathmatique ; et Pascal, sur le point de trouver la forme algbrique du calcul intgral, a abandonn l'algbre et la gomtrie par dsir d'un contact avec Dieu. Nous ne pouvons imaginer aujourd'hui qu'un mme homme soit un savant et un mystique, sinon des priodes diffrentes de sa vie. Si un savant a quelque inclination pour l'art ou pour la religion, ces inclinations sont spares en lui de son occupation principale par une cloison tanche, et, s'il essaie d'oprer un rapprochement, c'est, comme le montre plus d'un exemple, par des lieux communs vagues et d'une banalit significative. De mme, au cours des trois derniers sicles, les hommes qui se sont vous l'art ou la religion n'ont pas song s'intresser la science, et si Gthe semble faire exception, il avait de la science une conception qui lui tait propre. Le plus singulier est que, si nous considrons sparment les conceptions scientifiques, artistiques, religieuses de l'Occident depuis la Renaissance, la Grce apparat chaque fois comme la source et le modle. Mais les ressemblances nous trompent, puisque la science, l'art, la recherche de Dieu, unis chez les Grecs, sont spars chez nous. Keats hassait Newton ; quel pote grec aurait ha Eudoxe ? Si l'on examine de prs la science grecque, on y trouve des notions rsonances multiples et significations mouvantes. Il en est ainsi de la (Ici s'arrte le manuscrit.)
Simone Weil, Sur la science (1966) 188
propos de la mcanique ondulatoire
Retour la table des matires
La mcanique ondulatoire, les travaux de de Broglie et autres, ont conquis l'attention du public non par leur valeur scientifique, car il ne cherche gure l'apprcier, mais par leur caractre rvolutionnaire par le bouleversement qu'ils semblent apporter dans les notions communes. Des savants probes, comme de Broglie lui-mme, acceptent la mcanique ondulatoire cause de la cohrence, de l'harmonie qu'elle apporte dans les donnes exprimentales de la science contemporaine, et malgr les transformations surprenantes qu'elle implique quant aux notions de causalit, de temps, d'espace ; mais le public, c'est cause de ces transformations qu'il l'accueille avec faveur. On a pu voir semblable chose dj lors de la grande vogue d'Einstein. Le public boit, absorbe avidement tout ce qui tend dpossder l'intelligence au profit d'une technique ; il a hte d'abdiquer l'intelligence, la raison, d'abdiquer tout ce qui rend l'homme responsable de son destin. Non pas, bien entendu, que la technique mathmatique, fondement de la mcanique ondulatoire comme de la relativit, puisse se passer d'intelligence ; aucune technique d'ailleurs, ne le peut ; mais il s'agit d'une intelligence si singulire, qui colle si troitement la technique ellemme, qu'elle semble sans parent avec cette autre intelligence commune tous qui a paru si longtemps seul juge des notions fondamentales. A lui voir apparemment perdre ce privilge, des hommes qui ne possdent qu'elle expriment un plaisir, un soulagement qui ne fait gure honneur leur courage ; ils ne demandent, il faut le croire, qu' laisser leur destin, leur vie et toutes leurs penses aux mains de quelques-uns, dous pour l'usage exclusif de telle ou telle technique. Chercher dans quelle mesure on peut peut-tre traduire en termes de bon sens les paradoxes des thories nouvelles, ce n'est pas en servir la publicit ; mais la science n'est pas encore asservie la publicit.
Simone Weil, Sur la science (1966) 189
L'on se trompe sans doute en croyant qu'il se trouve, dans ces parties si tranges de la science moderne, des secrets connus des seuls initis. Les notions d'espace, de temps, de cause, sont les mmes pour le physicien le plus minent que pour un paysan illettr ; tout ce que le physicien possde en plus, c'est la connaissance prcise des cas o ces notions communes sont impuissantes organiser en un systme cohrent l'ensemble des donnes exprimentales accompagnes de leurs interprtations les plus simples. Si, ce moment, le physicien choisit de formuler des suppositions, des lois, des images incompatibles avec les notions communes tous, il ne s'loignera pas seulement du paysan, il s'loignera d'abord de lui-mme, de tout ce qui, en luimme, ressemble au paysan.
Fragment
Retour la table des matires
De tout temps sans doute, l'occasion du jeu et par l'preuve du travail, les hommes ont form la notion de la matire inerte, qui bouge seulement si on la pousse. La notion de l'immobilit est une notion dfinie. En revanche la notion de mouvement n'est pas dfinie, parce qu'en mme temps que le changement de position le temps y intervient. toute poque peut-tre, et en tout cas ds l'poque grecque, le mouvement uniforme est apparu comme la forme de mouvement qui se dfinit et dfinit les autres, ainsi que la droite se dfinit et dfinit les autres lignes ; et les Grecs l'ont attribu aux astres, parce qu'ils sont parfaits et soustraits aux hasards. Ils n'avaient pas d'autre raison ; on ne peut pas en avoir d'autre ; car comment mesurer le mouvement sans mesurer le temps, et comment mesurer le temps ? L'hypothse du mouvement uniforme rend compte de la rgularit dans les apparences clestes, mais on pourrait en rendre compte aussi en attribuant la sphre cleste, au soleil, la lune, aux plantes des mouvements varis, si on les fait varier convenablement. C'est d'ailleurs ce que nous faisons aujourd'hui, except pour la sphre cleste, puisque nous attribuons aux astres une acclration ; mais non pas au mouvement de rotation de la terre ; et pourquoi pas ce mouvement aussi, sinon
Simone Weil, Sur la science (1966) 190
parce que nous conservons l'gard des toiles fixes qui nous partagent nos journes la mme pit que les Grecs ? Un mouvement uniforme, cela a toujours signifi, cela signifie encore aujourd'hui, un mouvement, qui a un rapport constant avec celui des toiles fixes. Il ne peut en tre autrement. Les choses autour de nous ne se meuvent gure que pousses ; les animaux, qui font exception, nous semblent se mouvoir par des caprices ou des besoins semblables aux ntres ; le vent, qui dans son mouvement irrgulier, souvent soudain et violent, parat toujours poussant et non pouss, auquel l'Iliade compare sans cesse l'lan de la victoire, ne nous est connu que par les choses qu'il pousse. Les astres ne poussent pas, ne sont pas pousss, ne sont pas arrts, ne se heurtent rien ; nos yeux ils paraissent procder sans impulsion ni rsistance ; en les voyant lentement s'incliner autour du ple, comment ne pas penser leur occasion un mouvement sans impulsion ni rsistance, et par suite un mouvement uniforme ? Mais la conception grecque du mouvement circulaire et uniforme comme mouvement parfait, soustrait aux actions extrieures, ne permettait absolument pas de dfinir les mouvements qui se produisent sur terre, autour de nous. Pour dfinir ces mouvements, Galile eut la hardiesse d'inventer un point de dpart en ngligeant un fait d'exprience universel, savoir qu'except les astres toutes les choses en mouvement finissent un moment quelconque par s'arrter. L'habitude nous fait croire aujourd'hui que le principe d'inertie est vident, et l'on s'tonne parfois navement que l'Antiquit et le Moyen ge ne l'aient pas reconnu ; mais loin d'tre une vidence, c'est un paradoxe. Les mouvements des astres, qui sont d'ailleurs trop lents pour nous apparatre comme des mouvements, et que nous n'avons pour cette raison aucune peine penser comme circulaires, sont les seuls qui ne s'arrtent jamais ; les mouvements accomplis par nous, provoqus par nous, ou que nous voyons se produire autour de nous, et qui sont toujours accompagns dans notre pense de la notion de direction, c'est--dire de droite, s'achvent toujours quelque moment. Plus brivement, les mouvements circulaires des astres durent indfiniment, les mouvements rectilignes ont une dure finie. Cette opposition est confirme par l'exprience continuelle et sculaire des hommes. N'est-ce pas ds lors un paradoxe trs audacieux d'affirmer que le mouvement parfait, soustrait aux actions extrieures, indfiniment durable, est un mouvement uni-
Simone Weil, Sur la science (1966) 191
forme rectiligne ? Ce qui est vident, c'est que ce paradoxe est indispensable pour dfinir les mouvements qui intressent notre vie terrestre. Nanmoins Galile n'aurait pu imaginer un mouvement uniforme rectiligne en dplaant des morceaux de rocher sur une lande ou des armoires dans une chambre, car ces choses s'arrtent ds qu'on cesse de faire effort ; il l'imagine en imprimant une lgre impulsion une bille place sur une surface horizontale polie, et en choisissant de ngliger d'abord le fait que la bille finit par s'arrter, puis le fait qu'elle roule et ne glisse pas. Ensuite Galile inventa le mouvement uniformment acclr, en calcula la loi par une intgration, et, abandonnant une bille sur des plans diversement inclins, retrouva quelque chose prs cette loi dans l'exprience, ainsi qu'un rapport entre l'acclration et l'inclinaison du plan.
Du fondement d'une science nouvelle
Retour la table des matires
La limite est la loi du monde manifest. Dieu seul (ou quelque nom qu'on veuille employer) est sans limites. (Sous un autre aspect, la relation est la loi du monde manifest, Dieu seul est sans relation.) L'homme qui est du monde et tient de Dieu, met l'illimit et l'absolu dans le monde, o ils sont erreur ; cette erreur est souffrance et pch, et les tres, mme les plus ignorants, sont dchirs par cette contradiction. Le dsir est illimit dans son objet, et limit en son principe, ainsi que toute activit procdant du dsir, par la fatigue qui le condamne mort d'avance. La terreur met un absolu dans quelque chose d'extrieur et porte un tre humain nier sa propre existence (nihil sum, perii, disent les esclaves de Plaute). La dlivrance est de lire la limite et la relation dans toutes les apparences sensibles, sans exception, aussi clairement et immdiatement qu'un sens dans un texte imprim. La signification d'une science vritable est de constituer une prparation la dlivrance.
Simone Weil, Sur la science (1966) 192
L'quilibre, en tant que l'quilibre dfinit des limites, est la notion essentielle de la science ; par cette notion tout changement, donc tout phnomne, est considr comme une rupture d'quilibre, li tous les autres changements par la compensation des ruptures d'quilibre successives, compensation qui fait de tous les dsquilibres une image de l'quilibre, de tous les changements une image de l'immobilit, du temps une image de l'ternit. L'injustice dans un homme tant la mconnaissance des limites, ces ruptures d'quilibre qui se succdent et se compensent constituent l'image d'une succession d'injustices et d'expiations elles-mmes injustes qui se compensent par un balancement indfini ; ce qu'exprime la formule d'Anaximandre : c'est partir de cela que se fait la production des choses, et leur destruction est un retour cela, conforme la ncessit ; car les choses subissent un chtiment et une expiation les unes de la part des autres cause de leurs injustices selon l'ordre du temps . Pour apercevoir une image de l'quilibre dans la succession indfinie des ruptures d'quilibre, il faudrait embrasser la totalit de l'univers et du temps, ce qui n'est pas donn l'homme dont la pense en tant qu'elle se rapporte des objets est limite. L'homme serait incapable de penser concrtement l'quilibre et par suite la limite et par suite l'illimit, et par suite d'une manire gnrale de penser s'il ne lui tait donn des images de l'quilibre son chelle. Cela est non une ncessit, mais une grce ; une grce qui se confond avec celle par laquelle l'homme existe. son chelle s'entend en deux sens. Non plus grand que ce qu'il peut embrasser, non plus petit que ce qu'il peut discerner. Si, par l'accumulation des faits d'exprience et la perfection croissante des instruments quant la distance et quant la petitesse, il sort de ce qui est naturellement son chelle, il peut fort bien tomber dans une complication de faits o il ne puisse discerner aucune ncessit, parce qu'il faudrait pour discerner une ncessit ou embrasser moins ou embrasser beaucoup plus. Or il ne peut embrasser beaucoup plus, d'abord parce que la technique, bien que susceptible de progrs, ne peut pas atteindre n'importe quel degr de puissance, puis parce que les limites de sa
Simone Weil, Sur la science (1966) 193
capacit mentale restent les mmes alors que la technique progresse et que les faits s'accumulent. Il faut qu'il se contente d'embrasser moins. Plus gnralement, alors que l'homme, quelque usage qu'il fasse de l'algbre et des instruments, ne peut jamais se passer pour la science de son intelligence et de son corps, choses limites et dont les limites ne changent pas au cours des sicles, il est absurde de croire la science susceptible de progrs illimit. Elle est limite, comme toutes choses humaines, hors ce qui, dans l'homme, s'assimile Dieu ; et il est bon qu'elle soit limite, car elle est, non une fin laquelle beaucoup d'hommes devraient se donner, mais un moyen pour chaque homme. Le temps est venu de chercher non l'tendre, mais la penser. On peut nommer microcosmes ou vases clos, ces portions d'univers, limites dans l'espace et le temps, o, quelque chose prs - ici s'introduit la notion capitale de la physique, celle de ngligeable - il est possible de trouver une image de l'quilibre. Puisqu'on y nglige quelque chose - et ce quelque chose n'est jamais un infiniment petit, mais est de la dimension de l'univers, car c'est avant tout la prsence de tout l'univers autour - ce ne sont pas des choses qui existent, mais des abstractions, plus relles pourtant que les apparences sensibles qui nous sont donnes. La plus simple, le symbole de toutes les autres est la balance, qui de ce fait peut tre prise comme symbole la fois de la connaissance du monde et de la justice. Quelque partie, quelque aspect de la nature ou de la vie humaine qu'on tudie, on a compris quelque chose quand on a dfini un quilibre, des limites par rapport cet quilibre, des rapports de compensation liant les ruptures d'quilibre successives. Il en est ainsi aussi pour l'tude de la vie sociale ou de l'me humaine, tudes qui par l seulement sont des sciences. Des ruptures d'quilibre qui se compensent constituent quelque chose comme des transformations cycliques ; des rapports fixes, drivs de l'quilibre l'gard duquel ces ruptures sont dfinies, dominent ces successions et ces compensations ; ainsi les notions mathmatiques assez rcentes de groupe et d'invariant sont, avec celle d'ensemble, le centre mme de la science. Ces trois notions, si on en fait bon usage, sont partout applicables.
Simone Weil, Sur la science (1966) 194
Par la limitation mme de l'esprit humain, la science se divise en domaines. Un corps humain est de la matire pesante, de la matire claire opaque la lumire, de la matire vivante, de la matire jointe par un lien mystrieux une pense, et ainsi participe diffrents quilibres. La division en domaines est, dans une certaine mesure, donne l'homme. La pense individuelle, la vie sociale, la matire vivante animale et vgtale, la matire non vivante, ce sont des divisions qu'il ne dpend de personne d'abolir. Dans la matire non vivante, les astres sont spars de tout le reste ; dans la nature qui nous entoure, les sens qui nous sont donns imposent les premires divisions, et si une tude plus pousse en fait apparatre d'autres, jamais les divisions de la physique en branches spares ne perdent tout rapport avec les sens humains. La dlimitation d'un domaine et la dfinition d'un quilibre sont rciproquement conditions l'une de l'autre, ce qui fait de l'laboration de la science un travail analogue celui de l'artiste. La limite, qui implique la notion d'quilibre, est la premire loi du monde manifest ; la hirarchie est la seconde. La notion de valeur est insparable de la pense humaine, et n'a pas tre juge, car elle se pose elle-mme ; on peut seulement examiner si, et quoi, elle s'applique. Les jugements de valeur sont toujours intuitifs et n'admettent pas de preuve ; la raison discursive n'intervient que pour les dfinir et les mettre en ordre de manire qu'aucune contradiction n'empche qu'ils se rapportent tous une seule et mme valeur. La connaissance de notre imperfection en tant qu'tres pensants est la connaissance la plus immdiate ; elle est commune tous les hommes et continuellement prsente, sinon peut-tre dans le sommeil et le rve ; elle est insparable de la conscience, mme en ses degrs infrieurs, et de l'effort ; elle implique un rapport une perfection, une valeur suprme qui par suite apparat l'homme ngativement et par rapport la pense. Par l, la pense humaine participe la valeur, et les conditions de la pense y participent aussi en tant que telles. On peut cet gard les classer selon une hirarchie. Parmi les formes de la matire, la matire vivante organise de manire constituer un corps humain, la matire vivante animale, la matire vivante vgtale, l'nergie rayonnante comme condition des transformations chimiques qui font surgir la matire vivante, l'nergie mcanique, l'nergie calorifique se trou-
Simone Weil, Sur la science (1966) 195
vent ranges dans cette numration selon une hirarchie. L'homme peut et doit concevoir la possibilit de hirarchies de valeur non relatives la pense humaine, mais il ne peut pas concevoir ces hirarchies. Toutes les choses faites de matire se transforment continuellement les unes dans les autres, et l'quilibre consiste en ce que les transformations qui s'oprent dans tel sens sont compenses par celles qui s'oprent en sens contraire. Il y aurait une infinit de manires de classer les sens des transformations, mais si on les rapporte une hirarchie de valeur il en apparat trois espces, celles qui se font de l'infrieur au suprieur, celles qui se font du suprieur l'infrieur, celles qui se font sans changement de niveau. Cette classification vaut pour tous les changements d'ailleurs et non pas seulement pour la matire. On peut faire correspondre par abstraction aux changements ainsi rpartis trois tendances ; ce sont les gunas de l'Inde, de mme que la notion hindoue du dharma n'est pas autre chose que la notion d'quilibre. On peut dire que tout phnomne tend la fois s'tendre, se dgrader, s'lever. Le difficile est de dfinir ces termes par rapport aux diffrentes espces de phnomnes. Aux deux premires tendances correspondent, en ce qui concerne la matire non vivante, les deux principes qui dominent la science du XIXe sicle et encore celle d'aujourd'hui, la conservation et la dgradation de l'nergie. jusqu'ici, la science n'a pas formul un troisime principe, mais il est clair qu'il en faut un troisime qui balance la dgradation de l'nergie, car autrement l'entropie maximum serait dj atteinte partout et tout serait immobile et mort. D'autre part, la transformation de la matire non organique en matire organique est le contraire d'une dgradation, et cette transformation s'accomplit continuellement. La spcialisation empche qu'on en tienne compte en physique ; pourtant il y a quelque chose dans la matire non vivante qui fait qu'elle peut tre transforme en matire vivante. De mme, il y a quelque chose dans la matire qui constitue un corps humain qui fait qu'elle peut tre transforme de manire que le comportement physique corresponde l'aspiration de la pense vers le bien. La tendance de tout phnomne s'tendre est implique par la continuit du changement ; en abolissant cette tendance par la pense
Simone Weil, Sur la science (1966) 196
on se reprsente l'arrt instantan de toutes choses. Galile, considrant le mouvement droit uniforme comme le phnomne fondamental, l'a exprime par le principe d'inertie. Tout mouvement droit - c'est-dire tout mouvement - tend se prolonger sans fin la mme vitesse. Ce principe enferme une expansion illimite, et en mme temps une limite, la constance de la vitesse. Mais en un sens l'inertie, impliquant pour tout mouvement une continuation sans fin dans l'espace et dans le temps, implique de l'illimit dans l'espace et dans le temps. La notion d'nergie mcanique implique de l'illimit dans le temps, non dans l'espace. Tout systme clos de corps et de forces mcaniques implique un cycle de mouvements indfiniment recommencs ; car l'acclration qui correspond aux forces accrot la vitesse, donc l'nergie cintique, et diminue l'nergie potentielle jusqu'au moment o elle est nulle, moment o, par l'effet de l'inertie, tout recommence en sens inverse. Il en est ainsi du systme form par la terre et une balle parfaitement lastique lche d'une certaine hauteur. La dgradation de l'nergie apporte une limite dans le temps. Quand, dans un systme clos, le mouvement s'est chang en chaleur et qu'une temprature uniforme s'est tablie, plus rien ne peut se produire.
Du fondement d'une science nouvelle
Variante
Retour la table des matires
...(La balance 35 de ce fait peut tre prise comme symbole la fois de la ncessit et de la justice. Quelque partie, quelque aspect de la nature ou de la vie humaine qu'on tudie, on a compris quelque chose quand on a dfini un quilibre ; des limites par rapport cet quilibre, des rapports de compensation liant les ruptures d'quilibre successives. Il en est ainsi aussi pour
35 Voir la dernire ligne de la p. 277.
Simone Weil, Sur la science (1966) 197
l'tude de la vie sociale ou de l'me humaine, tudes qui par l seulement sont des sciences. Des ruptures d'quilibre qui se compensent constituent quelque chose comme des transformations cycliques, des rapports fixes drivs de l'quilibre l'gard duquel ces ruptures sont dfinies dominent ces successions et ces compensations ; ainsi les notions mathmatiques assez rcentes de groupe et d'invariant sont, avec celles d'ensemble, le centre mme de la science. Ces trois notions, si l'on en fait bon usage, sont partout applicables. La notion d'ensemble concerne le rapport de tout partie dans sa plus grande gnralit, rapport qui rpond au caractre limit de la pense humaine. Le tout considr, quel qu'il soit, est toujours limit certains gards, mme s'il contient une infinit, et quel que soit l'ordre de cette infinit. Quoique embrass comme tout d'un seul acte de la pense, il doit tre parcouru dans le temps, ce qui implique une division en parties, discrtes ou continues. La division de l'univers en domaines est pour une part donne l'homme, d'une manire en un sens immdiate, et avec des coupures irrductibles. Ainsi la division entre l'intrieur et l'extrieur, les penses et les choses sensibles. Parmi les choses sensibles les cinq sens fournissent des divisions irrductibles. La distinction entre hommes, choses vivantes, choses inertes en fournit d'autres. Au cours de l'investigation du monde, d'autres divisions se prsentent la pense. On peut vouloir substituer les divisions trouves aux divisions donnes, mais on n'y parvient jamais compltement, et celles qui sont trouves ne sont jamais sans rapport avec celles qui sont donnes. Toute recherche d'un quilibre implique un domaine par rapport auquel cet quilibre a un sens ; rciproquement, un domaine n'est dfini que par une structure ; il y a l une espce de cercle vicieux qui fait de l'investigation scientifique quelque chose d'analogue la cration artistique. La limite implique en contrepartie une tendance franchir toute limite, sans quoi tout s'arrterait et les limites ne seraient limites de rien. La continuit du changement implique que les choses tendent sans cesse dpasser leurs limites 36 , et c'est en ce sens qu'elles sont injustes , comme le dit Anaximandre. Cette tendance des phno36 La nature est compose d'illimit et de limites (Philolaos). Note de S. W.)
Simone Weil, Sur la science (1966) 198
mnes l'expansion, c'est ce que Galile, considrant le mouvement droit comme le phnomne fondamental, a exprim par le principe d'inertie. Si on admet le vide, cette tendance ne comporte en ellemme aucune limite (sinon que l'uniformit de la vitesse est une limite un certain gard), et c'est pourquoi il faut la combiner avec la notion de force, qui, elle, comporte une limite. Car la force telle que nous la concevons s'exerce de manire se supprimer. L'attraction se supprime en supprimant la distance, l'lasticit par la distension, etc. Ce qui produirait l'arrt de toutes choses sans l'inertie ; l'inertie, combine avec la force, produit des cycles, et l'invariant correspondant est exprim par le principe de la conservation de l'nergie. Tel est le systme compos d'une balle parfaitement lastique soumise la pesanteur et lche d'une certaine hauteur au-dessus d'une surface parfaitement dure, lisse et horizontale. Ces cycles se reproduisent indfiniment. (Ce cycle o la vitesse varie de zro un maximum est la base de notre mcanique et nous y rduisons mme les astres, au lieu que les Grecs avaient la base de la leur le mouvement circulaire uniforme.) La limite produit ici seulement un aller et retour de contraire contraire par accroissement et diminution de quantit. Une autre conception de la limite correspond un changement de nature.
Fin du texte
Você também pode gostar
- Méditations métaphysiques de René Descartes: Les Fiches de lecture d'UniversalisNo EverandMéditations métaphysiques de René Descartes: Les Fiches de lecture d'UniversalisAinda não há avaliações
- Le Temps N'est Pas Un Produit de L'âme: Proclus Contre PlotinDocumento11 páginasLe Temps N'est Pas Un Produit de L'âme: Proclus Contre PlotindoppiapresaAinda não há avaliações
- Hoffmann - Temps Et Éternité Dans Le Livre XI Des Confessions - Augustin Plotin Porphyre Et Saint PaulDocumento50 páginasHoffmann - Temps Et Éternité Dans Le Livre XI Des Confessions - Augustin Plotin Porphyre Et Saint PaulAri CostamagnaAinda não há avaliações
- Gabellieri Ontologie de L'image Et Phénoménologie de La VéritéDocumento45 páginasGabellieri Ontologie de L'image Et Phénoménologie de La VéritéphgagnonAinda não há avaliações
- Simondon Et PatockaDocumento14 páginasSimondon Et PatockavolentriangleAinda não há avaliações
- Vetö M. - Le Fondement Selon Schelling. Une Interprétation Partielle (1972)Documento12 páginasVetö M. - Le Fondement Selon Schelling. Une Interprétation Partielle (1972)annipAinda não há avaliações
- La Destination de l'homme de Johann Gottlieb Fichte: Les Fiches de lecture d'UniversalisNo EverandLa Destination de l'homme de Johann Gottlieb Fichte: Les Fiches de lecture d'UniversalisAinda não há avaliações
- Traite de Saint Bernard Des Degres de L-Humilite Et de L-Orgueil Charpentier Vives 1866Documento93 páginasTraite de Saint Bernard Des Degres de L-Humilite Et de L-Orgueil Charpentier Vives 1866Anonymous keinfV9cG6Ainda não há avaliações
- Principes de la philosophie morale: ou Essai sur le mérite et la vertuNo EverandPrincipes de la philosophie morale: ou Essai sur le mérite et la vertuAinda não há avaliações
- Heinzer, Felix Schonborn, Cristoph (Eds) Actes Du Symposium Fribourg, 1980Documento220 páginasHeinzer, Felix Schonborn, Cristoph (Eds) Actes Du Symposium Fribourg, 1980mementomeiAinda não há avaliações
- Yan Thomas ChoseDocumento33 páginasYan Thomas ChoseaugustobianchiAinda não há avaliações
- Simondon - Le Temps, Père de Toutes Choses . Chronos - Kronos PDFDocumento11 páginasSimondon - Le Temps, Père de Toutes Choses . Chronos - Kronos PDFTiago da Costa GuterresAinda não há avaliações
- Le Prince de la Concorde: La vie lumineuse de Jean Pic de la MirandoleNo EverandLe Prince de la Concorde: La vie lumineuse de Jean Pic de la MirandoleAinda não há avaliações
- Marie-Dominique Philippe, philosophe de la personne humaineNo EverandMarie-Dominique Philippe, philosophe de la personne humaineAinda não há avaliações
- Porro La Causalité Et Son Histoire. Une Bibliographie 2002Documento30 páginasPorro La Causalité Et Son Histoire. Une Bibliographie 2002Federico OrsiniAinda não há avaliações
- Gilson-Sens Et Interprétation de L'argument D'anselme-1934-0Documento54 páginasGilson-Sens Et Interprétation de L'argument D'anselme-1934-0cruzverde10100% (1)
- Libera 117 2019Documento17 páginasLibera 117 2019habbadiAinda não há avaliações
- VicoDocumento96 páginasVicopippiAinda não há avaliações
- Une Biopolitique Mineure Entretien Avec Giorgio AgambenDocumento10 páginasUne Biopolitique Mineure Entretien Avec Giorgio AgambenJackAinda não há avaliações
- Droit Et Démocratie Chez John Rawls Et Jürgen HabermasDocumento23 páginasDroit Et Démocratie Chez John Rawls Et Jürgen HabermascentrereAinda não há avaliações
- L'hénologie Comme Dépassement de La MétaphysiqueDocumento21 páginasL'hénologie Comme Dépassement de La Métaphysiquem54237Ainda não há avaliações
- De l'âme d'Aristote: Les Fiches de lecture d'UniversalisNo EverandDe l'âme d'Aristote: Les Fiches de lecture d'UniversalisAinda não há avaliações
- Histoire Des Sciences - de Saint Augustin A Galilee - Tome1Documento170 páginasHistoire Des Sciences - de Saint Augustin A Galilee - Tome1Anonymous 59RRzvAinda não há avaliações
- Élie Halévy, La Formation Du Radicalisme Philosophique - Tome IIDocumento309 páginasÉlie Halévy, La Formation Du Radicalisme Philosophique - Tome IIDwebeyAinda não há avaliações
- Le de Ente Et Essentia de S. Thomas D'aquin - M-D Roland-Gosselin, OPDocumento264 páginasLe de Ente Et Essentia de S. Thomas D'aquin - M-D Roland-Gosselin, OPLucas Lagasse50% (2)
- Alain - Le Culte de La Raison Comme Fondement (1901)Documento11 páginasAlain - Le Culte de La Raison Comme Fondement (1901)MeksotetAinda não há avaliações
- L'opposition Métaphysique Au Monothéisme Hébreu de Spinoza À HeideggerDocumento27 páginasL'opposition Métaphysique Au Monothéisme Hébreu de Spinoza À HeideggerneferisaAinda não há avaliações
- Leibniz Opera OmniaDocumento853 páginasLeibniz Opera OmniaJean BenoitAinda não há avaliações
- Severyns, A. 1963. Recherches Sur La Chrestomathie de Proclos. Vol. 4. La Vita Homeri Et Les Sommaires Du Cycle. Texte Et Traduction (Paris: Les Belles Lettres)Documento53 páginasSeveryns, A. 1963. Recherches Sur La Chrestomathie de Proclos. Vol. 4. La Vita Homeri Et Les Sommaires Du Cycle. Texte Et Traduction (Paris: Les Belles Lettres)AlanWatermanAinda não há avaliações
- Ravaisson Metaphysique Etmorale PDFDocumento16 páginasRavaisson Metaphysique Etmorale PDFŠimon GrimmichAinda não há avaliações
- Hugo Rahner. Mythes Grecs Et Mystère ChrétienDocumento4 páginasHugo Rahner. Mythes Grecs Et Mystère ChrétienTiffany BrooksAinda não há avaliações
- Fins Des Biens Et Des Maux Cicéron ZDocumento407 páginasFins Des Biens Et Des Maux Cicéron ZJermo MerjohAinda não há avaliações
- Philosophie de la Liberté (Tome I) Cours de philosophie moraleNo EverandPhilosophie de la Liberté (Tome I) Cours de philosophie moraleAinda não há avaliações
- Pourquoi L'art Doit Imiter La Nature: Laval Théologique Et PhilosophiqueDocumento17 páginasPourquoi L'art Doit Imiter La Nature: Laval Théologique Et Philosophiqueoutof_space100% (1)
- Recherches Sur Dietrich de Freiberg by Joël Biard, Dragos Calma, Ruedi ImbachDocumento260 páginasRecherches Sur Dietrich de Freiberg by Joël Biard, Dragos Calma, Ruedi ImbachThi ArmadasAinda não há avaliações
- Inbound 1428853898875204922Documento218 páginasInbound 1428853898875204922Salem ElabbassiAinda não há avaliações
- Maurice Blondel - Le Christianisme de DescartesDocumento9 páginasMaurice Blondel - Le Christianisme de DescartesRomain PtrAinda não há avaliações
- De la signature des choses ou De l'engendrement et de la définition de tous les êtresNo EverandDe la signature des choses ou De l'engendrement et de la définition de tous les êtresAinda não há avaliações
- Boehm, Rudolf - Le Fondamental Est-Il L'essential (Aristote, Métaphysique Z 3)Documento18 páginasBoehm, Rudolf - Le Fondamental Est-Il L'essential (Aristote, Métaphysique Z 3)DamaskiosAinda não há avaliações
- Dictionnaire de Théologie Catolique, Vol. 13, Parte IIDocumento776 páginasDictionnaire de Théologie Catolique, Vol. 13, Parte IIFrancesco Patruno100% (1)
- Tome 12-2 Dictionnaire Theologie CatholiqueDocumento804 páginasTome 12-2 Dictionnaire Theologie Catholiquesanguis martyrumAinda não há avaliações
- UNESCO Et Sa PhilosophieDocumento157 páginasUNESCO Et Sa Philosophiecanislupus5Ainda não há avaliações
- Saint Thomas Et AristoteDocumento15 páginasSaint Thomas Et AristoteFrayPanfilio100% (2)
- Cicero - Le - DestinDocumento35 páginasCicero - Le - DestinDionisie Constantin Pirvuloiu100% (1)
- L'Analogie Selon Maître EckhartDocumento4 páginasL'Analogie Selon Maître Eckhartvince34Ainda não há avaliações
- Numen Volume 1Documento245 páginasNumen Volume 1Gelu Diaconu100% (1)
- Saint Anselme de Canterbury - ProslogionDocumento16 páginasSaint Anselme de Canterbury - ProslogionAnonymous NE7Bwby7100% (1)
- Corps Mystique Et Société Politique Chez Eric Voegelin (Gontier)Documento21 páginasCorps Mystique Et Société Politique Chez Eric Voegelin (Gontier)dhstyjntAinda não há avaliações
- Le Déclin de L'occident. Tome I & II-2021Documento1.103 páginasLe Déclin de L'occident. Tome I & II-2021snydex980% (1)
- Levenement Et La Raison. Autour de ClaudDocumento1 páginaLevenement Et La Raison. Autour de ClaudeffetpapillonAinda não há avaliações
- S'unir À L'intellect, Voir Dieu. Averroès Et La Doctrine de La Jonction Au Cœur Du ThomismeDocumento33 páginasS'unir À L'intellect, Voir Dieu. Averroès Et La Doctrine de La Jonction Au Cœur Du ThomismeSo' FineAinda não há avaliações
- La RationalisationDocumento5 páginasLa Rationalisationsamgadois319Ainda não há avaliações
- Simone Weil Sur La ScienceDocumento198 páginasSimone Weil Sur La ScienceduquebuitreAinda não há avaliações
- Le Monde Des Livres 27 Février 2009Documento8 páginasLe Monde Des Livres 27 Février 2009psg888Ainda não há avaliações
- Marie Madeleine DavyDocumento0 páginaMarie Madeleine DavyTrismegisteAinda não há avaliações
- Methodologie DissertationDocumento6 páginasMethodologie DissertationLeopold ClaudeAinda não há avaliações
- Connaissance SurnaturelleDocumento356 páginasConnaissance SurnaturelleBruno BerthelotAinda não há avaliações
- Chestov WeilDocumento24 páginasChestov Weilredvelvetmask2343Ainda não há avaliações
- PDF Résumé - La Condition Ouvrière - Simone WeilDocumento36 páginasPDF Résumé - La Condition Ouvrière - Simone WeilAnass ReeAinda não há avaliações
- DissertationDocumento15 páginasDissertationoumaima zeddaoui50% (2)
- INDEX GÉNÉRAL DES CAHIERS SIMONE WEIL, Du Tome I Er, N° 1 de Juin 1978 Au Tome XXXIX, N° 2 de Juin 2016Documento236 páginasINDEX GÉNÉRAL DES CAHIERS SIMONE WEIL, Du Tome I Er, N° 1 de Juin 1978 Au Tome XXXIX, N° 2 de Juin 2016Thiago Mattos100% (1)
- 8 Dissert CorrigéesDocumento21 páginas8 Dissert CorrigéesNa JouaAinda não há avaliações
- Phi T Num Comment Oeuvre SimoneweilDocumento4 páginasPhi T Num Comment Oeuvre SimoneweilKarimAinda não há avaliações
- Bibliographie S. WeilDocumento2 páginasBibliographie S. WeilFraise MandarineAinda não há avaliações
- Décréation Et Attention: Rapports Entre Dieu Et L'homme Chez Simone WeilDocumento12 páginasDécréation Et Attention: Rapports Entre Dieu Et L'homme Chez Simone WeilJOSEPH MONTESAinda não há avaliações
- Citations de WeilDocumento3 páginasCitations de WeilMath RevAinda não há avaliações
- SUP Correction Sujet de Dissertation Nicolas GrimaldiDocumento9 páginasSUP Correction Sujet de Dissertation Nicolas Grimaldividobow399Ainda não há avaliações
- Sur La Science - Simone WeilDocumento197 páginasSur La Science - Simone WeilBa CaAinda não há avaliações
- Cours Simone WeilDocumento2 páginasCours Simone Weilrien rienAinda não há avaliações
- Cahier #105: Simone WeilDocumento8 páginasCahier #105: Simone WeilHerne Editions50% (2)
- L'Iliade Ou Le Poème de La Force (Accompagnement Lecture)Documento7 páginasL'Iliade Ou Le Poème de La Force (Accompagnement Lecture)alibeneziAinda não há avaliações
- Lindispensable Sur Le Travail. Virgile, Géorgiques Simone Weil, La Condition Ouvrière Michel Vinaver, Par-Dessus Bord (Etc.)Documento237 páginasLindispensable Sur Le Travail. Virgile, Géorgiques Simone Weil, La Condition Ouvrière Michel Vinaver, Par-Dessus Bord (Etc.)ZakariaAinda não há avaliações
- Dissertation Corrigee - Niveau FacileDocumento7 páginasDissertation Corrigee - Niveau FacileNa JouaAinda não há avaliações
- Experience PolitiqueDocumento370 páginasExperience PolitiqueJOSEPH MONTESAinda não há avaliações
- DissertationDocumento21 páginasDissertationoumaima zeddaouiAinda não há avaliações
- Span 651Documento158 páginasSpan 651Emmanuel KoffiAinda não há avaliações
- Le TravailDocumento4 páginasLe TravailMohamed LemsefferAinda não há avaliações
- L Mercier-S WeilDocumento16 páginasL Mercier-S WeilPhil CasoarAinda não há avaliações
- Fiche - La Mystique Du TravailDocumento2 páginasFiche - La Mystique Du Travaildjero djahaAinda não há avaliações
- La Condition Ouvrière Résumé Des Passages Au ProgrammeDocumento4 páginasLa Condition Ouvrière Résumé Des Passages Au ProgrammemathildeAinda não há avaliações
- Capture D'écran . 2021-07-31 À 16.48.04Documento2 páginasCapture D'écran . 2021-07-31 À 16.48.04Glody mbembeAinda não há avaliações