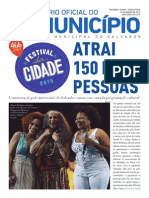Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Americanisme PDF
Americanisme PDF
Enviado por
Julie CavignacTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Americanisme PDF
Americanisme PDF
Enviado por
Julie CavignacDireitos autorais:
Formatos disponíveis
vibrant v.9 n.1 julie a.
cavignac
Resumo
Propomos avaliar a importncia dos estudos americanistas e o papel dos pes-
quisadores franceses na constituio de uma rede de pesquisa internacional
no incio do sc. XX. Tentaremos entender como se formou este campo dis-
ciplinar especializado, centrado nas populaes indgenas nas suas singu-
laridades culturais e sociais. A anlise dos fundamentos metodolgicos na
origem das colees museais pode ser realizada luz das condies nos quais
apareceram as pesquisas empricas : a coleta e o estudo da cultura material
foram privilegiados por serem testemunhos da diversidade das sociedades
humanas. Para isto, foram contratados jovens colaboradores encarregados de
coletar objetos para o Muse de lHomme e suprir a ausncia de conhecimen-
to sobre as culturas indgenas da America. As duas misses Lvi-Strauss
(1935 e 1938) integram este projeto de inventrio da cultura material e marcam
o incio de uma nova fase do Americanismo voltado agora para o estudo das
estruturas sociais. Iremos avaliar a importncia dessa mudana de foco para
as pesquisas americanistas na Amaznia e a consolidao de uma rede de
pesquisa internacional antes da Segunda Guerra Mundial. Um estudo docu-
mental desta natureza que questiona o objeto etnogrfico museologizado se
torna importante para reler a histria da disciplina, sabendo da importncia
do contexto histrico, dos embates polticos e do lugar dos trabalhos ame-
ricanistas no Brasil e na Frana. ainda possvel definir os limites de uma
antropologia que se autonomisa, se repensa e toma posio frente aos estados
coloniais e aos servios de proteo aos ndios.
Palavras-chave: Americanismo; Antropologia francesa; Museologia
Resum
Il sagit valuer limportance des travaux amricanistes et celle des chercheurs
franais dans la constitution dun rseau international de recherche au dbut
LAmricanisme franais au
dbut du XXme sicle
Projets politiques, musologie et terrains brsiliens
Julie A. Cavignac PPGAS UFRN
julie a. cavignac vibrant v.9 n.1
du XXme.s. Nous essaierons de comprendre comment se forme ce champ
disciplinaire spcialis, centr sur les populations indignes dans leurs sin-
gularits culturelles et sociales. Lvaluation des fondements mthodolo-
giques lorigine des collections musales peut tre ralise la lumire des
conditions dans lesquelles mergent les recherches empiriques: la collecte
et ltude de la culture matrielle ont t priorises pour tre les tmoins de
la diversit des socits humaines. Pour cela, de jeunes collaborateurs char-
gs de collecter des objets pour le Muse de lHomme ont t engags; ils
devaient aussi compenser labsence de connaissances sur les cultures indi-
gnes de lAmrique. Les deux missions Lvi-Strauss (1935 et 1938) intgrent
ce projet dinventaire de la culture matrielle et marquent le dbut dune nou-
velle phase de lAmricanisme intress par ltude des structures sociales.
Nous irons mesurer limportance de ce changement de direction pour les re-
cherches amricanistes en Amazonie et pour la consolidation dun rseau in-
ternational de recherche qui se constitue avant la Deuxime guerre mondiale.
Une telle tude documentaire qui questionne lobjet ethnographique muso-
logis savre importante car elle permet de relire lhistoire de la discipline,
vu limportance du contexte historique, des enjeux politiques, de la place des
travaux amricanistes au Brsil et en France. Il est encore possible de dfinir
les limites dune anthropologie qui sautonomise, se repense et prend position
face aux tats coloniaux et aux services de protection aux indiens.
Mots-cls: Americanisme; Anthropologie franaise; Musologie
Abstract
This article aims to evaluate the importance of Americanist studies and the
place of French researchers in the constitution of an international research
network in the early 20th century. We try to understand how this disciplinary
field emerged centered on the native American people, especially their cultu-
ral and social specificities. An analysis of the methodological underpinnings
of the first collections reveals that special attention was given to the collec-
tion and the study of material culture since it bore witness to the diversity
of human societies. Young collaborators were hired to be in charge of and to
analyze the collection of objects for the Muse de lHomme in order to fill the
lacuna of knowledge of the native Americans cultures. Lvi-Strauss two
missions (1935 and 1938) to make the inventory of the material culture that
vibrant v.9 n.1 julie a. cavignac
were part of this project inaugurated a new phase of Americanist studies,
focussed on the study of social structure. We evaluate the importance of this
change for Americanist research in the Amazon and the consolidation of
an international research network that came into being prior to the Second
World War. Such a documental review, which questions the museologized
ethnographic object, is important because it allows us to reread the history of
the discipline, in the light of the importance of the historical contexts, poli-
tical debates and the place of Americanist studies in Brazil and in France. It
is also possible to define the limits of an anthropology which becomes auto-
nomous and takes a critical position in relation to colonial states and welfare
services provided to native Americans.
Keywords: Americanism; French Anthropology; Museology.
julie a. cavignac vibrant v.9 n.1
LAmricanisme franais au
dbut du XXme sicle
Projets politiques, musologie et terrains brsiliens
1
Julie A. Cavignac PPGAS UFRN
La France, la famille, les amis, Paris! Mais les joies du retour sont de courte
dure. Quand on a vcu la vie sauvage, la vie civilise dsenchante. Il faut se
remettre compter, calculer, sinquiter du lendemain, de lavenir. Il faisait si
bon se laisser vivre l-bas, dans les maisons indiennes des prairies, indiffrent,
dlivr. Chasser, pcher, sans besoins, sans chefs, dans la libert absolue, dans
lgalit vritable, indpendant, calm, dans le vaste dsert, sous le sourire
du ciel quatorial, oubliant, oubli! () Mais, nest pas sage qui veut. Il y a les
fatalits du temprament. La vie est morne et sans couleur, surtout la vie nor-
male. Il faut de laction, laction pour laction, laction intense et hors de mesu-
re. Mais on ne peut sabstraire soi mme. Donc, tout pse. Cest pourquoi on
appelle son aide la fivre, la sainte fivre, qui fait vivre plus fort et plus vite.
Dans ces conditions, moins dune spciale de Boudha, dellbore ou de paraly-
sie, il ny a pas moyen de mettre en pratique la philosophie de Candide.
Henri A. Coudreau, 1886, Voyage au Rio Branco, aux Montagnes
de la Lune, au haut Trombetta (mai 1884-avril 1885), Rouen:
Imprimerie de lEsprance Cagniard, pp. 134-135.
1 Cet article est le rsultat dune rflexion sur lAmricanisme franais, mene dans le cadre dun
stage post-doctoral financ par la CAPES qui a t ralis au Laboratoire danthropologie et dhistoire de
linstitution de la culture (LAHIC), entre 2009 et 2010, sous la direction de Daniel Fabre. Cette recherche
bibliographique et darchives sappuie sur une vaste littrature existante sur le sujet. En particulier, jai
consult avec profit la brillante biographie de Paul Rivet labore par Christine Laurire (2008) qui ma
guide dans les mandres de lhistoire de la Socit des Amricanistes, quelle en soit vivement remercie.
Jai dpouill le Journal de la Socit des Amricanistes, en particulier les articles portant sur le Brsil
qui ont t publis entre 1928 (moment o Paul Rivet est lu la chaire danthropologie au Musum) et
1945. Jai consult les fonds de la bibliothque du Musum National dHistoire Naturelle o sont dposs
les documents administratifs du Muse de lHomme (MH) et enfin, la Bibliothque nationale (BN), le
fonds Lvi-Strauss qui, lpoque tait en cours de classement. Je remercie chaleureusement Jacques
Galinier, mon matre, pour les suggestions apportes ce texte.
27
vibrant v.9 n.1 julie a. cavignac
Lhistoire de lethnologie franaise revisite hors des frontires nationales se
limite souvent lvocation des courants thoriques, laissant peu de place
aux figures moins connues de lacadmie, aux actions entreprises par les
pres fondateurs de la discipline, lhistoire des institutions cres entre
les deux guerres et au contexte politique troubl de lpoque. Pourtant, les
muses et les instituts de recherche qui ont form les premiers ethnographes
professionnels ont jou un rle capital dans lmergence dune anthropolo-
gie qui laissait une place de choix aux objets et leur collecte puisquelle sest
tout dabord tourne vers ltude des techniques et de la vie matrielle des
peuples tudis larchologie tait alors associe aux collectes ethnogra-
phiques et ltude des langues. Organis en fonction dun projet colonial et
conu partir par de prsupposs naturalistes, le muse tait un complment
obligatoire de la recherche acadmique et devait tre la vitrine des peuples
administrs par ltat rpublicain, prsentant, sur un mode ducatif, la vie
des populations duquer et assimiler un ensemble national, la France
des colonies (LEstoile 2007).
Au dbut du XXe. sicle, on assiste la naissance dun projet scientifique
qui tait accompagn dune relle proccupation de la description circons-
tancie de la ralit sociale, une grande partie des travaux acadmiques pro-
duits par les chercheurs de lpoque traitant des techniques et de la culture
matrielle des socits primitives ou de la France rurale et de son folkore.
Partant dun prsuppos volutionniste qui aborde lhistoire de lhuma-
nit par les degrs de technicit et les productions matrielles des socits
humaines, les tudes taient lies la constitution de collections ethno-
graphiques et lorganisation de missions scientifiques commandes des
collaborateurs ventuels, des jeunes chercheurs et des ethnographes di-
lettantes forms par lcole franaise. Cette proccupation est particuli-
rement visible dans les premires tudes amricanistes qui sengagent dans
une qute des restes de socits de hautes cultures, notamment la mtal-
lurgie et la cramique, dont la dispersion devrait aider lucider lnigme
de lhistoire de lAmrique. Lexamen des fondements mthodologiques qui
ont t lorigine des collections musales, encore visibles par tous dans les
muses parisiens qui visaient lexploitation systmatique des productions
culturelles des socits humaines, doit maintenant tre ralis la lumire
des conditions dans lesquelles mergent un vaste matriel empirique, do-
maine jusque l peu explor par les historiens de la discipline. Il sagit donc
28
julie a. cavignac vibrant v.9 n.1
ici dvaluer limportance des travaux amricanistes et, notamment, celle
des chercheurs franais dans la constitution dune problmatique anthropo-
logique autour de lobjet et dun rseau de solidarit scientifique internatio-
nal. Nous essaierons, par la mme occasion, de comprendre comment sest
constitu un champ disciplinaire spcialis, jusque l centr sur les popula-
tions indignes et leurs singularits culturelles et sociales. Une telle tude do-
cumentaire savre importante pour redcouvrir lhistoire de la discipline, au
vu de limportance du contexte historique, des enjeux politiques de lpoque,
des travaux amricanistes raliss au Brsil et sachant la place de choix rser-
ve lobjet ethnographique musologis dans la formation de la discipline,
importance qui a t quelque peu oublie dans les rtrospectives classiques
(Jamin 1985). Nous verrons encore comment lanthropologie franaise qui,
lpoque sautonomise des tudes raciales, se repense et sengage, devanant
mme parfois les mouvements dmancipation politique des peuples coloni-
ss; lorsquelle se tourne vers lAmrique, la discipline saffranchit des int-
rts coloniaux traditionnels, porte un regard davantage critique sur la situa-
tion des populations natives, posture qui annonce de nouvelles perspectives
thoriques revendiquant un regard humaniste sur le monde.
Lexception de lAmricanisme franais
Le Dr. Paul Rivet, qui stait rendu en quateur comme membre dune mission
godsique en 1901, se passionna pour lethnographie et aprs six annes de s-
jour, rapporta en France les lments de son Ethnographie ancienne de lquateur. Il
consacra le reste de sa vie lethnographie et la linguistique sud-amricaines,
ainsi qu la cration et la direction du muse de lHomme (Poirier 1968: 113)
En France, comme dans les autres pays europens, les premires missions
ethnographiques officielles sont ralises de prfrence dans les colonies.
2
Cest ce qui explique que le continent africain et, dans une moindre mesure,
lOcanie occupent le devant de la scne jusqu lapoge du structuralisme
qui va donner ses lettres de noblesse aux tudes amricanistes.
2 On peut considrer la Mission Dakar Djibouti (1931) comme tant le modle des expditions
ethnographiques qui sera suivi par les chercheurs franais pendant la priode qui prcde la seconde
guerre mondiale et qui est marque par une rnovation des cadres et de lesprit de la recherche (Meyran
2002; Laurire 2008).
29
vibrant v.9 n.1 julie a. cavignac
Le Brsil des indiens
Toutefois, lensemble des travaux cits aux paragraphes prcdents se ram-
nent quelques donnes linguistiques limites gnralement de mdio-
cres vocabulaires et une description de la culture matrielle, soigneuse-
ment entreprise dans Rondonia. Nulle part, il est question de la vie familiale et
de lorganisation sociale. (Lvi-Strauss 1948: 2)
Voyageurs, mdecins, missionnaires et linguistes rapportent, ds le XIXe.
sicle, des informations sur les groupes indignes, crivent des relations
de voyage, laborent des cartes. Nous nous limiterons citer ceux qui ont
laiss des descriptions de voyage ou des notes sur les langues et gram-
maires, comme Francis de Castelnau (1843-1847), Paul Margoy (1848-1860),
Jules Crevaux (1877-1882), Henri Coudreau (1884-1899) et sa femme Octavie
(1889-1906), Lucien Adam, en 1896, ou encore le spiritain Tastevin qui de-
viendra un membre actif de la Socit des amricanistes fonde en 1895 et
fera une courte carrire acadmique son retour en France. Quelques pion-
niers de lethnographie dilettante figurent parmi les amricanistes, Hamy,
Nordenskild et Crqui-Montfort peuvent tre considrs comme les fonda-
teurs de cet effort descriptif. Mais ces recherches sont marques par lempi-
risme, labsence de mthode et souffrent dune situation financire prcaire
des socits savantes car les chercheurs doivent compter sur les donations
des bienfaiteurs ou sur leurs propres ressources pour financer leurs expdi-
tions (Laurire 2009 ; Castro 1992).
Ds 1824, la Socit de Gographie finance des travaux sur le continent
Amricain, devanant les ethnographes: au Texas, en Floride, au Brsil puis,
en 1856, au Prou, au Paraguay, au Mexique et en Amrique Centrale (Riviale
1995). Le premier article publi sur le Brsil dans le Journal de la Socit des
Amricanistes date de 1905 et il sagit darchologie.
3
Ceux qui revendiquent
une dmarche scientifique font rfrence aux thories en vogue (Gobinisme et
Darwinisme social), rassemblent des informations ayant trait lethnographie
3 Il sagit de larticle crit par de E. Thamy (1905): Deux pierres dclair (pedras de corisco), de ltat
de Minas-Geras, Brsil, Journal de la Socit des Amricanistes, 2, 1: 323325. P. Rivet commence ses
activits au Journal de la Socit des Amricanistes en 1907. Pour avoir une ide de lensemble de ses
activits, on pourra consulter avec profit la chronologie disponible dans le dossier de presse de louvrage
de Christine Laurire (2008) : http://www.mnhn.fr/museum/front/medias/dossPresse/14837_HD_rivet.
pdf. Nous ferons dsormais rfrence au Journal et la Socit des Amricanistes comme le Journal et la
Socit.
30
julie a. cavignac vibrant v.9 n.1
qui est alors dfinie comme ltude des murs, des us et croyances dun
peuple. La linguistique, larchologie, lanthropologie et la palontologie
doivent encore aider rpondre la grande question delorigine delhomme
amricainet de sa civilisation et celle de la formation des diverses races
humaines; leurs articles sont systmatiquement lus par les spcialistes
comme Erland Nordenskild et Paul Rivet partir des annes 1920 (Bossert et
Villar 2007; Poirier 1968: 116-119; Rivet 1924; Vignaud 1919: 2-4).
Itinraire gnral suivi par la mission Crqui Montfort et Snchal de la Grange
(1903)
4
4 Ministre de lInstruction publique. Mission G. de Crqui Montfort et E. Snchal de La Grange, 1903.
31
vibrant v.9 n.1 julie a. cavignac
On saperoit donc que la rflexion amricaniste des annes 1920 1930 se
concentre sur les questions de linguistiqueet darchologie : pour le Brsil,
Constant Tastevin, Theodor Koch-Grnberg, lexplorateur philologue de
lAmazone, Curt Nimuenadju et Cestmir Loukotka publient rgulirement
dans le Journal de Paul Rivet, faisant linventaire des langues et des cultures
indignes dAmazonie (Vignaud 1919: 9). De fait, les premires recherches
ethnographiques menes au Brsil qui reoivent un financement de ltat
franais sont toutes localises en Amazonie et datent du dbut du XXe.
sicle, notamment avec les voyages du Pre Tastevin. Celui-ci rapportera des
objets pour le Muse du Trocadro - il reste au sminaire de Tef entre 1906
et 1926 - et, son retour Paris, il occupe la chaire dethnologie lInstitut
Catholique de Paris. Connu pour ses travaux sur les langues des populations
amazoniennes et sa fructueuse collaboration avec P. Rivet, il reoit des aides
du Ministre de lInstruction Publique (Cunha 2009; PetitJean 2001: 74-75;
Faulhaber1997, 2005 ; Faulhaber e Monserrat 2008).
5
Paul Rivet ira rvolutionner lanthropologie amricaniste de lintrieur,
notamment aprs la premire guerre mondiale, car il rnove la Socit en as-
sociant les actions de recherche menes parle muse de lHomme qui compte
sur une quipe de volontaires et se sert de ses appuis politiques pour solli-
citer des financements publics et privs (Jamin 1989a; Laurire 2008 : 413).
Jusqu la cration de lInstitut dethnologie, en 1925, et larrive de Paul Rivet
la direction du Muse du Trocadro, en 1928, les connaissances des popu-
lations amrindiennes et la constitution des collections musographiques
sont encore dues aux explorateurs et aux missionnaires qui sont membres, et
souvent bienfaiteurs, de la Socit des Amricanistes (Dias 1991; Hamy 1890;
Taylor 1984). Lexposition Les arts anciens de lAmrique organise par
Alfred Mtraux et Georges Henri Rivire en 1928 au Muse des Arts dcoratifs,
situ alors au Palais du Louvre, connat un vif succs auprs du grand public
et annonce le projet de cration dun muse moderne :
Une de ses plus belles russites fut sans doute le Muse de lHomme ; pour
remplacer la poussireuse et incommode galerie qui avait nom Muse du
Itinraire gnral suivi par la mission / dress par V. Huot (Source : Bibliothque nationale de France,
GED-4578). Disponible sur gallica.bnf.fr: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8443634z/f1.zoom.
5 Dans une lettre de H. Lvy-Bruhl, dte du 09/03/1921 P. Rivet, il est fait mention de fonds annuels
allous Tastevin pour ses recherches (MHN, 2AP1D).
32
julie a. cavignac vibrant v.9 n.1
Trocadro, il finit par obtenir la construction dun immeuble spacieux, dig-
ne de son objet et de notre capitale. Il en fit un centre denseignement de
lanthropologie, en donnant ce mot le sens large quil dsirait lui voir recon-
nu. Cest ainsi qu la chaire danthropologie du Musum fut rattache la direc-
tion du Muse, tandis que les collections du Musum se rapportant ltude de
lhomme recevaient une place ct des pices darchologie et dethnographie
du Muse (Harcourt 1958: 10).
Cest une vritable quipe forme par Paul Rivet et Georges-Henri Rivire,
soude autour des mmes idaux et des mmes tendances politiquesqui met
en place un vaste programme de recherche et de diffusion des informations
scientifiques; tudiants et jeunes chercheurs, bnvoles pour la plupart
dentre eux, aident organiser les collections du Muse du Trocadro et sont
envoys en mission ltranger, tout se professionnalisant sur le tas. De fait,
les annes de lentre-deux-guerres iront rvolutionner lanthropologie en
France: le Brsil apparat alors comme lun des endroits o il est urgent de
raliser des recherches de terrain, de faire des fouilles et de collecter des ob-
jets pour constituer les collections ethnographiques jusqualors inexistantes.
Nanmoins, le nouveau projet scientifique qui se dessine comme tant
celui de ltude des peuples amrindiens et de leur histoire suit encore de
prs la direction des travaux portant sur les populations indignes des pays
sous domination coloniale et se propose de percer le mystre de leur origine.
Le nouveau muse se prsente alors comme une espce de caution scienti-
fique la souverainet de la Nation toute puissante (LEstoile 2007). Cet argu-
ment est visiblement avanc pour capter des crdits de recherche mme sil
correspond lesprit du temps et semble disparatre peu peu partir du
Front Populaire, moment favorable pour le dveloppement de lethnologie et
des muses qui correspond aux dparts des premiers ethnographes sur le ter-
rain et une prise de position critique vis--vis des autorits nationales en ce
qui concerne les populations natives (Grossi et alli. 2006).
33
vibrant v.9 n.1 julie a. cavignac
Maxourounas, Brsil. Stphane Pannemaker (1847-1930).
6
Idalisme scientique et ethnographie
Il serait intressant quune tude ethnographique srieuse des Canoeiros ft
faite le plus vite possible (...) une enqute sur eux fournirait sans doute les l-
ments dun beau livre comme celui que E. Nordenskild a crit sur la civilisa-
tion des Ciriguano (Rivet 1924: 175).
Cest un projet ambitieux qui se met en place, utopique et au dbut marginal,
6 Illustrations de Moeurs, usages et costumes de tous les peuples du monde...] [Vol.3. Pl. en reg.
p.186] [Cote: Rserve A 200 324]. Disponible sur http://gallica.bnf.fr: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
btv1b23005647/f163.item.r=brsil.
34
julie a. cavignac vibrant v.9 n.1
dont les rsultats ont t sous-estims dans lhistoire de la discipline ; le groupe
de chercheurs ayant souffert des consquences de la premire guerre mondiale.
Dans les annes 1930, la bande Rivet sorganise et profite de la monte au
pouvoir de Lon Blum pour matrialiser un projet davant-garde o lon peroit
le souffle de la rvolution bolchevique. Cest dans cet esprit que sont envoys
sur le terrain des jeunes chercheurs sans exprience, dans le but de collecter des
informations dordre linguistique ou ethnographique et de faire des fouilles.
Nanmoins, ceux-ci reoivent avant de partir, une formation en sui-
vant les cours de M. Mauss, ou, dfaut, les conseils de leurs professeurs :
Mtraux, le premier, form la prestigieuse cole des Chartes, part en 1928 en
Argentine, en Bolivie et, ds son retour en France, en 1934, est envoy sur lle
de Pques; le couple Lvi-Strauss, jeunes agrgs, partent au Brsil en 1934,
Dina ayant suivit les cours de Mauss. Aprs la cration de lcole franaise de
Mexico, plusieurs chercheurs obtiennent bourses et financements:Robert
Ricard part le premier, en 1929, puis Franois Weymuller, suivit de Soustelle
et de son pouse qui restent au Mexique entre 1932 et 1934, et de Guy Stresser-
Pan qui peut faire du terrain jusqu la veille de la guerredans lest du pays
(1936-1938). De fait, pendant ces annes qui prcdent le nouveau conflit
mondial et mme pendant les annes dexil, il existe une intense collabora-
tion entre les chercheurs europens et amricains spcialistes de lAm-
rique grce aux revues et aux instituts de recherche qui sont le principal
vecteur de la production scientifique.
Alfred Mtraux et Henri Lavachery en expdition sur lIle de Pques (1934-1935).
7
7 Image disponbilis sur le site: http://www.jeanhervedaude.com/Lecture%201.htm.
35
vibrant v.9 n.1 julie a. cavignac
Le Pre Tastevin, qui se situe mi-chemin entre le vieil Amricanisme et la
recherche acadmique, collabore troitement avec P. Rivet dans ses recherches
sur les langues amrindiennesdes les premires annes du vingtime sicle
; celui-ci participe comme mdecin militaire la mission godsique en
quateur (1901-1906), est rgulirement invit faire des confrences en
Amrique latine entre 1927 et 1939, fait des recherches ethnographiques et ar-
chologiques en Colombie (1941-1943) et au Mexique (1943-1944), pendant son
exil (Laurire 2008). De fait, pendant toute cette priode, il existe une intense
collaboration entre les chercheurs europens et amricains spcialistes de
lAmrique grce aux revues qui sont le principal vecteur de la production
scientifique, en particulier, le Journal dirig par Rivet qui rend compte des ac-
tualits scientifiques et ne cesse pas dtre publi, mme sous lOccupation.
8
Il semble en effet important dinsister sur le fait que, sur les terrains
amricains, les chercheurs franais ne pouvaient pas compter sur la pr-
sence de lappareil dtat et la collaboration des autres partenaires de la
mission colonisatrice (agents coloniaux, fonctionnaires, missionnaires, etc.)
et quils souffraient dun certain ostracisme (Faulhaber 1997). Nanmoins,
quelles soient culturelles, ducatives ou militaires, lesmissions fran-
aisesou les uvres decoopration portent encore la marque dun projet
imprialistequi doit sadapter aux contextes locaux et aux administrations
tatillonnes (Grupioni 1998). En fait, il apparat clairement que les jeunes in-
tellectuels se sentaient chargs dune mission civilisatrice ou, tout au moins,
quils taient porteurs dun idal progressiste. Cet esprit utopique se dou-
blait, au niveau politique, dun projet dinstitutionnalisation de lAmrica-
nisme; cest ce qui explique les missions universitaires et les implantations,
en divers pays dAmrique Latine, des instituts de recherche et labsence de
programmes de recherches franais aprs la seconde guerre mondiale en
dehors de lAmazonie.
9
Un secteur du gouvernement, le Service des uvres Franaises ltran-
ger fond en 1920, tait charg des relations de coopration ducatives et
8 Une lettre de Boas Rivet date du 23/08/1919 informe que le professeur install aux tats-Unis aide
la publication du Journal en trouvant des financements, mais il ny a pas de dtails sur les donateurs.
On peut cependant penser quil sagit de la Fondation Rockefeller sachant la proximit de Boas avec les
reprsentants de la fondation philanthropique (photocopies, fonds Rivet, MH, 2AP1C et D).
9 En cela, une grande partie de luvre de Roger Bastide est exemplaire : pendant la plupart de son
sjour au Brsil (1938-1954), avec la fin des missions la dclaration de la guerre, il ntait pas intgr
un change acadmique proprement parler.
36
julie a. cavignac vibrant v.9 n.1
scientifiques. Il dpendait du Ministre des Affaires trangres, tout comme
la mission universitaire qui a amen C. Lvi-Strauss et R. Bastide au Brsil
(Lefebvre 1990). Lors de laccs au pouvoir des socialistes, lhumanisme
rationaliste dtermine laction des ministres: ds 1936, Lon Blum dve-
loppe des actions ducatives, culturelles et de loisir populaires. On peut
citer le premier congrs international de folklore, lexposition universelle
et louverture du Muse de lHomme, en juin 1938 qui a t un vnement
mondain mais qui est devanc par une inauguration ouvrire du Muse de
lHomme o sont invits les camarades de la pierre, la section mca-
nique du Trocadro les familles des pltriers et artisans de tout poil qui ont
travaill au chantier (Velay-Vallantin 1997).
10
Ces mises en spectacle de la
culture des autres prennent modle sur lExposition Coloniale de 1931 qui
jouit de la vogue de lexotisme et a surtout servi montrer la puissance de la
France par rapport aux autres nations primitives (Laurire 2008: 403-410;
LEstoile 2007). Cependant, il est indniable quune recherche esthtique et
quun esprit de dmocratisation du savoir sont la base de ces entreprises
qui, lpoque, apparaissent comme tant davant-garde.
La vie en Socit
Enfin M. dHarcourt, accompagn au piano par Mme dHarcourt, in-
terprte avec un grand sens artistique une srie de chants indiens de
lEquateur, du Prou et de la Bolivie harmoniss avec beaucoup de talent par
laccompagnatrice. Cette audition originale, trs gote et trs applaudie par
lauditoire, termine cette belle sance, au cours de laquelle ont t nomms
lunanimit membres titulaires: Mme. Marie Fernandez de Tinoco et Maxwell
() (Actes de la Socit 1920 : 217).
Pour comprendre lanthropologie franaise du dbut du XXe. sicle, il
semble ncessaire de rappeler lengagement intellectuel des auteurs afin de
saisir limportance des tensions existantes lintrieur du champ discipli-
naire et la teneur du combat contre le racisme; combat qui tait mener en
priorit lintrieur des institutions scientifiques des diffrents pays dEu-
rope et dAmrique.
10 Voir le dossier Manifestations organises par le Muse dethnographie / Muse de lhomme: MH,
2AM1 C1 2AM1 C9.
37
vibrant v.9 n.1 julie a. cavignac
Les travaux amricanistes sont souvent critiqus pour leurs aspects pas-
sistes associs une idologie rgnante, cautionnant la domination des
populations asservies par ltat franais et un manque cruel de rfrences
thoriques (Riviale 1995: 215, 225; Descola & Taylor 1993: 17). Nanmoins,
selon nous, ces critiques doivent tre relativises, car elles effacent leffort
ralis pour la mise en place de projets institutionnels ambitieux ds les
premires dcennies du XXme sicle; ides gnreuses et rvolutionnaires
pour lpoque mais qui nont pas pu tre toutes concrtises par la force des
vnements historiques.
11
Il sagit dabord dun projet franais, les ethnolo-
gues bnficiant dun climat politique favorable sous le Front populaire, mais
rapidement, et avec la mise en place dinstituts de recherche et de revues sp-
cialises, les relations scientifiques sinternationalisent.
Les premiers amricanistes qui adoptent une perspective anthropolo-
gique non racialiste sont nanmoins encore orients par des proccupations
de reconstitution de lhistoire des socits primitives grce lanalyse com-
pare entre les dcouvertes archologiques et les artefacts. Ils adoptent une
perspective culturaliste qui privilgie lobjet comme tmoin de la vie sociale
et culturelle, accompagnant les enseignements du thoricien de lcole
Franaise, Marcel Mauss (1967) et celles du prcurseur du travail ethnogra-
phique aux tats-Unis , Franz Boas. Ces ides ont inspir les recherches eth-
nographiques portant sur les populations indignes du continent amricain
qui seront t ralises ultrieurement. Nous nous apercevons, en effet, que,
ds les premires annes du XXe. sicle, lcole franaise dethnologie
reoit des influences directes de lAmrique du Nord. Ds 1908, nous trou-
vons rgulirement des comptes-rendus douvrages de F. Boas dans le Journal
crits par des membres de la socit, ce qui prouve lexistence de liens entre
les institutions et limportance des travaux amricains pour la formation
des chercheurs franais et des professeurs qui sont invits aux tats-Unis et
qui participent de congrs spcialiss, comme celui des amricanistes. Rivet
entretient une correspondance soutenue avec F. Boas pendant plus de vingt
anset il existe des liens personnels entre les chercheurs qui partagent des in-
trts et des points de vue communs lexception des rsultats de lanalyse
de la linguistique amrindienne et de la sauvegarde des langues natives. Nous
11 Pour limportance du travail ethnographique lors de lmergence de la discipline en France, il est
important de citer l uvre de M. Leenhardt. Cf. : Cavignac 2006 in: Grossi et alli., 25-81.
38
julie a. cavignac vibrant v.9 n.1
trouvons une lettre date de 1919, crite par Boas et adresse Rivet o le
savant exprime ses sentiments ngatifs et prmonitoires sur la situation poli-
tique en Europe et propos des soubassements de lanthropologie physique.
Mme distance, ce dialogue est intense et semble amener Rivet se placer
sur la scne franaise et sengager corps perdu dans le combat du racisme:
il revendique une solidarit savante et se dfinit comme le dfenseur dun
internationalisme scientifique qui, malgr les vnements rcents, inclut les
chercheurs allemands (Laurire 2008: 487-518). Le dialogue va saccentuer
tout au long de ces annes troubles mais, ds les annes 1920, F. Boas porte
un regard clair sur la situation politique en Europe et les prils de lanthro-
pologie (physique):
From this point of view nothing has saddened me more than the circu-
lar sent out by our anthropological colleagues, principally of the cole
dAnthropologie, a statement dictated by uncontrolled emotion not by calm
deliberation.
It is impossible to speak of this matters without speaking of the general poli-
tical situation, and of what, I think, should be our aspirations as scientist. For
more than thirty-five years, I have abhorred nationalism in the sense in which
it has dominated the world for more than a century, -- a nationalism thas is
merely a transformation of the old dynastic struggle for Power. There is no
European nation that has been free of this desire. All the policies of European
States, as alas of the United States center in this one Idea. It is a form of
social thought in which all nations have participated, and all to the same ex-
tent, that has brought the world to a state of moral and economic bankruptcy.
Unless we all turn to new and broader ideals we shall not save the world from
further horrors. 12
Ces paroles prophtiques montrent la clairvoyance de Boas en relation
la situation conomique et politique internationale. Rivet qui est entr la
SFIO en 1919, semble sensible aux arguments de Boas. Vingt ans plus tard,
12 Correspondance de Rivet Boas (photocopies, fonds Rivet, MH, 2AP1C). On trouve plus de cent lettres
changes entre les deux hommes, 22 lettres entre 1919-1926; six dentre-elles datent de 1919 dans lesquelles
F. Boas rpond linvitation faite par Rivet publier dans le Journal de la Socit des Amricanistes et o
il est fait mention dchanges entre les revues franaises et amricaines mais aussi de subventions reues
par le biais de Boas pour rendre possible la publication du Journal aprs larrt daides gouvernementales
(Laurire 2008: 513-518).
39
vibrant v.9 n.1 julie a. cavignac
aprs lviction de Rivet du Muse de lHomme, le clan des anthropolo-
gues refait surface et restera aux commandes de la recherche jusqu la
Libration:
Ltude de lanthropologie, qui mne infailliblement lidentification prcise
et la dnonciation de la race juive, a fait depuis des annes lobjet dune v-
ritable conspiration du silence () Un des hommes qui furent chargs par le
clan judo-maonnique descamoter ltude des races humaines et de travestir
le racisme en une doctrine de violences et de brimades fut le trop clbre politi-
cien-cumulard professeur Paul Rivet qui vient dtre chass du Musum par le
marchal Ptain. Mais il reste, au Muse de lHomme du Trocadro et ailleurs,
quelques sous-touffeurs qui continuent sournoisement luvre du Rivet
dboulonn. () Nous avons besoin de raciologues pour jeter les bases dune
dfense du sang franais. Nous nirions tout de mme pas les chercher parmi
les pires enjuivs !13
Rapidement aprs lexil de Rivet en Amrique, le rseau de rsistance du
Muse de lHomme sera dmantel avec larrestation, la dportation ou mme
lexcution de plusieurs membres de lquipe, Mauss sera mis la retraite et
la plupart des amricanistes franais devront quitter le pays. Mais, rapide-
ment, les activits de la Socit reprennent: Paris, et malgr labsence de
son secrtaire gnral, les membres se runissent rgulirement, rendent
compte de leurs travaux et le Journal est publi pendant toute lOccupation.
14
Aprs 1940, le rseau franais est davantage actif lextrieur des frontires
nationales et le rseau de solidarit fonctionne ; la rsistance hors de lHexa-
gone sorganise et est directement lie au Gnral de Gaulle par le biais de
Jacques Soustelle et dautres rsistants, notamment Laugier qui est en poste
au Canada. M. Trebitsch (1995) et Petitjean (2001 : 4) montrent limportance
dHenri Laugier qui, la veille de la dclaration de la guerre tait directeur
Service de la recherche scientifique et chef du cabinet du Ministre de lIns-
truction publique (Lvi-Strauss 2008: 243). Rsistant, il deviendra, aprs la
guerre, secrtaire-gnral adjoint de lONU. On apprend, en examinant la
13 Journal Cri du Peuple (12/12/1940) Coups de balai. Va-t-on remplacer Paul Rivet para un sous-Rivet?
(Coupures de presse 1940, MHN: 2AM1B3). Pour une analyse du contexte de la recherche ethnologique
sous lOccupation, voir larticle de Daniel Fabre (1997).
14 Voir les Actes de la Socit et Mlanges et nouvelles Amricanistes , Journal de la Socit des
Amricanistes, tome 31 35, 1939-1945.
40
julie a. cavignac vibrant v.9 n.1
correspondance que C. Lvi-Strauss a entretenue durant toute la guerre avec
Rivet que les liens entre les prcurseurs du renouveau de lAmricanisme ont
t maintenus malgr les vnements : pendant toute cette priode, Laugier
servait dagent de liaison entre les diffrents chercheurs exils en Amrique
et leur rendait service, collaborant activement au rseau dintellectuels qui
participent au projet dexpansion de la New School dans les diffrents pays
dAmrique latine.
15
Le Cri du Peuple, journal fond en 1940. 16
Rivet en Colombie, Mtraux et Lvi-Strauss aux Etats-Unis sont luvre,
ils aident la cration dinstituts denseignement et de recherche: en 1941,
15 Voir le dossier MHN 9 a 03/03/1943.
16 http://www.cadeauretro.com/titre/CRIPVOIR.htm.
41
vibrant v.9 n.1 julie a. cavignac
llve propose son professeur de le faire venir aux tats-Unis et linvite
participer lcole Franaise des Hautes tudes en Amrique qui a comme
objectif mettre en relation les chercheurs, en crant des filiales dans toutes
les Amriques.
17
Rivet accepte tout de suite, envoie son curriculum en sexcu-
sant quil soit manuscrit :
() nous avons voulu, en groupant tous les franais des deux Amriques, crer
les conditions les plus favorables pour le maintien de linfluence franaise ; et
en mme temps crer un organisme dinformation et daction qui puisse con-
tribuer au dveloppement des liens entre les Etats Unis et lAmrique du Sud,
ce que la situation politique actuelle fait apparatre comme particulirement
ncessaire. Les Amricains du Nord sont anims des meilleures intentions vis-
-vis de lAmrique Latine; mais leur inintelligence totale des problmes qui se
posent, leurs maladresses ininterrompues, sont alarmantes. Les franais dis-
tribus travers le Western Hemisphere peuvent tre leurs conseillers naturels.
Cela est si vrai que, pour les questions brsiliennes, je suis sans interruption
oblig de rpondre des consultations des bureaux de Washington. Si le cen-
tre parvient coordonner nos informations et notre action, je crois quil peut
jouer ce rle de tout premier plan dans la guerre actuelle.18
Lambitieux projet du Latin American Center souffre nanmoins de lab-
sence de crdits et, daprs son directeur, ses objectifs politiques ne semblent
pas avoir t atteints: il sert de point de chute pour les chercheurs de pas-
sage New York et des cours spcialiss y sont dispenss. Sous limpulsion
de Rivet, quelques instituts franais sont crs, avant ou pendant la guerre,
en Amrique du Sud, mais seul le Comit de la France Libre narrive pas
runir les financements suffisants pour pouvoir fonctionner et doit compter
sur dautres sources de financement, probablement la fondation Rockefeller
qui finanait les activits de recherches et les publications produites par ces
instituts en Amrique Latine (Laurire 2008: 577-602). Comme le rsultat des
17 Rivet organisera un banquet en lhonneur de Boas, en 1937, Paris, et fera un court sjour aux USA
en 1942, invit un djeuner intime Columbia University, occasion o Boas sera foudroy par une crise
cardiaque (Laurire 2008 : 515-518). Djeuner auquel Lvi-Strauss participa galement. Plus tard, cest
Alfred Mtraux et Robert Lowie qui invitent Lvi-Strauss aux tats-Unis, grce au financement de la
Fondation Rockfeller qui fonctionne entre 1941 et 1947 (Cohen-Solal 1999: 14).
18 Lettre de Claude Lvi-Strauss Paul Rivet, New York, 21/10/1941 (fonds Rivet, MH, 2AP1D) et sa
rponse : lettre manuscrite de Paul Rivet Claude Lvi-Strauss, Bogot, 25/10/1941 ; en 1943, son tour,
Rivet insistera pour que Lvi-Strauss aille vivre au Mexique (fonds Lvi-Strauss, BN, NAF 28150).
42
julie a. cavignac vibrant v.9 n.1
longues annes de coopration entre la France et le Brsil, Paul Rivet et Paulo
Duarte (secrtaire gnral) inaugurent Paris lInstitut franais des hautes
tudes brsiliennes le 28 juillet 1945, comptant sur la prsence de lambassa-
deur du Brsil, dHenri Laugier, alors directeur Gnral du service des rela-
tions culturelles et du Professeur Georges Dumas responsable du dpart de C.
Lvi-Strauss pour le Brsil dix ans auparavant (PetitJean 2001).
19
Inspire par un humanisme rationaliste, la lutte pacifiste contre le
racisme engage par Boas et Rivet sera remplace, dans les annes daprs-
guerre, par un mouvement gnralis de critique du monde occidental, des
processus coloniaux et, par l, une mise en doute de la lgitimit de lan-
thropologie. Paralllement, et devant la crise dans laquelle se trouvaient les
sciences humaines en France lpoque, les changes scientifiques bilatraux
existants traditionnellement par le canal des instituts franais ltranger,
seront remplacs des politiques ducatives et culturelles internationales
visant la promotion de la paix (Unesco). Pour ce qui est du Brsil, en particu-
lier, le modle de la mission franaise est dpass et les recherches ayant
comme objet les populations indiennes et afro-brsiliennes compteront dor-
navant sur lappui des structures institutionnelles locales et le financement
des fondations amricaines pour la recherche. Cependant, tout au moins
pour la mise en place de ces actions, les disciples de Rivet, Mtraux et Lvi-
Strauss, apparaissent en premire ligne, car ils sont au cur des rseaux am-
ricanistes et de la recherche internationale, proposant un nouveau modle
pour lethnologie o lanalyse interprtative des faits sappuie sur un travail
de terrain minutieux (PetitJean 2001; Trebitsch 1995).
20
19 MH, 2AM1 C4c. Paulo Duarte est aussi le co-fondateur du Dpartement de Culture de So Paulo avec
Mrio de Andrade (Lvi-Strauss 2008: 1682).
20 Les deux chercheurs participent de la collection La question raciale devant la science moderne
du dpartement des sciences sociales de lUnesco en 1952, rsultat qui, pour Lvi-Strauss, sera publi
sous le titre de Race et histoire (Lvi-Strauss 2008: XLVIII; Maio 1997; Mtraux 1978: 314). Pour une
discussion approfondie de la question raciale dans le Brsil du dbut du XXe. s., voir Schwarcz 1993. La
priode qui suit la deuxime guerre mondiale est marque par linstitutionalisation de la recherche,
tant en France comme au Brsil ; l encore, la figure de Paul Rivet son projet de de retrouver lorigine
des peuples amricains continue orienter les discussions scientifiques: Les Deuximes rencontres
intellectuelles de So Paulo qui ont eu lieu cette anne du 21 au 26 aot, ont t organises conjointement
par lUNESCO et lI (Instituto Brasileiro de Educao Ciencia e Cultura) grce une initiative du grand ami du
Muse de lHomme et de la Socit des Amricanistes quest le professeur Pablo Duarte. Le thme offert
en discussion tait : Lorigine de lhomme amricain. Ce choix constituait un hommage au Dr Paul Rivet,
vice-prsident des rencontres de 1954, dont le portrait dominait lauditoire. Dans la sance inaugurale,
Pablo Duarte a voqu le souvenir de celui qui fut pour lui le plus cher des amis, et a dcrit son apport
43
vibrant v.9 n.1 julie a. cavignac
La phase dinternationalisation de la recherche ethnologique correspond
lclatement de la Seconde guerre mondiale et au projet du Handbook. Cette
srie ditoriale propose un inventaire exaustif des populations, des langues
et des cultures amricaines. Pour comprendre les enjeux de cette entreprise
denvergure, il semble important de revenir sur les conditions de la recherche
amricaniste et de mesurer la participation de lcole franaise aux tudes
brsiliennes dans les annes 1930.
Exils amricains
Lvi-Strauss arrive. On jurerait un juif descendu dune peinture gyptienne:
mme nez et barbe taille la smite. Je le trouve froid, compass, trs uni-
versitaire franais. (...) Lvi-Strauss est dgot du Brsil. Vargas est un dicta-
teur sans principes qui simplement tient durer. Sa dictature est essentielle-
ment policire. Il sappuie successivement sur tous les partis pour les dtruire
lorsquils sont trop influents. Cest ce qui est arriv aux integralistas, lanne
dernire. La rpression a t brutale, plus violente mme que celle contre les
communistes. Les rgions frontires sont occupes par les militaires qui y font
rgner un rgime arbitraire et exercent une surveillance tracassire. Cest ainsi
quil semble difficile de voyager dans la rgion de Corumb. (...) Lvi-Strauss
ne voit aucun espoir pour lAmrique du Sud. Il est presque enclin voir dans
ce ratage une sorte de maldiction cosmique. Il est dcid quitter le Brsil, o
tout travail semble impossible (Mtraux 1978: 42-43).21
LAmricanisme tel quil se prsentait Paris ds les annes 1920-1930,
avait chang de visage par rapport lesprit qui lanimait quelques annes
auparavant: le militantisme scientifique de Paul Rivet linscrivait dj dans
une perspective contemporaine, mettant en avant les recherches empiriques
(Laurire 2008). Or les missions ethnographiques organises en Amrique
latine, loin dtre le fait dexplorateurs isols comme on le croit souvent, re-
oivent un appui institutionnel important et suivent un mme objectif : rem-
plir le muse du Trocadro, plus tard rebaptis Muse de lHomme. Plusieurs
figures importantes de lethnologie franaise de lpoque participent au
la solution du problme du mystre des origines de lhomme amricain.
21 Impressions dAlfred Mtraux aprs la rencontre avec Claude Lvi-Strauss Santos, en 1939.
44
julie a. cavignac vibrant v.9 n.1
mouvement dinstitutionnalisation de la discipline, mme en dehors des
frontires nationales; les deux guerres obligeant une reconfiguration de la
scne scientifique franaise.
Alfred Mtraux, ami de Rivet et, plus tard, de Lvi-Strauss, embrasse la
cause amricaniste ds la fin des annes 1920. Il est le premier travailler
les textes de la France Antartique et dautres chroniques anciennes, grce
sa formation de palographe et dhistorien - ses travaux dethno-histoire
Tupinamb sont devenus classiques -, et cest un des prcurseursdes tudes
ethnographiques en Amrique.
22
Agent actif dune rflexion rsolument
internationaliste, il mettra en pratique ses ides, puisque la grande partie de
sa carrire sera mene hors des frontires de lhexagone : il part en 1928 en
Argentine o il dirige le muse de Salta, et lInstitut dethnologie Tucuman,
entreprend des fouilles arquologiques sur lle de Pques, fait de lethno-
graphie en Bolivie, au Prou, au Brsil et en Hati. Cest encore la cheville
ouvrire du Handbook of South American Indians pendant la Seconde guerre
mondiale, uvre qui fera date et qui a vu le jour grce la participation ac-
tive des spcialistes que Mtraux invite (Lvi-Strauss, Nimuendaju, Baldus,
Wagley). Continuant sa carrire acadmique internationale, il participe aprs
la guerre plusieurs projets lancs par lUNESCO: celui, avort, de lInstitut
international de lHylea amazonienne au Brsil et le projet pilote dducation
de base dans la valle de Marbial Hati. En 1950, il est charg dtudier les
problmes raciaux au dpartement des sciences sociales de lUNESCO, Paris.
Cest encore lui qui met en place la mission de la Columbia University au dbut
des annes 1950. Participent de cette exprience Thales de Azevedo, Charles
Wagley, Marvin Harris, W. H. Hutchinson, Ben Zimmerman et Pierre Verger,
comme photographe en 1951 qui est un ami intime de linfatigable chercheur
(Mtraux 1978).
Enfin, Mtraux apparat comme le modle de lethnologue contemporain,
la fois homme dinstitution et militant, fervent dfenseur de la cause anti-
raciste et des peuples autochtones, laissant derrire lui une production aca-
dmique poustouflante (Laurire 2005; Rivire et alli. 1964). Chartiste et pr-
curseur des travaux ethnographiques en Amrique, il reprsente la nouvelle
gnration de chercheurs franais qui, de plus en plus, se spcialise et acquiert
22 Deux ouvrages dAlfred Mtraux sortent la mme anne (1928): La religion des Tupinamba et ses
rapports avec celle des autres tribus Tupi-Guarani (Librairie Ernest Leroux, Paris) et La civilisation
matrielle des tribus Tupi-Guarani (Paul Geuthner, Paris).
45
vibrant v.9 n.1 julie a. cavignac
une formation suprieure. Il fait dabord de lethnographie de sauvetage, sin-
vente comme archologue, fait des mesures anthropomtriques et commande
des chantillons sanguins pour, plus tard, produire des travaux spcialiss:
Nos excursions nous ont permis de dcouvrir quelques grottes nouvelles, avec
de belles sculptures et une srie impressionnante de ptroglyphes relever.
Nos collections sont belles et importantes, elles reprsentent le matriel le plus
riche trouv dans lle depuis le temps o lart pascuan est mort (...). Je suis sa-
tisfait des rsultats de mes enqutes ethnographiques. Je memploie former le
corpus des contes, lgendes et mythes de lle que je transcris en vieux pascuan,
langue toute prte steindre. Jai mme le sentiment dtre venu sur les lieux
in extremis. Ma peine nest pas inutile, car jai la conviction de sauver la viei-
lle mythologie polynsienne de lle. Jai fait des dcouvertes importantes en ce
qui concerne le potlach. Difficile de vous donner une ide de ce sauvetage eth-
nographique. Nous venons trop tard.
23
La lecture des carnets de Mtraux (1978) et ses correspondances montre
quil existe des liens damiti durables entre les membres de lquipe du
Muse, et, malgr les vnements, ceux-ci restent en contact : solidarit intel-
lectuelle et affective qui marquera le destin des chercheurs de lpoque et qui
explique certaines trajectoires individuelles.
Grce lexamen du contexte historique des productions scientifiques
datant du dbut du XXme sicle, en particulier celles des membres de la
Socit des amricanistes, nous nous apercevons que lethnologie franaise
tait engage dun point de vue idologique, rsolument gauche, mais
aussi, proccupe par le sort des populations natives; en France, lusage du
terme ethnologie, jeune science se voulant avant tout empirique, a t
choisi et maintenu jusqu nos jours afin de se dmarquer de lanthropologie
physique qui est reste influente jusqu la fin de la deuxime guerre mon-
diale et mme aprs (Fabre 1997). Nous en avons pour preuve la raction vive
de Rivet lorsque Lvi-Strauss lui propose de participer la cration dune ins-
titution denseignement danthropologie ayant comme spcialit lAmrique:
Mon cher ami,
Jaccepte bien volontiers de faire partie de lcole Franaise des Hautes tudes
23 Lettre de A. Mtraux P. Rivet, 11/09/1934 (MH, fonds Rivet, 2AP1D).
46
julie a. cavignac vibrant v.9 n.1
en Amrique, aux conditions que vous mindiquez. Mais pourquoi diable
pensez-vous que le mot Anthropologie sera moins compris en Amrique
que que le mot Ethnologie, alors que la plus grande institution scientifique
amricaine, qui soccupe de notre terrain a pris, ds 1879, la lettre de Bureau
of Ethnology? Est-ce que les Amricains du Nord ne comprennent pas encore
le but et le champ daction de ce glorieux organisme? Tout cela ne me semble
gure clair. Jinsiste donc pour que la dsignation Ethnologie soit conserve.
24
Le vieux professeur insiste en effet pour conserver le projet et la termi-
nologie chre lcole franaise car il sagit dun enjeu politique qui est
dune actualit brlante. En dehors de limportance du scientisme militant
dans ce contexte troubl de la premire moiti du XXe.s., il semble ncessaire
de rapeller la dimension matrielle dans les tudes ethnologiques de lpoque.
Le muse, un espace ducatif et un laboratoire scientique
Les principales activits acadmiques et les expositions ethnographiques
ralises dans la France de lentre-deux-guerres sont associes lInstitut
dEthnologie de Paris et la constitution des collections ethnographiques,
effort des membres de la Socit qui participeront au rseau du Muse de
lHomme. Les ides et le contexte politique tout comme la dynamique scienti-
fique de lpoque apparaissent comme centraux pour analyser lobjet musal.
Cela nous permet, en outre, de jeter un regard diffrent sur le pass de la disci-
pline: la littrature dj produite sur le sujet nous aide valuer limportance
des travaux amricanistes et celle des chercheurs franais dans la consti-
tution dun rseau de recherche international. Nous avons ainsi pu raliser
quelques prospections dans les archives qui nous permettent de complter
le tableau et de comprendre les transformations que lanthropologie amri-
caniste a connu dans les annes 1920-40, phase dinstitutionnalisation de la
discipline, qui passe dune perspective empiriste la Rivet un envol tho-
rique avec larrive de Lvi-Strauss sur la scne structurale (Jamin 1989a: 291).
La premire moiti du XXe. sicle est une priode o lethnologie se
constitue comme une discipline autonome et se donne une vitrine: le muse
ethnographique ouvre les frontires de la connaissance des socits exotiques
24 Lettre manuscrite de Paul Rivet Claude Lvi-Strauss, Bogot, 25/10/1941 (fonds Lvi-Strauss, BN,
NAF 28150). Peu aprs, Rivet viendra faire des confrences New York mais ne russira pas rester aux
USA (Laurire 2008: 518).
47
vibrant v.9 n.1 julie a. cavignac
ou de la France rurale, propose dduquer les masses avides de savoir, montre
les rsultats de la recherche et limportance de la mission civilisatrice de
la France, mais sert aussi justifier les demandes de fonds pour financer les
activits scientifiques (Fabre 1997). Les grandes expositions et le muse mo-
derne qui nait en 1936 sont projets comme des lieux de loisir, tant ducatif
que mondain; on peut ainsi, se dpayser en visitant le Trocadro rnov ou,
plus tard, le Muse de lHomme conu par Georges Henri Rivire, puisquen
le visitant, on fait le tour du monde en deux heures!
25
Cette effervescence
culturelle et artistique sexplique par lengouement des lites pour lexotisme,
recherche esthtique qui consiste valoriser lart primitif et la recherche des
origines. Ainsi, le dfi est de concilier les activits scientifiques et le loisir
dans un mme lieu, le muse dethnographie qui doit tre un muse la fois
vivant et instructif.
Paul Hugo Herdeg, salle dAsie du muse de lHomme (1939).
26
25 Voir les affiches et les prospectus du Muse de lHomme: MH, 2AM1 C1 2AM1 C9.
26 Disponible sur http://gradhiva.revues.org/473.
48
julie a. cavignac vibrant v.9 n.1
Les salles du Muse de lhomme, organises selon les aires culturelles tu-
dies par les ethnographes, proposent une mise en ordre du monde et sa
mise sous vitrines. En vrit, elles sont le tmoin de lutopie duniversalisme
encyclopdique des savants franais qui rejoint en partie la proposition de
Boasqui tait de faire linventaire systmatique des aspects socioculturels des
groupements humains tout en faisant ressortir leurs particularits. Ainsi,
ds la cration de lInstitut dEthnologie en 1925, un nouveau projet musal
voit le jour et les recherches de terrain (anthropologie physique, linguistique,
archologie et ethnographie) ont comme but objectif de fournir des pices au
nouveau muse qui sort de terre. La conception du muse moderne cor-
respond lidologie progressiste de lquipe Mauss/Lvy-Bruhl/Rivet: comme
leur matre, ils allient engagement intellectuel contre le racisme, combattent
les ides de lanthropologie physiquetout en voulant populariser la science.
La musographie idalise et conue par Georges-Henri Rivire dans les an-
nes 1930 correspond donc a un projet esthtique et politique ambitieux, voire
utopique, et en mme temps marginal, car sopposant un courant conser-
vateur trs puissant qui reprendra sa place dune faon durable au moment
de lOccupation, brisant llan de rnovation de la discipline. Cest pour cela
que les activits de ces annes noires sont restes relativement peu connues
pendant une longue priode et que lanthropologie franaise a mis du temps
avant dcrire son histoire (Copans 1999; Fabre 1997; Jamin 1988: xvi).
Ainsi, les collections musales qui sont en train dtre constitues par les
missions scientifiques et le projet dinventaire des socits humaines vont
de pair: avant dtre des ethnographes, les chercheurs sont des collecteurs
dobjets destins remplir les muses. Lanalyse du projet mthodologique
qui sous tend la constitution de collections ethnographiques est rendue
possible par la description du corpus collect et par lanalyse de limpor-
tance de ces objets pour la comprhension des socits indignes qui taient
jusqualors mconnues du grand public et de la science. Cest en cela que les
missions Lvi-Strauss de 1936 et de 1938 sont importantes car les collectes
saccompagnent dannotations qui sont le rsultat dobservations ethnogra-
phiques qui seront reportes sur les fiches catalographiques du muse. De
plus, le recueil des artefacts saccompagne dune rflexion thorique faite sur
les populations tudies: les photographies et les objets recueillis sont int-
grs lanalyse de la parent, de la religion, des formes dhabitat, clairent
des techniques, etc.
49
vibrant v.9 n.1 julie a. cavignac
Les missions reoivent la collaboration de plusieurs spcialistes: le tra-
vail dquipe suppose une direction mthodologique et lexistence dun projet
thorique qui, pour la priode, hsite entre les problmatiques volution-
nistes et culturelles. Lobjet rituel collect est recouvert dune nouvelle inten-
tionnalit lors de son entre au muse o il devient pice de collection, cesse
davoir une fonction rituelle, se mtamorphose en objet ethnographique i.
e. scientifique - et se transforme en un tmoin de la culture et de lhistoire de
la population tudie. Ainsi, associe une dmarche scientifique, la notion
dobjet ethnographique qui nait dans les annes 1930 est le fruit dune slec-
tion parmi les tmoins culturels potentiels et doit obligatoirement saccom-
pagner dun travail dobservation, danalyse, de classement des informations
et objets recueillis qui forment une collection (Grognet 2005).
Afche du Muse de lHomme (1939)
27
27 Affiche annonant la rouverture du Muse de lHomme et louverture de la nouvelle salle dAmrique
50
julie a. cavignac vibrant v.9 n.1
En fait, notre propos nest pas de faire une lecture critique des produc-
tions intellectuelles de lpoque ni, moins encore, de nous hasarder dans le
domaine de lhistoire des ides mais il sagit plutt de comprendre le projet
intellectuel et politique sous-jacent linvestissement franais: lenvoi deth-
nographes et/ou de collecteurs dobjets ethnographiques ltranger nest
pas anodin. Pour cela, il est important de comprendre les contextes institu-
tionnels et politiques dans lesquels sinscrivent ces expriences (Stocking
1982). Lanalyse de documents personnels la correspondance de Claude
Lvi-Strauss dpose la Bibliothque Nationale, et en particulier les lettres
changes avec les autres chercheurs amricanistes (Paul Rivet, Alfred
Mtraux, Robert Lowie) et les collaborations brsiliennes (Mrio de Andrade
et Kurt Nimuendaju) -, la rflexion portant sur les contextes ethnographiques
des collections dposes au Muse de lHomme, les travaux scientifiques,
tout au moins ceux qui portent sur les populations indignes au Brsil, per-
met de complter notre comprhension du champ de recherche de lAm-
ricanisme. De fait, nous avons pu suivre les traces dun projet scientifique
naissant qui a t maintes fois critiqu pour tre essentiellement thorique
et ne pas sintresser au terrain, ce qui constitue, notre avis, un contre-sens
car lanthropologie franaise nait justement lpoque o sont ralises les
premires recherches de terrain et se construit en dialogue avec les mono-
graphies produites.
28
Il nous a paru ncessaire de dmonter cette image qui
ne prend pas en compte limportance donne la culture matrielle et len-
qute de terrain dans le projet intellectuel de ceux qui participeront laven-
ture du Muse de lHomme; cette vision froide de lhistoire de la discipline
tend gommer les tensions internes au champ intellectuel de lpoque et ne
prend pas en compte le contexte historique particulirement troubl dans le-
quel est pense la jeune science (Jamim 1989a). Pour ce qui est de lquipe du
Troca, il existe bel et bien une proccupation pour la description circons-
tancie de la ralit sociale puisque lintrt se porte sur les productions ma-
trielles des socits humaines : une grande partie des travaux acadmiques
tait constitu de monographies descriptives et avait comme thme les tech-
niques et les objets ; tudes qui taient lis la constitution de collections
(1939). Disponible sur le site : http://catalogue.drouot.com/ref-drouot/lot-ventes-aux-encheres-drouot.
jsp?id=526655.
28 En ce qui concerne particulirement Claude Lvi-Strauss, nous navons trouv que quelques
rfrences soulignant la qualit de son travail ethnographique (Souza et Fausto 2004; Saez 2008: 10-11).
51
vibrant v.9 n.1 julie a. cavignac
ethnographiques et de voyages commands des collaborateurs ventuels
et des ethnographes dilettantes. Car, lorigine, et tout au moins pour les
annes trente, avant dtre des lieux dexposition des formes de vie des socit
exotiques, les muses ethnographiques taient penss comme des centres de
recherche (Laurire 2008). La musographie reflte donc dabord les proccu-
pations thoriques, mthodologiques et idologiques de lpoque.
Lmergence dun vaste matriel empirique prsent dans les collections
musales rvle les fondements mthodologiques en vue de lexploitation
systmatique de la culture matrielle et du projet initial qui est la base des
recherches amricanistes: Paul Rivet et ses acolytes cherchent dsesprment
lorigine de lhomme amricain travers ltude des traits physiques, des
tmoins archologiques, des langues et des artefacts qui tmoigneraient de
larrive et de la distribution des groupes sur le continent. Les outils mtho-
dologiques utiliss par les chercheurs et les projets institutionnels naissants,
notamment ceux qui sont mis en place So Paulo et Paris dans les annes
trente, nous guident pour lire lhistoire de la discipline et vrifier sa consoli-
dation institutionnelle au niveau international. Au Brsil, la priode entre les
deux guerres apparat comme fconde puisque lon observe une production
scientifique consquente et une activit autour des grandes expositions et
des muses : L. Lvy-Bruhl et M. Mauss sont davantage thoriciens et profes-
seurs, P. Rivet, homme dinstitutions est charg des relations politiques et
de trouver des financements, G. Henri Rivire, agitateur culturel et promo-
teur dvnements artistiques. En fait, seul A. Mtraux, connu pour tre un
homme de terrain, a un profil acadmique. Tous ces acteurs enthousiastes du
renouveau de la discipline partagent les mmes ides et un engagement poli-
tiquevolontairement gauche: pour les loisirs des masses, pour la cra-
tion dun muse moderne, contre lanthropologie physique, contre le racisme
(Fabre 1997; Laurire 2008).
Pour comprendre lesprit qui animait les amricanistes franais de la pre-
mire heure, il faut se tourner vers lhistoire des institutions, des programmes
et des agents de la recherche du dbut du XXme sicle. Louverture du Muse
de lHomme, en 1938, nous donne voir une reprsentation de la discipline qui,
de plus en plus, se veut tourne vers la ralit concrte des cultures humaines:
le muse est un laboratoire dethnographie, un lieu denseignement et dentrai-
nement aux techniques denqute mais aussi une sorte de bibliothque vivante
car il propose un inventaire des cultures dans leur diversit, les objets tant
52
julie a. cavignac vibrant v.9 n.1
considrs comme des tmoins culturels (Jamin 1985: 60-65). Lexpographie
accompagne de prs lavancement des connaissances sur les socits tudies
par les ethnographes et produit un discours savant sur les cultures exotiques
qui sont ranges selon leur distribution gographique sur une aire cultu-
relle et analyses partir de leur matrialit: morphologie sociale, techno-
logie, conomie, phnomnes juridiques, moraux et religieux (Mauss 1967).
Ainsi, le modle qui sous-tend toute dmarche scientifique de lpoque est
celui de la collection, version matrialise et amplifie de la monographie
scientifique qui sappuie sur lobservation et la classification des faits sociaux
: lenqute de terrain nest pas limite une seule ethnie mais est associe
une collecte extensive dobjets ralise lors des grandes expditions ethnogra-
phiques. Celles-ci commencent tre organises dans les annes 1930, comme
la mission Dakar-Djibouti dirige par Marcel Griaule (Grognet 2005; Jamin
1985; LEstoile 2007). Cest ce modle qui sera appliqu au Brsil, lorsque seront
penses les deux missions franaises diriges par C. Lvi-Strauss.
Amricanistes franais au Brsil 29
Jai le profond regret dtre dans limpossibilit avec ou sans subvention
de me rendre au Brsil au mois de juin 1920. Il y a, en effet, tant de questions
lucider, qui touchent lhistoire et aux populations de ce pays, que tout eth-
nologue doit tre dsireux de pouvoir les tudier sur place. Je ne connais pas
encore le programme de la prochaine session, mais jai lassurance quil sera du
plus haut intrt; je men rapporte la sagacit de nos amis brsiliens, qui m-
ritent de sincres flicitations pour navoir pas hsit, dans les circonstances
actuelles, prparer le XXe. Congrs international des Amricanistes. Je forme
des vux pour quun brillant succs vienne couronner leurs efforts et, obis-
sant une pense un peu goste damour-propre national, pour que la France
tienne son rang habituel dans ce Congrs (Verneau 1919: 672).
Au moment de la mission universitaire en vue de la cration de lUniver-
sit de So Paulo (USP), en 1934, aprs une crise politique au Brsil, des diffi-
cults conomiques et financires, les relations avec la France reprennent. De
29 Pour une description des activits et des articles de Dina et Claude Lvi-Strauss entre 1934 et 1938,
voir les travaux de Fernanda Peixoto (1998) et le projet de recherche dirig par Mariza Corra (UNICAMP)
sur lhistoire de lanthropologie au Brsil entre 1930-1960.
53
vibrant v.9 n.1 julie a. cavignac
fait, ce pays occupe une place de premier rang dans les relations scientifiques
au Brsil: en plus de la venue de professeurs lUSP, il y a une augmentation
du nombre des lyces franais, des bibliothques se crent, des ordres reli-
gieux sinstallent et des projets de coopration conomique se mettent en
place (PetitJean 2001). Il faut rappeler que la politique extrieure de la France
des annes 1920 saccompagne dun projet diplomatique, militaire et ducatif
o les professeurs taient susceptibles dtre appel jouer un rle en cas de
guerre.
30
Ces informations extra-scientifiques nous donnent donc loccasion
de faire une rflexion sur les enjeux politiques et culturels de la France, en
particulier, pour ce qui est de sa politique extrieure dans la premire moiti
du XXe. sicle.
Les collaborations scientiques
(...) la situation na jamais t aussi mauvaise quelle le paraissait, vue de loin.
Ainsi, lopposition du Service de Protection ntait cause par aucune hostilit,
mais simplement par le fait que, priv depuis vingt-six ans de toute informa-
tion sur la Serra do Norte, ce Service nentendait assumer aucune responsa-
bilit dans notre entreprise. Ces difficults ont t ingnieusement limines
par nos amis de la Municipalit, qui, suivant une suggestion que je leur avais
donne, ont organis lexpdition comme une entreprise purement brsilienne,
mais dont ils me confiaient la direction. Nous nous trouvons ainsi dispenss de
toutes les formalits auxquelles sont astreintes les missions trangres. La ville
de So Paulo est mme alle jusqu engager par contrat le dlgu des autori-
ts fdrales, qui se trouve ainsi plac sous ma direction. Monsieur L. de Castro
Faria, lve et ami dHloisa Torres, est dailleurs un garon charmant et sym-
pathique qui sest montr jusqu prsent un excellent collaborateur.
31
Il faut rappeler tout dabord que le contexte des missions franaises
au Brsil correspond aux premiers moments de la formulation dune poli-
tique indignistequi est le fruit dun projet national labor dans un Brsil
30 Pour une analyse dtaille du sujet, voir la thse de Hugo Rogelio Suppo: La politique culturelle
franaise au Brsil entre les annes 1920-1950, thse dhistoire, Paris III, 1998.
31 Lettre de Lvi-Strauss crite de So Paulo, 30/04/1938, adresse Rivet (tape la machine) et
laquelle Jacques Soustelle rpond le 09/05/1938 : Le Dr Rivet vous remercie pour votre lettre, quil m
a communique. Tous deux, et tous nos amis ici, nous nous rjouissons de savoir que le Service de
Protection na pas fait de difficults et que la ville de So Paulo vous aide. (MH, 2AM1M1d).
54
julie a. cavignac vibrant v.9 n.1
en pleine modernisation (Grupioni 1998, 2005). Ce sont les chercheurs
dindiens, sertanistas ou missionnaires qui sont sur le terrain et font les
premires ethnographies de contact. Le contexte historique plus gnral est
dterminant pour comprendre la singularit de lethnologie faite au Brsil
puisque celle-ci commence par ltude des populations indignes o domine
une proccupation salvationniste (Faulhaber 2005). Cest aussi lpoque de
lorganisation des premires recherches acadmiques au Muse National et
So Paulo, institutions qui inaugurent les recherches acadmiques en anthro-
pologie ; les deux expditions Lvi-Strauss de 1936 et 1938 sont replacer
dans ce contexte (Peixoto 1998).
De la mme faon, il existe des relations - pas toujours harmonieuses
- entre les institutions scientifiques trangres et leurs reprsentants ins-
talls au Brsil: H. Baldus et K. Nimuenadju arrivs comme free lance, prc-
dent les franais, sintgrent facilement aux tablissements comme le Museu
Nacional de Rio ou le Museu Paulista, ce qui ne les empchent pas dentretenir
des relations troites et non dsintresses avec les muses europens ou les
universits amricaines (Mtraux 1978). Si Baldus suit une carrire acad-
mique, Nimuenadju, lui, rassemble des objets appartenant aux populations
indiennes quil visite et les vend aux muses Allemands (Leipzig, Dresde et
Hambourg) ou Sudois (Gteborg). Les missions sont organises dans un
premier temps sous le patronage du baron Erland Nordenskild avec lequel
Rivet et Mtraux entretiennent aussi dtroites relations, ce qui aurait d faci-
liter les cooprations. Cependant, apparemment, les chercheurs ne voient pas
dun bon il larrive dun concurrent sur le terrain (Grupioni 1998). Voici ce
qucrit K. Nimuenadju propos de Lvi-Strauss quelques jours aprs la sor-
tie de larticle de 1936 sur les Bororo :
Jai vu, dabord, un article dans lEstado [de So Paulo], Avec les sauvages civi-
liss, qui ma beaucoup interess par son positionnement propos de la ques-
tion indigne. Aprs, vient sa Contribution ltude de lorganisation sociale
des Bororo, au JSA, o, en peu de pages, expose un matriel prcieux et que jai
reu comme sil avait t command. Que peut-on attendre de lui de plus dans
le futur?
32
32 Traduction de lauteure. Kurt Nimuendaju, lettre Herbert Baldus (11/11/1936). Eu vi dele,
primeiramente, um artigo no Estado [de So Paulo], Com os selvagens civilizados, que me interessou
muito pelo seu posicionamento na questo indgena. Depois vem sua Contribution ltude de lorganisation
sociale des Bororo, no JSA, onde ele, em poucas pginas, traz material muito valioso, e que chegou
55
vibrant v.9 n.1 julie a. cavignac
On peroit, au milieu des expressions admiratives, une crainte dtre
concurrenc par un jeune chercheur frachement arriv.
33
Initialement, C.
Lvi-Strauss avait le projet dengager Nimuenadju pour participer la mis-
sion de 1938, mais lethnographe allemand rcuse linvitation de ce brillant
collgue remarqu par Lowie (Lvi-Strauss 2008: XLV). En effet, Claude Lvi-
Strauss sest fait connatre par son article sur les Bororo publi en 1936 dans
le Journal: cest Mtraux, qui ne le connat pas encore personnellement, qui
envoie le texte Lowie.
Mme sils jouissent dun statut privilgi et sils sont protgs par des
accords de coopration, les franais chargs de missions au Brsil souffrent
du nationalisme ambiant de lre Vargas; ils doivent composer avec ladmi-
nistration du pays, se plier la lgislation concernant les tudes des popu-
lations indiennes et sassurer de la bienveillance des autorits locales pour
pouvoir raliser leurs recherches dans un contexte politique troubl et dans
un monde acadmique travers par dimportantes tensions (Grupioni 1998).
En effet, dans les annes trente, on trouve diffrents groupes dintellectuels
So Paulo qui se disputent le champ de la recherche anthropologique:
ceux du Museu Paulista, les chercheurs qui participent de la Sociedade de
Etnografia e Folclore (SEF), les professeurs et les tudiants de la Faculdade
de Filosofia, Cincias e Letras de lUniversit de So Paulo et de lEscola Livre de
Sociologia e Poltica de So Paulo. A lintrieur mme du groupe des mission-
naires, il existe des tensions qui se rvleront tre des discordances poli-
tiques (Lvi-Strauss 2008: 1740).
Visiblement, le couple Lvi-Strauss sest davantage senti laise aux cts
de Mrio de Andrade qui les a accueilli bras ouverts, offrant un emploi
Dina Lvi-Strauss et donnant carte blanche aux jeunes ethnographes pour
organiser les activits de recherche, les cours, les causeries et les publications
de la nouvelle Socit cre So Paulo, centre de recherche collective (qui)
para mim como se houvesse sido encomendado. O que se pode esperar dele a mais no futuro? , Kurt
Nimuendaju, lettre Herbert Baldus (11/11/ 1936), cit in: Souza et Fausto 2004 : 87.
33 Il est vrai que le chercheur allemand qui allait seul sur le terrain avait des drles de mthodes
scientifiques cautionnes par la directrice du Muse dalors, Heloisa Alberto Torres. Lors de son passage
Rio en juin 1947, A. Mtraux (1978: 206) consulte le Nimuenadju: Les dtails qui forment son journal
sont toujours les mmes: dte et heure de dpart et darrive, seins touchs et ttons presss. Il note sil a
senti le battement du coeur des petites filles quil a liebkos. Parfois il introduit un doigt dans leur vagin
ou saisit une cuisse. Il a soin de mentionner leur raction; la plupart du temps il ne trouve quindiffrence
ou complicit. Donha Heloisa est trs choque lorsque que je lui dis ne pas croire au caractre scientifique
de ces expriences.
56
julie a. cavignac vibrant v.9 n.1
repose sur la base de la coopration intellectuelle, thorique et pratique dun
grand nombre de chercheurs, sinspirant des modles europens et, en pre-
mier, de lInstitut dethnologie de luniversit de Paris dont elle [SEF] suit
attentivement les travaux et les rsultats (Lvi-Strauss 1937: 429). Ils avaient
des intrts communs, partageaient les mmes ides sur limportance du
recueil simultan des informations ethnographiques (populations indignes)
et folkloriques: il fallait faire au plus vite de la recherche de terrain avant la
disparition totale des populations mal connues, tablir une mthode de col-
lecte des faits sociaux et les systmatiser (Valentini 2010: 46). A cela sajoutait
peut-tre pour les franais, une volont de retrouver lesprit de groupe qui
animait la recherche au Muse de lHomme et une collaboration intellectuelle
inspire par une mme sensibilit artistique, des opinions politiques proches
et un mme got pour la littrature. Faisant jouer ses appuis politiques et
malgr les possibles divergences entre les chercheurs, lcrivain moderniste
intervient plusieurs reprises pour liminer les entraves bureaucratiques
rencontres lors de lorganisation des deux expditions Lvi-Strauss et ce
jusqu son dpart du Dpartement de Culture de So Paulo en 1938 (Grupioni
1998; Valentini 2010: 15-22).
34
Claude et Dina Lvi-Strauss dans leur campement (1935-36)
35
34 Mrio de Andrade, crivain moderniste, auteur de Macunama (1928) et de O turista aprendiz (1943) qui
rapportent des informations sur les populations quils rencontrent.
35 Mission 1935-36, image consultable sur: http://www.quaibranly.fr//cc/pod/resultats.aspx?b=2&t=1#
57
vibrant v.9 n.1 julie a. cavignac
Les jeunes explorateurs peuvent compter, en cas de coup dur, sur le
soutien financier de P. Rivet qui a ses entres dans les ministres; cest ce
quils font, au moins en 1938, afin de pouvoir rapatrier les objets collects.
Ils reoivent encore laide de chercheurs engags dans les activits de coo-
pration, le dveloppement des amitis franco-brsiliennes et les accords
scientifiques chapeauts par Georges Dumas (Petitjean 2001; Peixoto 1998;
Trebitsch 1995). En outre, les acteurs de la recherche amricaniste la fran-
aise appartiennent une mme famille politique: ils sont fidles une
idologie progressiste puisquils se placent dans la mouvance du socialisme
hrit du Front Populaire et, mme si cela ne transparait pas directement
dans leurs crits qui se veulent neutres et scientifiques, on peroit, dans le
choix de leurs programmes dinvestigation et dans leur posture acadmique,
quils sont nettement opposs au courant conservateur de la discipline et
au racialisme ambiant. Cest en cela quils sont les premiers questionner le
projet colonialiste dune France toute puissante (Jamin 1989b).
36
Pendant les
annes dexil, Lvi-Strauss reste attach Rivet: la correspondance entrete-
nue entre les deux hommes pendant plus de dix ans montre quil existait un
profond respect doubl de sentiments amicaux partags et, que jusqu la fin
des annes quarante, Rivet tait le directeur de thse de Lvi-Strauss. Pour
preuve, celui-ci relit les preuves du livreLes origines de l homme amricain qui
sortira en 1943, moment o ltudiant finit la rdaction de ce qui devien-
dra plus tard Les structures lmentaires de la parent:
Depuis votre dpart jai commenc, sous le coup dune inspiration subite, un
livre sur la prohibition de linceste que jai crit tout dune traite et suis en tra-
in, maintenant, de terminer. Cest un travail trs technique parce quil se fonde
sur lanalyse de systmes de parent; je crains donc que son dition soit un peu
difficile. Je crois cependant quil apporte sur un problme classique des vues
assez nouvelles et quil les pose dans des termes nouveaux.37
36 La premire critique lgard des actions menes par le gouvernement franais dans ses colonies
et des mthodes de recherche utilises est celle de Michel Leiris dans lAfrique fantme (Motta, In: Grossi
et alli. 2006 : 261-282). En un sens, les engagements politiques de Rivet, du jeune Lvi-Strauss et, dans
une moindre mesure, de Mtraux, amnent ces chercheurs prendre position dune faon critique et
diffrencie pour ce qui est de la situation coloniale; nanmoins, aprs la gnration de Mauss et de Rivet,
et surtout aprs la guerre, ces engagements sont moins marqus et les chercheurs franais hsitent
saventurer sur la scne politique, caractristique qui semble tre la marque de la discipline de la seconde
moit du XXe.sicle et peut-tre la raison principale de sa faiblesse lheure actuelle (Laurire 2008).
37 Lettre de Lvi-Strauss Rivet, 10/02/1943 (MH, 2AP1D). Voir les autres lettres du fonds Rivet (MH,
58
julie a. cavignac vibrant v.9 n.1
Pour lAmricanisme des annes 1920-1930, le Brsil demeure une Terra
Incognita et il faut investir dans la recherche de terrain, puisque les popula-
tions primitives tendent disparatre, lurgence ethnographique est dans lair
du temps (Mauss 1913; Laurire 2008). Le jeune professeur agrg de philo-
sophie et sa femme tombent pic. Ils recevront lappui inconditionnel des
grands noms de lethnologie franaise de lpoque quils iront visiter avant
dembarquer pour le premier voyage (Lvi-Strauss 2008: 243). Une fois au
Brsil, le professeur de sociologie de lUSP entretiendra une correspondance
rgulire avec ses matres, mais aussi, chacun de ses retours en France, il ira
lInstitut dEthnologie pour rendre des comptes et participer des acti-
vits scientifiques: exposition de 1936, mise en catalogue et installation de la
collection, rendez-vous de travail, runions de la Socit et causerie radiopho-
nique! (Lvi-Strauss 2008: XLV)
38
Le cas Lvi-Strauss
Pourtant, cet t de la bien mauvaise ethnographie que de rsister ce
mange, ou mme de le considrer comme une preuve de dcadence ou de mer-
cantilisme. Car sous une forme transpose, rapparaissaient ainsi des traits
spcifiques de la socit indigne: indpendance et autorit des femmes de
haute naissance; ostentation devant ltranger, et revendication de lhommage
du commun. La tenue pouvait tre fantaisiste et improvise: la conduite qui
linspirait conservait toute sa signification; il mappartenait de la rtablir dans
le contexte des institutions traditionnelles. (Lvi-Strauss 2008: 165-166)
Limportance des missions Lvi-Strauss dans le Brsil central appa-
rat nettement lorsque lon consulte les correspondances que le jeune eth-
nographe entretient avec ses partenaires du Muse de lHomme et, surtout,
lorsque lon sintresse aux Mlanges et nouvelles amricanistes du Journal
qui, pour les annes 1935-1936, sont particulirement fournies: on note
2AP1D) et du fonds Lvi-Strauss (BN, NAF 28150). La premire lettre de Lvi-Strauss Rivet date de
quelques jours avant son dpart pour le Brsil (22/12/1934) et la dernire, crite des tats-Unis, un peu
avant son retour dfinitif en France (09/03/1947). La thse est finie depuis janvier et ltudiant en poste
lAmbassade de France envoie lintroduction et le sommaire des Structures lmentaires de la parent Rivet.
38 Voir le dossier mission Lvi-Strauss (MH, 2AM1M1d) et les correspondance avec Rivet, Mauss,
Lvy-Bruhl et, plus tard, Soustelle consultables la bibliothque du MNHN.
59
vibrant v.9 n.1 julie a. cavignac
lappui inconditionnel des collgues qui suivent de prs lavancement des
travaux au Brsil et ceux-ci semblent sintgrer au projet franais qui tait de
complter les collections ethnographiques et les connaissances sur les popu-
lations indiennes de lAmrique. Selon Marcel Mauss, le jeune Lvi-Strauss
prpare un grand travail thorique sur les effets du contact des civilisations
europennes et amricaines dans lAmrique du Sud, depuis lorigine jusqu
nos jours :
Tout votre programme que vous mexposiez dans votre lettre de novembre 36
tait parfaitement juste, et si vous pouvez le reprendre, a, naturellement toute
mon approbation.
Prenez garde chercher trop du ct des Andes, et inversement, vous avez
raison dy chercher. Car tout ce que je sais de larchologie prhistorique du
Brsil, surtout du cours infrieur de lAmazone, me prouve lexistence dune
grande civilisation (illisible). Lart des terres cuites, extrmement dvelopp,
est plus parent de lAmrique Centrale que de lAmrique Pruvienne.39
Ainsi, les jeunes agrgs semblent chercher les preuves empiriques qui
devraient permettre de corroborer les thses de leurs prdcesseurs. De fait,
au niveau thorique, lhypothse culturaliste de lcole Franaise reste
dactualit nous avons not plusieurs reprises cette tendance dans les cor-
respondances de Mauss et Lvi-Straussau long de ces annes : la culture ma-
trielle devant tmoigner de la vie des socits (morale et religion) et
aider rpondre la questionde lorigine de lHomme amricain (Mauss
1967: 12; Rivet 1920). Selon cette hypothse, il y aurait un fonds culturel
unique pour toutes les socits dAmrique du Sudet linfluence culturelle
des Andes, culture suprieure aux autres, se ferait sentir dans tout le sud
du continent. Cette ide dun continuum culturel amricain sera largement
reprise dans les travaux ultrieurs de Lvi-Strauss mais, dans les premires
dcennies du XXe. sicle, la question se pose en ces termes :
Afin de rsoudre les grands problmes qui touchent lorigine de lHomme
amricain, au peuplement du Nouveau Monde et ses relations avec lAncien,
aux relations ou la pluralit dorigine des races amricaines et leur parent
ethnique, en un mot, aux questions qui embrassent le pass et le prsent du
nouveau continent, le concours de tous est ncessaire. Dans notre socit,
39 Lettre de Marcel Mauss Lvi-Strauss, 20/01/1936 (fonds Lvi-Strauss, BN, NAF 28150).
60
julie a. cavignac vibrant v.9 n.1
chacun de nous sa tche remplir et je puis dire que chacun de mes collgues
sefforce de la remplir avec conscience (Rivet, In: Actes de la Socit 1920:
210-211).
Inspirs par lhypothse diffusionniste et les ides de leurs matres sur
lorigine de lHomme amricain, les Lvi-Strauss partent sur le terrain la
recherche dune rponse sur les mouvements de population et tentent de bri-
ser le grand silence atlantique. On comprend donc pourquoi il y a tant de
rfrences ltude des langues et larchologie dans Tristes tropiques, m-
thode idale pour retrouver lorigine et lhistoire du peuplement du continent
amricain grce ltude de la distribution des objets, des techniques et des
motifs dcoratifs (Lvi-Strauss 2008: 149; 246-254; 1682).
40
Nous retiendrons deux travaux du jeune Lvi-Strauss pour montrer que
celui-ci accompagne les consignes de lcole franaise et quil est un eth-
nographe comptent : il sagit de larticle de 1936 sur les Bororo et la thse com-
plmentaire soutenue en 1948 sur les Nambikwara (Lvi-Strauss 1936, 1948).
Une sociologie du Mato Grosso
(...) sur mille, quinze cents, deux mille kilomtres parfois de profondeur, les te-
rres inaccessibles aux blancs, et que les indignes conservent comme un pauvre
et vaste patrimoine. Ces immenses rgions sont en effet leur domaine exclusif,
jusqu ce que, vers le nord, apparaissent avec les premires traces de civilisa-
tion, les chercheurs de caoutchouc du bassin du Madeira, ou de lAmazone. ()
Il sagissait la fois dtudier des populations primitives qui comptent parmi
les plus mal connues du globe, et dessayer de comprendre, par une sorte de
coupe ethnologique ralise du sud vers le nord, les relations qui ont pu exis-
ter par toute une chaine de tribus intermdiaires et ignores, entre les grou-
pements indiens bien connus du bassin de lAmazone et ceux de louest et du
sud : Bolivie, Paraguay, Brsil mridional () Ainsi des peuples dont lexistence
matrielle pourrait apparatre comme plus proche de la vie animale que de la
condition humaine, se rvlent linvestigateur attentif et cest l, en somme,
lobjet essentiel de nos travaux singulirement proches de nous par le got,
par lintelligence ou le cur.
41
40 Cest aussi la mission que Rivet avait confi Mtraux lors de lexpdition lle de Pques qui devait
trouver une explication sur lorigine de lcriture pascuane (Laurire 2008: 437-480).
41 Brsil inconnu par Claude Lvi-Strauss, radio-confrence du 03 juillet 1939 (MH, 2AM1C9e n. 122,
3 juillet 1939 dossier Lvi-Strauss). Lmission a t diffuse quatre mois aprs le retour de Lvi-Strauss
61
vibrant v.9 n.1 julie a. cavignac
Malgr la honte et le dgout que lui inspire lexercice, Lvi-Strauss
(2008: 3) racontera ses voyages en multiples occasions tout au long de sa
longue carrire, mettant en avant les difficults rencontres et confortant
limage dun intellectuel qui ddaigne le terrain. De plus, dans ces nom-
breuses publications, documentaires et reportages journalistiques qui se
proposent de faire revivre laventure brsilienne, les expditions du jeune
ethnographe tendent tre prsentes comme tant le fruit dune aventure
personnelle, o les conditions de financement, les dtails et les membres des
expditions sont passs sous silence:
M. Lvi-Strauss est agrg de philosophie, et a mme enseign pendant deux
ans aprs lagrgation dans des lyces de province. Mais, aussitt que loccasion
lui en a t donne, il a gagn le Brsil et mis profit ce sjour pour aller visiter
dans des conditions difficiles et mme risques des populations de lintrieur.
Appartenant une gnration trs voisine de la sienne, je peux dire comme
cette initiative tait alors originale: il fallait un universitaire de vingt-six ans
la plus ferme vocation pour passer sans transition des quatre annes dtudes
philosophiques un travail sur le terrain que navait pratiqu, ma connais-
sance, aucun des grands auteurs de lcole franaise (Merleau Ponty 2008: 54).
En fait, dans les deux cas, il sagit de voyages comptant sur une quipe de
spcialistes; en 1936, chez les Caduveo et les Bororo, celle-ci est rduite trois
membres (le couple Lvi-Strauss et Ren Silz, ingnieur et cartographe). Le
voyage dure un peu plus de quatre mois, ils rapportent en France 930 pices,
328 restent au Brsil. La deuxime expdition est bien plus longue,elle dure
sept mois en tout, est plus fructueuse (1505 pices dont 760 restent au Brsil)
et compte davantage de membres : Jehan Albert Vellard, mdecin et natura-
liste, Luis de Castro Faria, inspecteur zl du Service de Protection aux
Indiens et tudiant au Museu Nacional (Lvi-Strauss 2008: 1676-1686).
42
Une
fois sur le terrain, les ethnographes appliquent les mthodologies en prise
avec leur temps, encore attaches la collecte dobjet, aux techniques, aux
mesures anthropomtriques ou aux prises de sang cest ce qui explique la
en France et deux mois avant la dclaration de guerre.
42 Lorsque lon consulte les catalogues disponibles au Muse du Quai Branly, il y a quelques diffrences:
on trouve 1457 objets rpertoris dans les collections, 639 Bororo et Caduveo (1936) et 795 objets
Nambikwara (1939). (http://www.quaibranly.fr/ - collection Lvi-Strauss). On trouve de rares documents
pour cette expdition, les notes et les carnets ont t dtruits sous lOccupation (Lvi-Strauss2008 : 1587)
62
julie a. cavignac vibrant v.9 n.1
prsence du mdecin, le Pr. Vellard dans lexpdition de 1938. Cependant, ils
utilisent les technologies audiovisuelles les plus modernes et quatre films
sont rapports: deux sur le village de Nalike, un sur la vie dans un village
Bororo et sur les crmonies funraires des indiens Bororos. Les observations
sont accompagnes de notes, de dessins et de photographies.
43
Une fois de retour, il faut encore classer le matriel, dresser un catalogue
et faire les fiches: pour les deux expditions, nous trouvons 1.457 fiches r-
pertories au Muse du Quai Branly qui sont accompagnes dune reproduc-
tion photographique des objets et 223 photographies.
44
Les photos publies
en 1936 dans le Journal ont t inclues postrieurement au catalogue du muse
de lHomme.
45
Les photographies sont intgres la collection musale sous
forme de fiches cartonnes (22,5 x 29,3 cm), contenant des pastilles de cou-
leur dans la partie suprieure-gauche, contenant une indication du lieu et
une lgendesur le ct oppos indiquant la catgorisation thmatique et une
classification (types vestimentaires, techniques corporelles, ornements e ac-
cessoires, coiffures, etc. -, acquisition, habitation construction, -, religion
rites e moments funraires, magie et sorcellerie, etc. -, vie sociale danse,
-, techniques, etc.). Lorganisation interne des fiches permet linclusion dun
grand numro dinformations de diffrents types et une possible comparai-
son.
46
Les fiches sur les Bororo semblent tre les plus compltes et reoivent
un plus grand nombre de descriptions dtailles. Cette mise en fiches porte
la marque dun travail de terrain minutieux et dune rigueur mthodologique
mise luvre lors de la collecte des objets. Cest encore laboutissement de
la mission ethnographique et la fiche devient une source potentielle de re-
cherche ultrieure. Ainsi, on voit bien qu lpoque, la collection dobjets est
partie prenante de lenqute de terrain.
43 Carnet de C. Lvi-Strauss (1938) mis en ligne sur le site de la BNF: www.bnf.fr.
44 Disponible sur le site du Muse du Quai Branly http://www.quaibranly.fr (collection Lvi-Strauss).
Quelques objets sont plus facilement visibles sur la page http://www.quaibranly.fr/fr/collections/
promenades-a-la-carte/claude-levi-strauss-objets-de-la-collection.html.
45 Nous avons trouv les photographies de la Mission Dina et Claude Lvi-Strauss au Brsil et Paraguay,
novembre 1935-mars 1936 (Bororo e Caduveo). Les objets catalogus comprennent aussi lautre mission
de 1938 et prsentent une grande diversit dobjets Nambikwara, Tupi-kawahiw, Kaingan, Kaingangue et
Bororo qui semblent dominer en numro.
46 Sur plusieurs fiches, les commentaires font directement rfrence Tristes tropiques ou incluent une
citation du livre, ce qui laisse penser quun partie au moins des fiches ont t tablies aprs la publication de
ce livre, en 1955. Toutefois, vu la richesse des dtails contenus dans les fiches il est possible que Lvi-Strauss
en personne ait supervis directement lorganisation des fiches ou les ait labores (Lvi-Strauss 2008).
63
vibrant v.9 n.1 julie a. cavignac
Vido: http://www.ina.fr/art-et-culture/musees-et-expositions/video/
I04209425/claude-levi-strauss-a-propos-du-musee-de-l-homme.fr.html
47
De fait, les cours donns la Sociedade de Etnografia e Folclore par Dina
Lvi-Strauss et le premier volume dInstructions pratiques pour les recherches
danthropologie physique et culturelle publies en 1936, prouve que le programme
de Mauss est appliqu la lettre(Lvi-Strauss D. 1936). La publication est divi-
se en deux parties: la premire consiste en la description des techniques
denqute et du matriel, la deuxime aborde les questions danthropologie
physique.
48
Dina tait responsable de lorganisation du matriel de la SEF et
il est probable quelle se soit charge dune bonne partie de la classification
du matriel rapport lors des deux expditions (Peixoto 1998 ; Valentini 2010:
44-60). Mais il est difficile de savoir comment le travail a t partag entre les
deux chercheurs puisquil nen est rest aucune trace crite. De toute faon, les
jeunes professeurs suivent de prs les conseils que Marcel Mauss dispense
ses lves qui frquentent son cours lInstitut dethnologie intitul Petites
instructions dethnographie descriptive dans lequel le Professeur insiste sur
limportance de la culture matrielle, des techniques, de lorganisation sociale,
de la vie rituelle, morale et religieuse, etc. Ltude dune socit doit suivre un
plan strict: dabord la description de la morphologie sociale qui comprend la
dmographie, la gographie humaine et la techno-morphologie, puis vient
la physiologie (les techniques, lesthtique, lconomie, le droit, la religion, la
47 Claude lvi Strauss, propos du muse de lhomme, caractres - 11/10/1991.
48 Le deuxime volume qui devait tre consacr lanthropologie culturelle ne verra jamais le jour.
64
julie a. cavignac vibrant v.9 n.1
science), enfin les phnomnes gnraux comme la langue, les phnomnes
nationaux, internationaux et lethologie collective. Ces directives vont se re-
trouver dans les crits de lpoque qui sont essentiellement descriptives mais
qui annoncent dj les travaux ultrieurs.
Larticle sur les Bororo est intressant car il est mi-chemin entre le rap-
port de mission et lesquisse dune monographie classique o apparaissent dj
tous les lments ncessaires la description ethnographique. Lessai laisse une
large part aux productions matrielles : le texte commence par la description
de la structure du village, puis porte sur les questions relatives lorganisation
conomique, aux unions prfrentielles, aux lois (privilges et obligation des
clans), aux expressions concrtes de la structure sociale, aux techniques et la
division du travail (Lvi-Strauss 1936). Lauteur passe en revue les aspects de la
morphologie sociale, la division sexuelle du travail entre homme et femmes,
les types physiques, les dcorations corporelles (peintures, pendants doreilles,
de nez et de lvres, diadmes, coiffures, vtements, tuis pniens). Il fait aussi
une part importante au rituel, laissant les aspects religieux pour la fin, et dcrit
une crmonie funraire laquelle il a assist (mariddo), faisant linventaire
des objets rituels- Bull-Roarer (aite), arc dapparat et de crmonies.
Lvi-Strauss dmontre dans ce premier article que la vie matrielle et
lorganisation spatiale refltent lorganisation sociale. Cette dmonstration
est faite partir dune description minutieuse de la dcoration des arcs et des
flches qui correspondent aux diffrents clans.
Arc dapparat
49
49 Image tire de larticle de C. Lvi-Strauss (1936), disponible sur le site du Journal : http://www.
persee.fr/web/revues/home/prescript/article/jsa_0037-9174_1936_num_28_2_1942#. Dautres photos
65
vibrant v.9 n.1 julie a. cavignac
On peut penser que les jeunes chercheurs suivent les conseils de Marcel
Mauss pour la collecte des objets puisquil sagit dtablir les archives mat-
riels dune socit: premirement il faut tablir un inventaire gnral qui
doit tre accompagn de fiches descriptives o sont annotes la localisation
prcise du lieu de la collecte, les usages et la fabrication de lobjet, de dessins,
de photographies e/ou de films (Mauss 1967: 14). Par la mme occasion, leth-
nographe doit observer les techniques:
Un dessin sera joint chaque fois quil faudra montrer le maniement de lobjet,
un mouvement de la main ou du pied (exemple : pour larc et les flches, il est
important de fixer la mthode de lancement par la position des bras, des doigts
aux divers moments ; le mtier tisser est incomprhensible sans documents
montrant son fonctionnement (Mauss 1967: 17).
Carnet de C. Lvi-Strauss (1938)
50
Photographie de C. Lvi-Strauss, Muse du Quai
Branly
51
Les rsultats scientifiques de cette expdition sont salus par les plus
grands spcialistes de lpoque, notamment A. Lowie, ouvrant la voie de fu-
tures dcouvertes portant sur lorganisation sociale des peuples de la fort
52
:
et fiches catalographiques de la mission peuvent tre visionnes sur le site http://www.scalarchives.
com/web/ricerca_risultati.asp?nRisPag=24&prmset=on&SC_PROV=COLL&IdCollection=79362&SC_
Lang=eng&Sort=9&luce= .
50 Bibliothque Nationale, manuscrits, :NAF28150 <http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ead.html?id=FR
BNFEAD000013407&c=FRBNFEAD000013407_e0000013&qid=sdx_q26>
51 Brsil, Population bororo, 17,6 X 23,2 cm, PP0002058, disponible sur http://www.quaibranly.fr/fr/
collections/promenades-a-la-carte/claude-levi-strauss-photographies-de-mission.html.
52 Voir la correspondance de Mtraux Lvi-Strauss aprs lenvoi de larticle Lowie (15/11/1936) : Je tiens
vous fliciter pour cette monographie qui est sans aucun doute une des plus importantes qui aient paru
sur une tribu sud-amricaine au cours de ces dix dernires annes. Enfin peut-tre commencerons-nous
66
julie a. cavignac vibrant v.9 n.1
Sociologiquement, les rsultats de toutes ces expditions ont t considrables,
car elles ont rvl une complexit extraordinaire de lorganisation sociale: phra-
tries exogamiques, clans, groupes sportifs se recoupant lextrme, aboutissant
une complication qui na rien envier celle de nos socits. Gographiquement,
le sjour de Lvi-Strauss chez les Bororos a permis la description prcise de leur
genre de vie: la pche et la chasse restent lessentiel, mais la rarfaction du gibier
favorise lagriculture; celle-ci entirement confie aux femmes est limite la cul-
ture sur brlis du riz, du mas du manioc et du tabac. () Le village, tabli dans
une clairire de la fort, sur les bords du Rio Vermelho, a une structure morpho-
logique qui traduit lorganisation sociale: les maisons sont distribues autour un
grand cercle dont le centre est occup par la maison des hommes construite
sur un axe N-S une ligne OSO-ENE divise le village en deux parties gales, chacu-
ne correspondant une phratrie; un second axe perpendiculaire au premier le di-
vise de nouveau en deux moitis: celle de ceux de lamont et celle de ceux de
laval, de faon que chacune de ces moitis comprend des maisons appartenant
lune et lautre des phratries. Cet exemple suffit faire comprendre les infinies
complications des institutions des Bororos. (Monbeig 1939: 444-445)
Cest dans cet article que le plan du village bororo (aldeia Kejara) est publi
pour la premire fois: les clans et les lignages sont dcrits grce lanalyse de
la disposition des maisons, de la terminologie de la parent et des arcs dcors
aux couleurs de chaque section. Il sagit donc dun exercice dapplication des
ides de Marcel Mauss pour lequel les reprsentations collectives et la culture
seraient inscrites dans la vie matrielle des socits (Mauss 1967: 14-21).
Lauteur termine par une rflexion sur le dualisme, thme qui sera repris
dans les rflexions postrieures et qui annonce le structuralisme, thorie dj
prsente dans la thse principale du thsard. Enfin, loccasion de ce premier
article scientifique, Lvi-Strauss inaugure ses analyses dans le domaine du
totmisme, propos de la notion darchasme et surtout pour les tudes sur
la parent, rflexion initiale quil prolongera dans son uvre majeure, Les
Structures lmentaires de la parent(1949) (Souza & Fausto 2004).
53
savoir quelque chose au sujet de lorganisation sociale des indignes de ce continent . La rponse de
Lowie Lvi-Strauss ne tarde pas (16/08/1937) : Through our friend, Dr. A. Mtraux, Who is spending
this semester at the University as Lecturer, I have learned your adress. This gives me an opportunity to
tell you directly how very favorably I was impressed with your article on the Bororo. I also gather that you
have arrived at very much the same conclusions as myself concerning the relations of Bororo society to
that of the G tribes. (fonds Lvi-Strauss, BN, NAF 28150).
53 Alors que Rivet tait initialement le directeur de thse de Lvi-Strauss, de retour en France,
67
vibrant v.9 n.1 julie a. cavignac
Planche VIII. Le village attendant une crmonie. Bororo (1936)54
A son retour en France, Lvi-Strauss prsente les rsultats de sa mis-
sion: il fait une confrence et organise une exposition remarque. Lors de la
scance de la Socit du 12 janvier 1937, Claude Lvi-Strauss fait une communi-
cation accompagne de projections, occasion o il fait un compte rendu
de la mission au Matto Grosso, novembre 1935-mars 1936 qui sera prsent
par Paul Rivet; celui-ci souligne lintrt de la mission quil vient daccom-
plir chez les Kaduveo et les Bororo. Il fait part la Socit du projet de mis-
sion qui doit runir pendant un an dans la sierra dos Parecis, M. et Mme.
Claude Lvi-Strauss, le Dr. Vellard et M. Curt Nimuendaj (Actes1937).
Lexposition ralise la Galerie Wildenstein Paris en 1937, a t organise
avec lappui de Georges-Henri Rivire (Lvi-Strauss & ribon 1988: 30). Cest
encore Paul Rivet qui crit lintroduction du Guide catalogue de lexposi-
tion organise la galerie de la Gazette des beaux-arts et de Beaux-Arts
(Bulletin 1988 : 277) :
celui-ci soutient sa thse complmentaire avec Marcel Griaule en 1948 (La vie familiale et sociale des indiens
Nambikwara) et sa thse de doctorat s Lettres avec Georges Davy (Les structures lmentaires de la parent).
Nous navons pas trouv les raisons pour lesquelles ce changement de directeur de thse a eu lieu, dautant
que Rivet et Griaule ne sapprciaient gure. Il est vrai qu lpoque Rivet semble davantage absorb par
ses activits politiques, qui lobligent voyager souvent ltranger, que par ses activits acadmiques.
En outre, cette mme anne, lhomme politique souffre dune campagne de diffamation (Laurire 2008:
354-355; 640-641).
54 Disponible sur le site de Perse <http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/jsa_0037-
9174_1936_num_28_2_1942>
68
julie a. cavignac vibrant v.9 n.1
Pendant quatre mois, Mr. et Mme Lvi-Strauss ont sjourn au milieu des
Indiens Kaduveo et Bororo, populations profondment diffrentes par la lan-
gue et la culture, mais dont limportance pour lethnographie amricaine, est
de tout premier plan. La mission que le Gouvernement franais avait confi
M. et Mme. Lvi-Strauss sest trouve double dune mission du gouvernement
de lEtat de So Paulo et du Dpartement de Culture de la municipalit de So
Paulo. Nous tenons exprimer cette occasion notre reconnaissance aux au-
torits paulistes, ainsi quau Muse National de Rio de Janeiro, qui avait bien
voulu accorder son patronage scientifique lexpdition. Cette collaboration
entre les deux pays est un nouveau tmoignage que nous enregistrons avec
joie des liens intellectuels qui unissent la France et le Brsil, et dont les jeunes
universits de So Paulo et de Rio de Janeiro sont les vivants symboles.
Il est donc bien spcifi que cette premire exprience de recherche
de terrain au Brsil est dabord finance par la France et si lexpdition a
reu des fonds complmentaires de la municipalit de So Paulo, le Muse
National sest content de donner une caution scientifique. Nanmoins,
Paul Rivet insiste sur la collaboration franco-brsilienne qui sannonce fruc-
tueusepuisquun projet dune nouvelle expdition est dj en marche.
Enfin, cet article de jeunesse ouvre la discussion anthropologique des
problmes qui seront repris dans son uvre de maturit et montre des qua-
lits descriptives de lauteur qui ont t sous-estimes. Bizarrement, leth-
nographe a t oubli et ce sont les photographies de Lvi-Strauss qui sont
passes la postrit, ayant connu une vie propre aprs avoir t sorties des
collections du muse. Tristes tropiques, publi en 1955, connat le mme sort
que les photographies, et sera victime de son succs en librairie puisque cet
ouvrage nest pas considr par son propre auteur comme tant vritable-
ment de lanthropologie.
Le spcialiste Nambikwara
() Mon tude sur lorganisation sociale des Nambikwara est termine et la tra-
duction anglaise le sera dans quelques jours. Cest un assez gros travail (deux
cents pages dactylographies) et qui apporte, je crois, pas mal de choses nou-
velles sur la sociologie sud-amricaine. Comme je considre les Nambikwara
comme une culture affinit trs septentrionale, je suis trs anxieux de
connatre les premiers rsultats des enqutes qui vont tre faites sous votre
69
vibrant v.9 n.1 julie a. cavignac
direction en Colombie. Je mets en ce moment au point une mthode presque
mcanique (fonde sur certains principes lmentaires de la logique mathma-
tique) qui doit permettre de reconstruire des systmes de parent sur la base
denqutes faites par des non-spcialistes, pourvu quelles soient consciencieu-
ses et se conforment quelques instructions trs simples. Si lapplication de
cette mthode par vos tudiants travaillant sur le terrain pouvait vous intres-
ser, je vous en parlerais plus largement et mettrais Lehman au courant pendant
son sjour ici, qui sera vraisemblablement court. (...)
55
La mission de 1938, pour laquelle nous avons davantage de dtails, dis-
pose de moyens financiers plus importants et apparat comme tant un des
premires exprience de coopration scientifique entre la France et le Brsil.
La professionnalisation du travail de terrain dcoule de la bonne rception
des rsultats publis en 1936. On se limitera ici rappeler les principaux
thmes abords dans ltude des Nambikwara qui est une annonce de la tho-
rie venir. Le long article paru en 1948 est en effet centr sur les questions de
lanthropologie alors en vogue, la parent et les systmes de chefferie.
Itinraire de laMission Lvi-Strauss-Vellard
56
55 Extrait dune lettre de C. Lvi-Strauss P. Rivet, le 11/09/41 (fonds Lvi-Strauss, BN, NAF 28150).
56 Dina Lvi-Strauss 1938: 395. (Disponible sur http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/
jsa_0037-9174_1938_num_30_2_1982_t1_0384_0000_2. ).
70
julie a. cavignac vibrant v.9 n.1
La mission de 1938 vient confirmer lexprience de lethnographe dj
reconnu parmi les spcialistes de la question, dans une lettre Mrio de
Andrade date de 1938, il signale limportance des dcouvertes:
Quant au voyage, il a t long et difficile. Mais je noublierai jamais ces huit
mois; ils ont t remplis dexpriences passionnantes. Scientifiquement par-
lant, nous rapportons, je crois, un beau matriel et beaucoup de nouveau. De
quoi modifier profondment les connaissances actuelles. Sincrement, je pen-
se que lexpdition fera dte.
57
Nanmoins, les tracasseries administratives et les problmes rencontrs
sur le terrain, notamment dordre financier, rduisent la dure de lexpdi-
tion. On comprend alors lagacement de C. Lvi-Strauss qui se voit oblig
dinclure L. C. Farias son quipe.
La Vie familiale et sociale des indiens Nambikwara adopte le mme style mo-
nographique que larticle sur les Bororos. Il parat dix ans aprs la fin de lex-
pdition comme supplment du Journal; cest le fruit dune rflexion et dune
lecture attentive des travaux raliss sur la parent. Cette monographie clas-
sique est divise en deux parties : la vie familiale et la vie sociale. On y devine
le thoricien qui sappuie sur des observations ethnographiques recueillies
par ses soins :
Nous avons cherch des informations linguistiques plus tendues et plus pr-
cises; prt plus dattention laspect dynamique de la culture matrielle, en
considrant moins les objets achevs que le processus de leur fabrication; et
surtout, nous nous sommes largement consacrs ltude de lorganisation
familiale et sociale, dont la description fait lobjet du prsent travail (Lvi-
Strauss 1948: 3).
La vie familiale, ouvrage destin un public de spcialistes, est une r-
flexion davantage mrie et beaucoup plus technique pour ne pas dire sche
- que larticle crit en 1936 puisque la thse complmentaire sera publie prs
de dix ans aprs la recherche de terrain et que le texte sera repris maintes
fois ; cest une version remodele de larticle publi dans le Handbook et de
57 Lettre de Lvi-Strauss Mrio de Andrade (fonds Lvi-Strauss, BN, NAF 28150). Il ne semble pas
ncessaire de revenir sur lexpdition dune manire dtaille et les rsultats scientifiques, sachant la
somme des publications ce sujet.
71
vibrant v.9 n.1 julie a. cavignac
grandes parties seront retrancrites, en 1955, dans Tristes Tropiques.
58
La mono-
graphie, centre sur la parent et la structure politique, adopte le style sobre
qui marquera lcriture lvistraussienne dans sa thse Les structures lmen-
taires de la parent. On y trouve ltude systmatique des rgles de rsidence
et de mariage, la description et la distribution des diffrents groupes en pr-
sence et lanalyse fine des relations interpersonnelles partir de ltude de la
nomenclature des termes de parent. Mais aussi, en suivant lesprit maussien,
et toujours partir de ltude de la langue, Lvi-Strauss propose une rflexion
sur la sorcellerie et le rapport des Nambikwara au surnaturel, annonant dj
des thmes qui seront dvelopps ultrieurement. Cest une analyse labore,
adoptant un style caractristique propre lauteur qui allie rflexions tho-
riques et runit, pour ses dmonstrations, une somme importante dinforma-
tions empiriques.
Nanmoins, l encore, llve de Rivet narrive pas se dtacher totale-
ment des prmices de son enqute et termine sa rflexion en revenant la
question de la distribution des cultures et de limportance de la langue et de
la culture matrielle (Lvi-Strauss 1948: 129-130):
Quand on se place au point de vue gographique, lnonc du problme se re-
constitue aisment. On se demandera comment il convient dinterprter la
prsence dun noyau de basses cultures plac dans une position symtrique,
par rapport aux affluents de la rive droite de lAmazone, celui qui occupait, et
occupe encore, lest brsilien. Sous les deux ailes de ce que dessine la distri-
bution des cultures incomparablement plus volues de la valle de lAmazone
et du Madeira avec la large zone verticale qui stend du Xingu aux Tocantins,
les bas niveaux G lest, et les Nambikwara louest, se font quilibre, comme
des lots isols. Dans le cas des Nambikwara, un problme supplmentaire se
pose : celui de la dualit de leur culture et de leur genre de vie; celle-ci peut tre
explique, soit en prenant pour base la forme la plus lmentaire dadaptation,
et en assumant lemprunt de la vie agricole des groupes de culture plus vo-
lue, soit, en partant de la forme suprieure, comme un appauvrissement
dtermin par lisolement culturel, ou par le refoulement dans des rgions
particulirement inhospitalires qui auraient impos des formes secondai-
res dadaptation. Mais cest seulement en faisant appel toutes les sources
58 Claude Lvi-Strauss: The Nambiquara. Steward, J. (Ed). Handbook of South American Indians, New York,
Cooper Square. 1948, v. 3, p. 361-369, Smithsonian Instituition, Bureau of American Ethnology, 134.
72
julie a. cavignac vibrant v.9 n.1
dinformation disponibles, et qui doivent comprendre, outre les donnes socio-
logiques, ltude de la langue et celle de la culture matrielle, et par une compa-
raison avec les groupes vivant dans le mme milieu gographique, quun effort
dinterprtation de ces problmes pourra tre raisonnablement entrepris.
Le changement de perspective et de paradigme dans les recherches amri-
canistes en Amazonie a t gradatif car lide de faire linventaire des cultures
peut tre retrouve jusque dans les annes 1950. Rapidement, les recherches
iront se spcialiser, avec une phase dinternationalisation de la connais-
sance anthropologique sur le continent amricain. Le rapprochement entre
les chercheurs franais, brsiliens et nord-amricains, notamment dans les
annes prcdant la Seconde guerre mondiale, laisse apparatre que les ides
thoriques se transforment rapidement en action et visent la lutte contre
le racisme. Cette tendance se refltera en partie, la Libration, avec la cra-
tion de lUnesco qui compte parmi ses membres fondateurs et ses militants
les mmes acteurs qui ont particip la fondation du Muse de lHomme; le
centre des attentions se dplace nanmoins des populations indignes vers
les afro-descendants, avec les enqutes sur le racisme et les religions afri-
caines. Mais ds le milieu des annes 1920 et surtout dans les annes trente,
dans un contexte politique favorable de nouvelles entreprises populaires et
ducatives, on assiste des tentatives de rapprochement entre la France et le
Brsil sur le plan de la coopration scientifique, notamment dans le champ
des sciences humaines (PetitJean 2001). Ainsi, mme si limportance tho-
rique des tudes sur les socits amazoniennes pour lanthropologie contem-
poraine apparat aujourdhui comme une vidence, il est intressant de noter
quelle a t le fruit dune rflexion concerte luvre de jeunesse et la cor-
respondance de Claude Lvi-Strauss nous rvle comment il sest peu peu
loign du projet intellectuel dans lequel il sinscrivait au dbut de sa carrire
et qui tait avant tout descriptif. Il explique aussi comment il a pris son envol
thorique la fin de son sjour aux tats-Unis, sans toutefois renoncer tout
fait un engagement intellectuel marqu la fois par les ides du socialisme
et la perspective culturaliste ayant un caractre encyclopdiste; aventure
laquelle il a particip en crivant plusieurs articles pour le Handbook of South
American Indians et qui se prolongera, dune certaine manire, avec lintrt
quil portera au patrimoine culturel lUnesco.
73
vibrant v.9 n.1 julie a. cavignac
Vido: http://www.ina.fr/video/AFE02015178/ouverture-de-la-conference-de-l-
unesco-1.fr.html
59
Laventure amricaine
Finalement, jai t cas aux Nations Unies, dans la division Etudes et
Recherches qui soccupe de projets scientifiques et voil comment je suis deve-
nu fonctionnaire. () pour linstant je dois dire adieu aux Igarap, aux Ngres
et aux Indiens, ce qui me laisse un got de cendre dans la bouche et une cons-
cience lourdement charge. Mon sentiment de culpabilit sen trouve trs con-
sidrablement accru.
60
De fait, les rsultats de cette entreprise sont visibles travers lanalyse des
documents darchives, du matriel utilis pour les expositions et des publi-
cations consacres aux populations indignes en particulier celles parues
dans le Journal et, aux tats-Unis, dans le Handbook: la collaboration entre
A. Mtraux et Lvi-Strauss sera dcisive pour la russite de cette uvre car,
59 Extrait du discours douverture de la confrence de LUNESCO par Lon BLum 1, 01/01/1946 -
01min22s. On peut retrouver le Discours de M. Lon Blum prononc le 1er novembre 1945, Londres la
Confrence constitutive de lUNESCO sur le site http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/L._BLUM_1945.
pdf. Il nest pas surprennant quau lendemain de la guerre, Lon Blum qui a t dport Buchenwald en
1943, puis rhabilit et dirigeant le gouvernement provisoire pendant quelques mois, soit nomm chef
de la dlgation franaise et prsident de la confrence constitutive de lUnesco (1946). On retrouve les
mmes idaux qui ont anim les intellectuels du Muse de lHomme : une coopration culturelle entre
les Peuples, la libre circulation des ides, lducation et la culture devraient oeuvrer la paix mondiale.
60 Lettre de Mtraux Verger (05/07/1946) in: Mtraux, Alfred; VERGER, Pierre. 1993. Le pied ltrier.
Correspondances, Paris, Ed. J-M Place, cahiers de Gradhiva 22: 71.
74
julie a. cavignac vibrant v.9 n.1
lpoque, ils sont tenus comme dminents spcialistes, reconnus pour avoir
une bonne exprience du terrain (Cohen-Solal 1999: 24; Laurire 2008: 517).
Ironie du sort pour celui dont le nom est pass la postrit comme celui
dun thoricien ddaignant la recherche de terrain; serait-ce une stratgie
pour asseoir une renomme et se construire un nomdans le monde acad-
mique ? Enfin, il est intressant de noter labandon progressif de lintrt
port la culture matrielle dans les travaux descriptifs de laprs la deu-
xime guerre: leffort de la France est centr sur la reconstruction du pays,
se voit menace de la perte de ses colonies et de son influence extrieure. La
direction thorique et politique de la discipline est donne par les pays anglo-
saxons et le combat contre le racisme rassemble les chercheurs qui diversi-
fient leurs destinations ethnographiques.
Au del de lintrt dun tel questionnement pour comprendre lhistoire de
lAmricanisme, cette rflexion nous amne repenser la place rserve lob-
jet ethnographique musologis dans la discipline. Les tentatives de collabo-
ration entre les quipes franaises et allemandes reprsentes par Nimuenadju
et H. Baldus, vont se concrtiser pendant la Seconde guerre mondiale avec
lentreprise du Handbook qui, dune certaine faon, dpasse les frontires na-
tionales et transcende les contextes de recherche, rassemble les spcialistes de
lpoque, offre une certaine homognit aux travaux amricanistes et permet
une comparaison systmatique entre les diffrentes socits dcrites.
61
Lorsque lon met en perspective les recherches ethnographiques ralises
lpoque, les sources documentaires trouves dans les archives et les pro-
grammes thoriques des coles en formation, on se rend compte quil existait
des projets labors depuis la France qui se voulaient rsolument interna-
tionalistes. Au moment de la guerre, la France perd de sa puissance cono-
mique, lanthropologie produite en Europe devant repartir sur de nouvelles
bases. Nanmoins, la France narrive pas concurrencer les organismes de re-
cherche nord-amricains dots dimportants moyens financiers, la recherche
ethnographique amricaniste change de camp. En tournant notre regard vers
les institutions, les programmes et les agents de la recherche amricaniste
franais au dbut du XXme sicle en particulier grce lanalyse des ar-
ticles du Journal et des documents administratifs, nous avons dcouvert quil
61 Nimuendaju publie dans diffrentes revues: Zeitschrift fr Ethnologie, Petermanns Geographische
Mitteilungen, Anthropos et le Journal avant dtre sollicit par Lowie et Mtraux (Faulhaber 2008).
75
vibrant v.9 n.1 julie a. cavignac
existait des liens importants entre la France et le Brsil avant le dbut des
hostilits. Nous avons aussi abord la question de la politique extrieure fran-
aise en matire dducation et de culture (Service des uvres franaises) en
particulier en portant notre intrt sur les objectifs des missions franaises et
la recherche anthropologique mene au Brsil.
De fait, la consultation des documents administratifs portant sur le
fonctionnement du Muse de lHomme et le financement des missions de
recherche ont t utiles pour dmontrer que la venue de C. Lvi-Strauss au
Brsil faisait partie dun plan institutionnel dexpansion des activits de
recherche, un moment o, en France, lethnologie joui dappuis et de finan-
cements. Finalement, lexamen du projet et de la mthode qui sous-tend la
constitution des collections ethnographiques montre limportance attribue
la culture matrielle au dbut de linstitutionnalisation de la discipline, en
particulier pour ce qui est de description des premires recherches ethnogra-
phiques et des moyens thoriques mis en uvre pour lanalyse des socits
indignes de la fort. Peu peu, le paradigme culturaliste franais qui faisait
la part belle la culture matrielle sera remplac par lanalyse de la structure
sociale et des relations de parent, des structures de pouvoir, abandonnant
les objets collects par les missions scientifiques aux muses, aux curieux et
aux amateurs dart.
Rfrences bibliographiques
actes de la socit. 1920. Sance du 9 novembre 1920, sous la prsidence
de M. Verneaud, vice-prsident. Journal de la Socit des Amricanistes, 12:
218-224.
actes de la socit. 1937. Sance du 12 janvier 1937, sous la prsidence de M.
Paul Rivet, prsident. Journal de la Socit des Amricanistes, 29(1): 216-217.
bulletin du muse dethnographie du trocadro . 1988. Les
cahiers de Gradhiva, 9 (dition fac simile). Paris: Jean-Michel Place.
bossert, Federico; villar, Diego. 2007. La etnologa chiriguano de Alfred
Mtraux. Journal de la Socit des Amricanistes, 93(1):127-166.
castro, Eduardo Viveiros de. 1992. O campo na selva, visto da praia. Estudos
Histricos, 5(10): 170-190.
castro, Eduardo Viveiros de. 1999. Etnologia brasileira. In: S. Miceli (org.),
O que ler na cincia social brasileira (1970-1995), vol. 1, antropologia. So
76
julie a. cavignac vibrant v.9 n.1
Paulo: Anpocs/ Sumar. pp. 109-223.
cohen-solal, Annie. 1999. Claude Lvi-Strauss aux tats-Unis: des portes
donnant accs dautres mondes et tous les temps. Revue Critique, LV (620-
621): 13-25.
copans, Jean. 1999. uvre secrte ou uvre publique. Les crits politiques de
Marcel Mauss. LHomme, 150: 217-220.
cunha, Manuela Carneiro da (org.). 2009. Tastevin, Parissier. Fonte sobre
ndios e seringueiros do Alto Juru. Rio de Janeiro: Museu do ndio/
FUNAI. Srie Monografias.
descola, Philippe; taylor, Anne Christine. 1993. Introduction. In: P.
Descola; A, C. Taylor (eds.), La remonte de lAmazone: Anthropologie et
histoires des socits amazoniennes, LHomme, 33(126-128): 13-24.
dias, Nlia. 1991. Le muse dethnographie du Trocadro (1878-1908).
Anthropologie et musologie en France. Paris: ditions du CNRS.
fabre, Daniel. 1997. Lethnologie franaise la croise des engagements (1940-
1945) . In: Jean-Yves Boursier (org.), Rsistants et rsistance. Paris:
LHarmattan. pp. 319-400.
faulhaber, Priscila. 1997. Nos varadouros das representaes: redes
etnogrficas na Amaznia no incio do sc. XX. Revista de Antropologia,
40(2): 101-145.
faulhaber, Priscila. 2005. O etngrafo e seus outros: informantes ou detentores
de conhecimento especializado?. Revista Estudos Histricos, 2(36): 111-129.
faulhaber, Priscila. 2008. Etnografia na Amaznia e traduo cultural:
comparando Constant Tastevin e Curt Nimuendaju. Bol. Mus. Para. Emilio
Goeldi Cienc. Hum, 3(1): 15-29.
faulhaber, Priscila. ; monserrat, Ruth (org.). 2008. Tastevin e a
etnografia indgena. Rio de Janeiro: Museu do ndio, FUNAI. Srie
Monografias.
fournier, Marcel. 1994. Marcel Mauss. Paris: Fayard.
grognet, Fabrice. 2005. Objets de muse, navez-vous donc quune vie? .
Gradhiva, 2. Disponible sur: <http://gradhiva.revues.org/473>
grossi, Miriam; MOTTA, Antonio; CAVIGNAC, Julie (orgs.), Antropologia
francesa no sculo XX. Recife: Editora Massangana.
grupioni, Lus Donisete Benzi. 1998. Colees e expedies vigiadas: os
etnlogos no Conselho de fiscalizao das expedies artsticas e cientficas no
Brasil. So Paulo: Hucitec/ ANPOCS.
77
vibrant v.9 n.1 julie a. cavignac
grupioni, Lus Donisete Benzi. 2005. Claude Lvi-Strauss parmi les
amrindiens. In: Grupioni, Lus Donisete Benzi. Brsil indien, les arts des
amrindiens du Brsil. Paris: Runion des Muses Nationaux. pp. 312-334.
hamy, Ernest-Thodore. 1890. Les origines du Muse dEthnographie. Paris:
Leroux (Histoire et documents).
harcourt, Raoul d. 1958. Ncrologie de Paul Rivet, 1876-1958. Journal de la
Socit des Amricanistes, 47: 6-20.
jamin, Jean. 1985.Les objets ethnographiques sont-ils des choses perdues? . In:
Jacques Hainard; Roland Kaehr (ds.), Temps perdu, temps retrouv.
Voir les choses du pass au prsent. Neuchtel: Muse dEthnographie.
pp. 51-74.
jamin, Jean. 1988. Tout tait ftiche, tout devint totem. Prface la rdition
du Bulletin du muse dethnographie du Trocadro.Les Cahiers de
Gradhiva, 9: ix-xxii. Paris: Jean-Michel Place.
jamin, Jean. 1989a. Le savant et le politique: Paul Rivet (1876-1958) . Bulletins
et Mmoires de la Socit dAnthropologie de Paris, 1(3-4): 277-294.
jamin, Jean. 1989b. Le Muse dEthnographie en 1930: lethnologie comme science
et comme politique. In: JAMIN, Jean. La musologie selon Georges-Henri
Rivire. Paris: Dunod. pp. 110-121
laurire, Christine. 2005. Dune le lautre: Alfred Mtraux en Hati.
Gradhiva, Hati et lanthropologie, n.s., 1: 181-208.
laurire, Christine. 2008. Paul Rivet (1876-1958). Le savant et le politique.
Paris: Publications Scientifiques du Musum National dHistoire
Naturelle. Coll. Archives.
laurire, Christine. 2009. La Socit des Amricanistes de Paris: une
socit savante au service de lamricanisme. Journal de la Socit des
Amricanistes, 95(2): 93-115.
lefebvre, Jean-Paul. 1990. Les professeurs franais des missions universitaires
au Brsil (1934-1944). Cahiers du Brsil Contemporain, 12: 35-54.
lestoile, Benot de. 2007. Le got des autres, de lexposition coloniale aux arts
premiers. Paris: Flammarion.
lvi-strauss, Claude. 1936. Contribution ltude de lorganisation sociale
des Indiens Bororo. Journal de la Socit des Amricanistes, 28(2): 269-304
Disponible sur. (http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/
jsa_0037-9174_1936_num_28_2_1942)
lvi-strauss, Claude. 1948. La vie familiale et sociale des Indiens
78
julie a. cavignac vibrant v.9 n.1
Nambikwara. Journal de la Socit des Amricanistes, 37(1): 1-32.
Disponible sur: (http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/
jsa_0037-9174_1948_num_37_1_2366)
lvi-strauss, Claude. 2008 [1955]. uvres. Paris: Gallimard. Coll. La
Pliade.
lvi-strauss, Claude. ; Eribon, Didier. 1988. De prs et de loin. Paris: Odile
Jacob.
lvi-strauss, Dina. 1936. Instrues prticas para pesquisas de antropologia
fsica e cultural. So Paulo: Direo do Departamento Municipal de
Cultura, VII.
lvi-strauss, Dina. 1938. Mission Lvi-Strauss-Vellard (1938-1939). Journal
de la Socit des Amricanistes, 30(2): 384386.
lvi-strauss, Dina. 1937. Socit dEthnographie et de Folklore de So Paulo
(Brsil) . Journal de la Socit des Amricanistes, 29(2): 429 - 431
mauss, Marcel. 1913. Lethnographie en France et ltranger. Revue de Paris,
20: 537-560.
mauss, Marcel. 1967 [1947]. Manuel dethnographie. Paris: Payot.
Mlanges et nouvelles amricanistes. 1935. Journal de la Socit
des Amricanistes, 27(1): 255-263; 27(2): 465-480.
Mlanges et nouvelles amricanistes. 1936. Journal de la
Socit des Amricanistes, 28(1): 253-268; 28(2): 397-422.
mtraux, Alfred. 1961.Les Origines de l homme amricain et les deuximes
rencontres intellectuelles de So Paulo.Journal de la Socit des
Amricanistes, 50(1): 247-250. (Disponible sur: http://www.persee.fr/web/
revues/home/prescript/article/jsa_0037-9174_1961_num_50_1_3791)
mtraux, Alfred. 1978. Itinraires 1 (1935-1953). Carnets de notes et journaux
de voyage. Paris: Payot.
merleau-ponty, Maurice. 2008 [1959]. Prsentation de la candidature de
Claude Lvi-Strauss la chaire dAnthropologie sociale (extrait). Assemble
des professeurs du Collge de France, 15 mars 1959. In: KIRSCH, Marc;
LLEGOU, Patricia. Claude Lvi-Strauss, centime anniversaire. Paris: La
Lettre du Collge de France. Hors srie, novembre.
meyran, Rgis. 1999. crits, pratiques et faits. Lethnologie sous le rgime de
Vichy. LHomme, 150: 203-212.
maio, Marcos Chor. 1997. A histria do projeto UNESCO: estudos raciais e cincias
sociais no Brasil. Tese de Doutorado, IUPERJ, Rio de Janeiro.
79
vibrant v.9 n.1 julie a. cavignac
monbeig, Pierre. 1939. Rcentes recherches ethnographiques en Amrique
Latine. Annales de Gographie, 48(274): 443-445.
muse dethnographie du trocadro. 1931. Instructions sommaires
pour les collecteurs dobjets ethnographiques. Paris: MET.
peixoto, Fernanda A. 1998. Lvi-Strauss no Brasil: a formao do etnlogo.
Mana. Estudos de Antropologia Social, 4(1): 79-107.
petitjean, Patrick. 2001. Miguel, Paul, Henri et les autres. Les rseaux
scientifiques franco-brsiliens dans les annes 1930. In: Antonio Augusto
P. Videira; Silvio R.A. Salinas (orgs.), A cultura da fisica: contribues em
homenagem a Amelia Imperio Hamburger. So Paulo: Editora Livraria da
Fsica. pp. 59-94.
poirier, Jean (org.). 1968. Ethnologie gnrale. Paris: Gallimard.
rivet, Paul. 1924. Les indiens Canoeiros. Journal de la Socit des
Amricanistes, 16: 207-229.
rivet, Paul. 1936. Rglementation des missions scientifiques en territoire
brsilien. Journal de la Socit des Amricanistes, 28(1): 263-264.
riviale, Pascal. 1995. Lamricanisme la veille de la fondation de la Socit des
Amricanistes. Journal de la Socit des Amricanistes, 81: 207-229.
rivire, Georges-Henri et alli. 1964. Hommage Alfred Mtraux. LHomme,
4(2): 5-19.
schwarcz, Lilian. 1993. O espetculo das raas: cientistas, instituies e questo
racial no Brasil 1870-1930. So Paulo: Companhia das Letras.
saez, Oscar Calavia. 2008. Lvi-Strauss, Cincia e Renncia, Campos, 9(2):
9-22.
souza, Marcela Coelho de; FAUSTO, Carlos. 2004. Reconquistando o campo
perdido: o que Lvi-Strauss deve aos amerndios. Revista de Antropologia,
47(1): 87-131.
stocking jr., G. W.. 1982. Afterword: a view from the center. Ethnos, 1-2:
172-186.
taylor, Anne Christine. 1984. Lamricanisme tropical: une frontire fossile de
lethnologie?. In: B. Rupp-Eisenreich (org.), Histoires de lanthropologie:
XVI-XIX sicles. Paris: Klinksieck: 213-233.
trebitsch, Michel. 1995.Les rseaux scientifiques: Henri Laugier en politique
avant la Seconde guerre mondiale (1918-1939) . In: Jean-Louis Crmieux-
Brilhac; Jean-Franois Picard (dirs.), Henri Laugier en son sicle. Cahiers
pour lhistoire de la recherche. Paris: CNRS-ditions. pp. 23-45.
80
julie a. cavignac vibrant v.9 n.1
valentini, Lusa. 2010. Um laboratrio de antropologia: o encontro entre Mrio
de Andrade, Dina Dreyfus e Claude Lvi-Strauss (1935-1938). Dissertao
de Mestrado, Programa de Ps-Graduao em Antropologia social,
Universidade de So Paulo, So Paulo.
velay-vallantin, Catherine. 1997. Usages de la tradition et du folklore
en France et au Qubec (1937-1950): linvestiture du politique. In: Grard
Bouchard; Martine Segalen (orgs.), Une langue, deux cultures. Rites
et symboles en France et au Qubec. Paris: La Dcouverte, Presses de
lUniversit Laval. pp. 273-305.
verneau, Ren. 1919. Le XXe. Congrs international des Amricanistes.
Journal de la Socit des Amricanistes, 11: 671-672.
A propos de lauteur
Julie Antoinette Cavignac est professeur associe du Dpartement dAn-
thropologie et dirige actuellement le Programa de Ps-graduao em
Antropologia Social de de lUniversit Fdrale du Rio Grande do Norte
UFRN (Natal, Brsil).
81
Você também pode gostar
- Parecer - N - 09 2013 CPLC Depconsu PGF AguDocumento11 páginasParecer - N - 09 2013 CPLC Depconsu PGF AguDébora MedeirosAinda não há avaliações
- Renovando A Visão Das Sociedades de ConhecimentoDocumento73 páginasRenovando A Visão Das Sociedades de ConhecimentoÉzio Dornela GoulartAinda não há avaliações
- O Ditador Perpétuo José Gaspar Rodríguez de Francia, O SupremoDocumento22 páginasO Ditador Perpétuo José Gaspar Rodríguez de Francia, O SupremoRodrigo MongeAinda não há avaliações
- A Partir Do Documento 3, Três Das Medidas Económicas e Sociais Implementadas Por Roosevelt para Enfrentar A Crise Nos EUADocumento10 páginasA Partir Do Documento 3, Três Das Medidas Económicas e Sociais Implementadas Por Roosevelt para Enfrentar A Crise Nos EUABernardo MonteiroAinda não há avaliações
- Ilke - Os Quilombos No Brasil - Questões Conceituais e NormativasDocumento11 páginasIlke - Os Quilombos No Brasil - Questões Conceituais e NormativasESCRIBDA00Ainda não há avaliações
- EU-SADocumento5 páginasEU-SADra Daliana CostaAinda não há avaliações
- História Inacabada Do Analfabetismo No BrasilDocumento25 páginasHistória Inacabada Do Analfabetismo No BrasilMarcelo SouzaAinda não há avaliações
- Resumo - Expandido - Unopar 1Documento8 páginasResumo - Expandido - Unopar 1Ka ToledoAinda não há avaliações
- Advogado Prova Objetivae3cns01 Tipo 1Documento28 páginasAdvogado Prova Objetivae3cns01 Tipo 1Assis GomesAinda não há avaliações
- MEMÓRIA DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL DO RIO DE JANEIRO - Ana - Maria - VilellaDocumento10 páginasMEMÓRIA DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL DO RIO DE JANEIRO - Ana - Maria - VilellaPlinio AlvesAinda não há avaliações
- HENRIQUES, Julio. Internacional - Situacionista - AntologiaDocumento167 páginasHENRIQUES, Julio. Internacional - Situacionista - AntologiaVictor BtzaAinda não há avaliações
- BOLPM147ADocumento32 páginasBOLPM147Adr_franklinAinda não há avaliações
- SP Folha de S Paulo 100324 - 240310 - 075830Documento40 páginasSP Folha de S Paulo 100324 - 240310 - 075830sirely.raiellyAinda não há avaliações
- Capitalismo X SocialismoDocumento4 páginasCapitalismo X SocialismoJanice.scribdAinda não há avaliações
- J. R. Guzzo - 'A Falência Da Sete Brasil É Prova Do Delírio Das Decisões de Lula Quanto À Política Industrial'Documento5 páginasJ. R. Guzzo - 'A Falência Da Sete Brasil É Prova Do Delírio Das Decisões de Lula Quanto À Política Industrial'Alfredo PotumatiAinda não há avaliações
- Inclusão Escolar - Artigo de OpiniãoDocumento7 páginasInclusão Escolar - Artigo de OpiniãoSilvioj Francisco100% (1)
- Exercícios para Treinos TMDocumento2 páginasExercícios para Treinos TMNuno BettencourtAinda não há avaliações
- Dom 6310 31 03 2015Documento34 páginasDom 6310 31 03 2015Paulo AzevedoAinda não há avaliações
- Edição Ja-15.09.2018 PDFDocumento32 páginasEdição Ja-15.09.2018 PDFIgor NevesAinda não há avaliações
- Marx e A Comuna de Paris PDFDocumento29 páginasMarx e A Comuna de Paris PDFRoger Filipe SilvaAinda não há avaliações
- Uni LeaoDocumento25 páginasUni LeaoThiago GomezAinda não há avaliações
- Lya Luft - FelicidadeDocumento2 páginasLya Luft - FelicidadeRoger Willian CabralAinda não há avaliações
- Julio Severo - Luiz Mott - Pedofilia Já!Documento63 páginasJulio Severo - Luiz Mott - Pedofilia Já!Augusto César Ribeiro VieiraAinda não há avaliações
- Deliberação CEE 105 de 2011Documento8 páginasDeliberação CEE 105 de 2011Eduardo Aparecido AmbrozetoAinda não há avaliações
- Jogos de Matemática - Os Melhores Desafios MatemáticosDocumento35 páginasJogos de Matemática - Os Melhores Desafios MatemáticosGillSkvAinda não há avaliações
- Lei - 9868 Adi e Adc Pelo STFDocumento82 páginasLei - 9868 Adi e Adc Pelo STFLais CrivellaroAinda não há avaliações
- REsumo de PP, Que Está No DNADocumento10 páginasREsumo de PP, Que Está No DNAGersonzandamelaAinda não há avaliações
- Manifesto ComunistaDocumento11 páginasManifesto Comunistaisabelle nevesAinda não há avaliações
- Mono MargaridaDocumento95 páginasMono MargaridaAgda BaetaAinda não há avaliações
- Relação de BeneficiáriosDocumento4 páginasRelação de BeneficiáriosNatividadeAinda não há avaliações