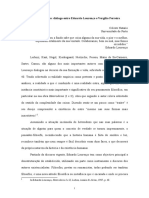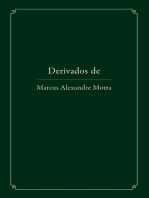Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
L Excrit Nancy
L Excrit Nancy
Enviado por
Heleine Fernandes0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
3 visualizações9 páginasTítulo original
l´excrit.nancy
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
3 visualizações9 páginasL Excrit Nancy
L Excrit Nancy
Enviado por
Heleine FernandesDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 9
312 ALEA | Rio de Janeiro | vol. 15/2 | p.
312-320 | jul-dez 2013 JEAN-LUC NANCY | Lexcrit
LEXCRIT
THE EXCRIPTION
Jean-Luc Nancy
Universidade Marc Bloch
Estrasburgo, Frana
Resumo
Texto originalmente publicado em Po&sie, n 47, 1988 e coligido em Une
pense fnie (1990). Ele se situa no contexto dos trabalhos sobre a comuni-
dade e Georges Bataille. Na primavera de 1983 saa o ensaio La commu-
naut dsuvre na revista Alea (n 4), posteriormente (em 1986) includo
no volume homnimo com dois outros ensaios. Trata-se de escrever ali
como aqui em comunidade com Georges Bataille. Escrever se escre-
vendo nesse caso a partir do lugar de uma exterioridade marcada pelo pre-
fxo ex-, portanto excrever. Escrito, como excrito (excrit), a que se junta
o sentido homfono de ex-grito (cri, em francs). Escrever, para Geor-
ges Bataille, ou ex-crever, implica em um equvoco essencial: escreve-se
sempre o grito (e no sobre o grito), a vida, a coisa em si, o ser, ou
seja, aquilo que por defnio no se escreve, que prescinde e exclui qual-
quer possiblidade de escrever. Ex-crito, quer dizer, escrito fora, em uma
exterioridade que, no entanto, no remete a um referente, por exemplo,
a vida de Georges Bataille, mas a algo que se inscreve (ou ex-creve) sem-
pre e apenas na ex-crita.
Palavras-chave: Georges Ba-
taille; escrita.
Mots-cls: Georges Bataille;
criture.
Keywords: Georges Bataille;
writing.
Rsum
Texte publi originellement dans
Po&sie, n 47, 1988, et inclus dans
le recueil Une pense fnie (1990).
Il se situe dans le contexte des tra-
vaux sur la communaut et Georges
Bataile. Au printemps de 1983,
sortait La communaut dsuvre,
dans la revue Alea (n 4), par la
suite (1986), repris dans le volume
de mme titre avec deux autres
essais. Il sagit ici comme l dcrire
en communaut avec Georges
Bataille. crire, scrit dans ce
cas, partir dune extriorit, mar-
que par le prfixe ex-, donc ex-
crire; crit, comme excrit, o se
Abstract
Text originally published in Po&sie,
n. 47, 1988, and included in Une
pense finie (1990). The text is
located in the context of works
on the community and Georges
Bataille. In the Spring 1983, came
out the essay La communaut
dsuvre (The Inoperative Com-
munity), in the magazine Alea (n.
4), later (in 1986) included in the
homonymous volume, with two
other essays. What is at stake in
both instances is writing in com-
munity with Georges Bataille.
Writing written in this case in an
exterior locus marked by the prefx
313 ALEA | Rio de Janeiro | vol. 15/2 | p. 312-320 | jul-dez 2013 JEAN-LUC NANCY | Lexcrit
joint lhomophonie de ex-cri (cri,
de crier). crire, pour Georges
Bataille, ou ex-crire, renvoie une
quivoque essentielle: on crit tou-
jours le cri (et pas sur le cri), la vie,
la chose mme, ltre, cest dire,
ce que par dfnition ne scrit pas,
ce qui se passe et exclu une quel-
conque possibilit dcrire. Ex-crit,
veux dire, crit dehors, dans une
extriorit qui, pourtant, ne renvoie
pas un rfrent, par exemple, la vie
de Georges Bataille, mais quelque
chose qui sinscrit (ou excrit) tou-
jours et seulement dans lex-criture.
ex-, therefore ex-cription (excrire).
Writing, as excription (excrit), to
which is added the homonophic
meaning of shouting or crying
(cri, to shout, in French). Writing
for Georges Bataille, or excrib-
ing (ex-crire), points towards an
essentially equivocal meaning:
one always writes the cry and not
about the cry, life, the thing
itself , Being, which means, that
which by definition cannot be
written, that which precludes and
excludes any possibility of writing.
Ex-crit (excribed) however does
not refer to a referent such as, for
example, Georges Batailles life, but
to something which inscribes itself
(or ex-cribes) always and only in
the ex-cription.
Dune courte rfexion sur Bataille et son commentaire, je vou-
drais seulement introduire un mot, lexcrit. Pourquoi partir de
Bataille? A cause dune communaut avec lui qui passe au-del, et
qui se passe de la discussion thorique (que je peux imaginer vive,
sinon dure, avec ce quon pourrait appeler la religion tragique de
Bataille). Cette communaut tient ceci, que Bataille me commu-
nique immdiatement la peine et le plaisir qui tiennent limpos-
sibilit de communiquer quoi que ce soit sans toucher la limite
o le sens tout entier se renverse hors de lui-mme, comme une
simple tache dencre travers un mot, travers le mot sens. Ce
renversement du sens qui fait le sens, ou ce reversement du sens
lobscurit de sa source dcriture, je le dis lexcrit.
***
Il devient urgent de cesser de commenter Bataille (mme si
son commentaire explicite, publi, est encore assez mince). Nous
devrions le savoir, Blanchot nous la dit demi-mot, comme il lui
convenait, refusant de commenter ce refus du commentaire.
314 ALEA | Rio de Janeiro | vol. 15/2 | p. 312-320 | jul-dez 2013 JEAN-LUC NANCY | Lexcrit
(En un sens, il faut tout laisser, tout de suite, avec Blanchot,
linterruption du discours [...], une interruption froide, la rupture
du cercle [...], le cur cessant de battre, lternelle pulsion parlante
sarrtant.* Du reste, il ne peut sagir dun refus. Il ny a eu et
il ny aura jamais rien de simplement rprhensible, ni de simple-
ment faux, dans le fait de commenter ce qui, stant dj avanc
dans lcriture, sest dj propos au commentaire, et en vrit a
dj commenc de se commenter soi-mme.
Mais telle est lquivoque de Bataille: il sest engag dans le
discours, et dans lcriture, assez loin pour se soumettre toute la
ncessit du commentaire. Et donc, sa servilit. Il a propos une
pense assez avant pour que son srieux lui retire la souverainet
divine, capricieuse, vanouissante, qui tait pourtant son unique
objet. (Cette limite dchirante, dsolante et joyeuse, allge,
cette dlivrance de la pense qui nabdique pas tout au contraire
mais qui na plus lieu dtre, ou qui na pas encore lieu dtre.
Cette libert davant toute pense, et dont il ne peut jamais tre
question de faire un objet, ni un sujet.)
Mais lorsquil sest drob ce geste, cette proposition et
cette position de penseur, de philosophe, dcrivain (et il se drobe
sans cesse, nachevant pas ses textes, et encore moins sa somme ou
son systme de pense, nachevant mme pas ses phrases, locca-
sion, ou bien sacharnant retirer par une syntaxe dsaxe, djete,
ce que lenchanement dun cours de pense dposait comme une
logique ou comme un propos) lorsquil sest drob, il a aussi
drob laccs ce quil nous communiquait.
quivoque: est-ce le mot? Peut-tre, sil sagit de lquivoque
dune comdie, dun simulacre quil ne faut pas hsiter lui impu-
ter aussi. Bataille toujours a jou limpuissance dachever, lexcs,
tendu rompre lcriture, de ce qui fait lcriture : cest--dire, de
ce que simultanment linscrit et lexcrit. Il la jou, puisquil a crit
sans cesse, crivant partout, sans cesse, lpuisement de son criture.
Ce jeu, cette comdie, il les a dits, il les a crits. Il sest crit cou-
pable de parler du verre dalcool au lieu de le boire et de se soler.
Se solant de mots et de pages pour dire et pour noyer la fois
la culpabilit immense et vaine de ce jeu. Se sauvant aussi par l,
si on veut, et toujours trop certain de trouver le salut dans le jeu
lui-mme. Ainsi, ne se dprenant pas dune comdie trop visible-
ment chrtienne de confession et dabsolution, et de rechute dans
le pch, et nouveau dabandon au pardon. (Le christianisme en
* (BLANCHOT, M. Lentre-
tien infni. Paris: Gallimard,
1970: xxvi.)
315 ALEA | Rio de Janeiro | vol. 15/2 | p. 312-320 | jul-dez 2013 JEAN-LUC NANCY | Lexcrit
tant que comdie : la rparation de lirrparable. Bataille lui-mme
a su combien le sacrifce tait comdie. Mais il ne sagit pas de lui
opposer labme dun pur irrparable. Lesprit de catastrophe qui
nous domine, cest une libert plus haute, plus terrible peut-tre,
mais tout autrement, qui doit nous en dfaire.)
Cette comdie est aussi la ntre: un sacrifce de lcriture, par
lcriture, que lcriture rachte. Nul doute que certains en ont remis
dans la comdie, au regard de ce que furent, malgr tout, la retenue
et la sobrit de Bataille. Nul doute quon en a trop fait sur cet arra-
chement des ongles lamain de lcrivain, sur cette sufocation dans
des souterrains de littrature et de philosophie. A moins quon ait
la hte reconstitu des squences de pense, colmat les brches
avec des ides. (Commentaire dans les deux cas.) Cela nengage
aucune critique des commentaires de Bataille (et si cela devait tre
le cas, jy serais impliqu). Il en est de puissants et dimportants,
et sans lesquels nous ne pourrions mme pas poser la question de
son commentaire.
Mais enfn, Bataille crivit: Je veux veiller la plus grande
mfance contre moi. Je parle uniquement de choses vcues; je ne
me borne pas des dmarches de la tte.*
Comment ne pas tre atteint par cette mfance? Comment
poursuivre simplement la lecture, puis refermer le livre, ou com-
ment annoter ses marges? Si je souligne seulement ce passage, et si
je le cite, ainsi que je viens de le faire, dj je le trahis, je le rduis
un tat dintellection (comme Bataille le dit ailleurs). Cepen-
dant, il stait dj rduit de lui-mme quelque chose o lin-
tellection, assurment, npuise pas tout, mais nen surveille pas
moins la scne. Ailleurs, encore, Bataille crit que lcriture est le
masque dun cri et dun non- savoir. Que fait donc cette criture
qui crit cela mme? Comment ne masquerait-elle pas ce que, un
instant, elle dvoile? Et comment ne masquerait-elle pas, en fn de
compte, ce masque mme quelle dit tre, et quelle dit appliquer
sur un silence criant? Le coup est imparable, la machinerie ou la
machination du discours est implacable. Bien loin de surgir et de
nous assourdir, le cri (ou le silence) a t drob dans sa nomination
ou dans sa dsignation, sous un masque dautant moins reprable
quon a prtendu le montrer, le nommer lui aussi, pour le dnoncer.
Lquivoque est donc invitable, elle est insurmontable. Elle
nest pas autre chose que lquivoque du sens lui-mme. Le sens doit
se signifer, mais ce qui fait le sens, ou le sens du sens, si on veut,
* (VI, 261.)
316 ALEA | Rio de Janeiro | vol. 15/2 | p. 312-320 | jul-dez 2013 JEAN-LUC NANCY | Lexcrit
nest pas autre chose en vrit que cette libert vide, cette transpa-
rence infnie de ce qui, enfn, na plus la charge davoir un sens.*
Bataille na pas cess de rejeter cette charge, il na crit que pour sen
dcharger pour atteindre la libert, pour se laisser atteindre par
elle , mais crivant, parlant, il ne pouvait que se mettre en charge
nouveau de quelque signifcation. Se vouer par une position de
principe ce silence et philosopher, parler, est toujours trouble:
le glissement sans lequel lexercice ne serait pas est alors le mou-
vement mme de la pense.* Lquivoque, cest de passer par la
pense pour dpouiller lexprience de la pense. Cest la philoso-
phie, cest la littrature. Et pourtant, lexprience dpouille nest
pas une stupidit mme sil y a en elle de la stupeur.
Le moindre commentaire de Bataille lengage dans une direc-
tion de sens, vers quelque chose dunivoque. Aussi Bataille lui-
mme, lorsquil voulut crire sur la pense avec laquelle il entrait le
plus en communaut, il crivit Sur Nietzsche, dans un mouvement
essentiellement vou ne pas commenter Nietzsche, ne pas crire
sur lui. Nietzsche crivit avec son sang: qui le critique ou mieux
lprouve ne le peut que saignant son tour. Quon nen doute plus
un instant: on na pas entendu un mot de luvre de Nietzsche avant
davoir vcu cette dissolution clatante dans la totalit.*
Mais il en va de mme pour tout commentaire, de quelque
auteur, de quelque texte que ce soit. Dans un crit, et aussi dans
un crit de commentaire (que tout crit, son tour, est plus ou
moins), ce qui compte, ce qui pense ( la limite, sil le faut, de la
pense) est ce qui ne se prte pas sans reste lunivocit, ni dail-
leurs une plurivocit, mais qui bronche sous la charge du sens, et
la met en dsquilibre. Bataille ne cesse pas dexposer cela. A ct
de tous les thmes quil traite, travers toutes les questions quil
dbat, Bataille nest que protestation contre la signifcation de son
discours. Si on veut le lire, si la lecture se met demble en rbellion
contre ce commentaire quelle est, et contre la comprhension quelle
doit tre, il faut lire chaque ligne le travail ou le jeu de lcriture
contre le sens.
Cela na rien voir avec le non-sens, ni avec labsurde, ni avec
un sotrisme mystique, philosophique ou potique. Cest mme
la phrase paradoxalement , mme les mots et la syntaxe, une
faon, souvent gauche ou djete, drobe en tout cas autant quil
est possible lopration dun style (au sens acoustico-dcoratif
du terme, comme dit Borges), de peser sur le sens mme, donn
* (VI, 76.)
* (XI, 286.)
* (VI, 15, 22.)
317 ALEA | Rio de Janeiro | vol. 15/2 | p. 312-320 | jul-dez 2013 JEAN-LUC NANCY | Lexcrit
et reconnaissable, une faon de gner ou doppresser la communi-
cation de ce sens, non pas dabord nous, mais ce sens lui-mme,
sa possibilit de signifer et de se signifer. Et la lecture doit res-
ter son tour pesante, gne, et sans cesser de dchifrer, pourtant
toujours en de du dchifrement. Cette lecture reste prise dans
ltrange matrialit de la langue, elle saccorde cette communi-
cation singulire qui ne se fait pas seulement par le sens, mais par
la langue mme, ou plutt, qui nest que communication de la
langue elle-mme, sans dgagement de sens, dans un suspens du
sens, fragile et rpt. La vraie lecture avance sans savoir, elle ouvre
toujours un livre comme une coupe injustifable dans le continuum
suppos du sens. Il faut quelle sgare sur cette brche.
Cette lecture qui est tout dabord la lecture elle-mme,
toute lecture, invitablement livre au mouvement soudain, fulgu-
rant ou glissant, dune criture qui la prcde et quelle ne rejoin-
dra quen la r-inscrivant ailleurs et autrement, en lex-crivant hors
delle-mme cette lecture ne commente pas encore (il sagit du
dbut de lecture, dun incipit toujours recommenc), elle nest ni en
mesure ni en posture dinterprter, de faire signifer. Elle est plutt
un abandon cet abandon la langue o lcrivain sest expos. Il
ny a pas pure et simple communication, ce qui est communiqu a
un sens et une couleur...* et sens, ici, veut dire mouvement, avan-
ce). Elle ne sait pas o elle va, et na pas le savoir. Aucune autre
lecture nest possible sans elle, et toute lecture (au sens de com-
mentaire, exgse, interprtation) doit y revenir.
Mais ainsi, Bataille et son lecteur se sont dj dplacs par
rapport lquivoque. Il ny a pas dun ct lquivoque du sens
de tous les sens possibles, lquivoque des univocit multiplies
par tous les actes dintellection , et de lautre lquivoque du
sens qui se dleste de tout sens possible. Il sagit en dfnitive de
tout autre chose, et que Bataille savait: cest peut-tre mme cela
quavant toute autre chose il savait, ne sachant rien. Il ne sagit
pas de cette machinerie ncessaire et drisoire du sens qui se pro-
pose en se drobant, ou qui se masque en se signifant. En rester
l condamne lcriture sans appel ( coup sr, cette condamnation
hantait Bataille), et condamne aussi bien au ridicule ou linsup-
portable la volont dafrmer une criture drobe lintellection
et identique la vie (jai toujours mis dans mes crits toute ma vie
et toute ma personne, jignore ce que peuvent tre des problmes
* (II, 315.)
318 ALEA | Rio de Janeiro | vol. 15/2 | p. 312-320 | jul-dez 2013 JEAN-LUC NANCY | Lexcrit
purement intellectuels).* Car cest toujours, encore, un discours
plein de sens, et qui drobe la vie dont il parle.
Ce quil y a dautre, et sans le savoir de quoi Bataille nau-
rait pas crit, pas plus que ncrirait quiconque, cest ceci: en vrit,
lquivoque nexiste pas, ou elle nexiste quaussi longtemps que
la pense considre le sens. Mais il ny a plus dquivoque ds quil
est clair (et cela est clair, forcment, avant toute considration du
sens) que lcriture excrit le sens tout autant quelle inscrit des signi-
fcations. Elle excrit le sens, cest- dire quelle montre que ce dont
il sagit, la chose mme, la vie de Bataille ou le cri, et pour fnir
lexistence de toute chose dont il est question dans le texte (y
compris, cest le plus singulier, lexistence de lcriture elle-mme)
est hors du texte, a lieu hors de lcriture.
Toutefois, ce dehors nest pas celui dun rfrent auquel
renverrait la signifcation (ainsi, la vie relle de Bataille, signife
par les mots ma vie). Le rfrent ne se prsente comme tel que
par la signifcation. Mais ce dehors tout entier excrit dans le
texte est linfni retrait de sens par lequel chaque existence existe.
Non pas la donne brute, matrielle, concrte, rpute hors sens
et que le sens reprsente, mais la libert vide par laquelle lexis-
tant vient la prsence et labsence. Cette libert nest pas vide
en ce quelle serait vaine. Sans doute, elle nest pas ordonne un
projet, un sens ni une uvre. Mais elle passe par luvre du
sens pour exposer, pour ofrir nu linemployable, linexploitable,
inintelligible et infondable tre de ltre-au-monde. Quil y a
ltre, ou de ltre, ou encore des tres, et singulirement quil y a
nous, notre communaut (dcriture-lecture): voil qui provoque
tous les sens possibles, voil qui est le lieu mme du sens, mais
qui na pas de sens.
crire, et lire, cest tre expos, sexposer ce non-avoir ( ce
non-savoir), et ainsi 1excription. Lexcrit est excrit ds le pre-
mier mot, non pas comme un indicible , ou comme un ininscrip-
tible, mais au contraire comme cette ouverture en soi de lcriture
elle-mme, sa propre inscription en tant que linfnie dcharge du
sens dans tous les sens quon peut donner lexpression. crivant,
lisant, jexcris la chose mme 1existence, le rel qui nest
quexcrite, et dont cet tre fait seul lenjeu de linscription. En ins-
crivant des signifcations, on excrit la prsence de ce qui se retire
de toute signifcation, ltre mme (vie, passion, matire...). Ltre
de lexistence nest pas imprsentable: il se prsente excrit. Le cri
* (VI, 261.)
319 ALEA | Rio de Janeiro | vol. 15/2 | p. 312-320 | jul-dez 2013 JEAN-LUC NANCY | Lexcrit
de Bataille nest pas masqu ni touf: il se fait entendre comme le
cri quon nentend pas. Dans lcriture, le rel ne se reprsente pas,
il prsente la violence et la retenue inoues, la surprise et la libert
de ltre dans lexcription o lcriture chaque instant se dcharge
delle-mme.
Mais excrit nest pas un mot de la langue, et on ne peut
pas non plus, comme je le fais ici, le fabriquer sans tre corch
par son barbarisme. Le mot excrit nexcrit rien et ncrit rien, il
fait un geste gauche pour indiquer ce qui doit seulement scrire,
mme la pense toujours incertaine de la langue. Reste la nudit
du mot crire, crit Blanchot* qui compare cette nudit celle
de Mme. Edwarda.
Reste la nudit de Bataille, reste son criture nue, exposant
la nudit de toute criture. quivoque et claire comme une peau,
comme un plaisir, comme une peur. Mais la comparaison ne suft
pas. La nudit de lcriture est la nudit de lexistence. Lcriture est
nue parce quelle excrit, lexistence est nue parce quelle est excrite.
De lune lautre passe la tension violente et lgre de ce sus-
pens du sens qui fait tout le sens: cette jouissance si absolue quelle
naccde sa propre joie quen sy perdant, en sy renversant, et
quelle se prsente comme le cur absent (labsence qui bat comme
un cur) de la prsence. Cest le cur des choses qui est excrit.
En un sens, Bataille doit nous tre prsent de cette prsence,
qui carte la signifcation, et qui serait, elle-mme, la communi-
cation. Non pas une uvre rassemble, rendue communicable,
interprtable (toujours, les uvres compltes, si prcieuses et si
ncessaires, provoquent une gne: elles communiquent com-
plet ce qui ne fut crit que par morceaux et par chances), mais le
pitinement fni dune excription de la fnitude. Sy dcharge une
jouissance infnie, une douleur, une volupt si relles que les tou-
cher (les lire excrites) nous convainc aussitt du sens absolu de leur
non-signifcation.
En un sens encore, cest Bataille lui-mme mort. Cest--dire,
lexaspration de chaque moment de lecture dans la certitude que
lhomme exista, qui crivit ce quon lit, et lvidence confondante
que le sens de son uvre et le sens de sa vie sont la mme nudit,
le mme dnuement de sens qui les carte aussi bien lun de lautre
de tout lcart dune (x)criture.
Bataille mort et ses livres oferts tels que son criture les laisse:
cest la mme chose, cest le mme interdit de commenter et de
* (BLANCHOT, M. Aprs-
coup. Paris: Minuit, 1983:
91.)
320 ALEA | Rio de Janeiro | vol. 15/2 | p. 312-320 | jul-dez 2013 JEAN-LUC NANCY | Lexcrit
comprendre (cest le mme interdit de tuer). Cest le coup darrt
implacable et joyeux quil faut donner toute hermneutique, pour
que lcriture (et) lexistence, nouveau, puissent sexposer: dans
la singularit, dans la ralit, dans la libert de la commune des-
tine des hommes.*
Parlant de la mort de Bataille, Blanchot crit: La lecture des
livres doit nous ouvrir la ncessit de cette disparition dans laquelle
ils se retirent. Les livres eux-mmes renvoient une existence.*
Jean-Luc Nancy flsofo e professor emrito da Universidade Marc
Bloch de Estrasburgo. autor de obras importantes como Labsolu litt-
raire: Torie de la littrature du romantisme allemand (1978), em coau-
toria com Philippe Lacoue-Labarthe, Le partage des voix (1982), La Com-
munaut dsuvre (1983), Corpus (1992), Le sens du monde (1993), tre
singulier pluriel (1996), La cration du monde ou la mondialisation (2002),
La dclosion (2005), Tombe de sommeil (2007), entre outros. Mais recen-
temente, publicou Maurice Blanchot, passion politique (2011), Dans quels
mondes vivons-nous (com Aurlien Barrau, 2011) e Lquivalence des catas-
trophes ( 2012). E-mail: <jean-luc.nancy@orange.fr>.
* (BLANCHOT, M. Lamiti.
Paris: Gallimard, 1973: 327.)
Recebido em
05/06/2013
Aprovado em
12/06/2013
* (XI, 311.)
Você também pode gostar
- Planner LiterárioDocumento43 páginasPlanner Literáriodannypsicologa2013Ainda não há avaliações
- Gilles Deleuze & Félix Guattari Biografia CruzadaDocumento434 páginasGilles Deleuze & Félix Guattari Biografia CruzadaChristian MazzucaAinda não há avaliações
- Representation Du Paysage Dans Le CinemaDocumento48 páginasRepresentation Du Paysage Dans Le CinemaAlessandra FrancescaAinda não há avaliações
- Jean Luc NancyDocumento19 páginasJean Luc NancyRosmery Gallardo100% (1)
- (TRADUÇÃO) Otobiographies - DerridaDocumento3 páginas(TRADUÇÃO) Otobiographies - DerridaMarcelo AlvesAinda não há avaliações
- Atividade Sobre Crônica 19 de MarçoDocumento4 páginasAtividade Sobre Crônica 19 de MarçoTayane DiasAinda não há avaliações
- Bataille Com LacanDocumento13 páginasBataille Com LacanLuciusDemiurgeAinda não há avaliações
- Conversa Sobre BlanchotDocumento5 páginasConversa Sobre BlanchotGisett LaraAinda não há avaliações
- Visões Do Excesso - o Informe Como Afirmação Do Desconhecido No Filme o Enigma de Outro Mundo, de John Carpenter PDFDocumento23 páginasVisões Do Excesso - o Informe Como Afirmação Do Desconhecido No Filme o Enigma de Outro Mundo, de John Carpenter PDFAlexCosta1972Ainda não há avaliações
- Gilles Deleuze - HumeDocumento7 páginasGilles Deleuze - HumeDiógenes Tupiniquim100% (1)
- Elanei RobertMoraes - O Jardim Secreto - Notas Sobre Bataille e Foucault PDFDocumento9 páginasElanei RobertMoraes - O Jardim Secreto - Notas Sobre Bataille e Foucault PDFMateus ThomazAinda não há avaliações
- 17 Bienal de São Paulo - Flávio de Carvalho 1983Documento130 páginas17 Bienal de São Paulo - Flávio de Carvalho 1983GorgiasinAinda não há avaliações
- Stimmung, Verstimmung Et Leiblichkeit Dans La Schizophrénie PDFDocumento8 páginasStimmung, Verstimmung Et Leiblichkeit Dans La Schizophrénie PDFpolix1Ainda não há avaliações
- CONTADOR BORGES Georges Bataille Imagens Do ÊxtaseDocumento16 páginasCONTADOR BORGES Georges Bataille Imagens Do Êxtasejosé macedoAinda não há avaliações
- O Caso EutidemoDocumento7 páginasO Caso EutidemoNelson CarvalhoAinda não há avaliações
- Sobre QuignardDocumento10 páginasSobre QuignardJuliana BratfischAinda não há avaliações
- Criação Cientifica e Artística - Vilém FlusserDocumento3 páginasCriação Cientifica e Artística - Vilém FlusserdundunAinda não há avaliações
- Clarice Ortega HeideggerDocumento293 páginasClarice Ortega Heideggereloaguiar43100% (1)
- Paideuma É o Conceito Básico Do Pensamento de Leo FrobeniusDocumento1 páginaPaideuma É o Conceito Básico Do Pensamento de Leo FrobeniusEmilsonwernerAinda não há avaliações
- 2 - Heidegger e DostoiévskiDocumento20 páginas2 - Heidegger e DostoiévskiFrancisco WiederwildAinda não há avaliações
- DERRIDA, Jacques. PaixõesDocumento60 páginasDERRIDA, Jacques. PaixõesMatheus MullerAinda não há avaliações
- Lispector Por Cixous PDFDocumento203 páginasLispector Por Cixous PDFdragutamomolescuAinda não há avaliações
- Da Invenção em Filosofia Etienne SouriauDocumento16 páginasDa Invenção em Filosofia Etienne Souriaupjonas.almeida2990Ainda não há avaliações
- Conceitos de Campo e Fora de Campo Na Imagem Fotográfica e No CinemaDocumento1 páginaConceitos de Campo e Fora de Campo Na Imagem Fotográfica e No CinemaDébora VieiraAinda não há avaliações
- Ponge A MimosaDocumento13 páginasPonge A MimosaAdalberto MüllerAinda não há avaliações
- Dissertação. Karoline Ferreira Martins. Versão Final Enviada para Unb PDFDocumento159 páginasDissertação. Karoline Ferreira Martins. Versão Final Enviada para Unb PDFRaquel CerqueiraAinda não há avaliações
- Um Desejo Pego Pelo RaboDocumento9 páginasUm Desejo Pego Pelo RaboDesireeAinda não há avaliações
- Beckett o InominávelDocumento2 páginasBeckett o Inominávelzenon_araujo5651Ainda não há avaliações
- Presença e Campo Transcendental - Bento - Cap. IDocumento23 páginasPresença e Campo Transcendental - Bento - Cap. IJosiRouseAinda não há avaliações
- Georges Bataille - O Anus SolarDocumento3 páginasGeorges Bataille - O Anus Solarnmedeiros07Ainda não há avaliações
- Animais Quase Sábios, Animais Quase Loucos by Mario Perniola PDFDocumento29 páginasAnimais Quase Sábios, Animais Quase Loucos by Mario Perniola PDFEduardo Yuji YamamotoAinda não há avaliações
- A Concepção Bergsoniana de Tempo - Frederic WormsDocumento21 páginasA Concepção Bergsoniana de Tempo - Frederic WormsFabianeAinda não há avaliações
- Subjetividade Transcendental e Transcendentalidade Do Dasein - Jesus V. TorresDocumento10 páginasSubjetividade Transcendental e Transcendentalidade Do Dasein - Jesus V. TorresThaynaAinda não há avaliações
- Jean-Luc Nancy & Jacques RancièreDocumento22 páginasJean-Luc Nancy & Jacques Rancièremallaguerra100% (1)
- Mesmidade, Ipseidade e VontadeDocumento10 páginasMesmidade, Ipseidade e VontadeSérgio InácioAinda não há avaliações
- Sartre - Apresentacao - de - Les Temps Modernes PDFDocumento14 páginasSartre - Apresentacao - de - Les Temps Modernes PDFThiago RodriguesAinda não há avaliações
- Carson, Anne O Gênero Do SomDocumento19 páginasCarson, Anne O Gênero Do SomanaAinda não há avaliações
- Existencialismo Eduardo Lourenço Vergílio FerreiraDocumento12 páginasExistencialismo Eduardo Lourenço Vergílio FerreiraPedro Fonseca E SilvaAinda não há avaliações
- Luiz Orlandi - Afirmação Num Lance FinalDocumento6 páginasLuiz Orlandi - Afirmação Num Lance FinalCadu MelloAinda não há avaliações
- O Partido Das Coisas - Francis Ponge - 2015 - Iluminuras - 9788573211160 - Anna's ArchiveDocumento195 páginasO Partido Das Coisas - Francis Ponge - 2015 - Iluminuras - 9788573211160 - Anna's ArchiveJeanne Callegari100% (1)
- Eduardo Pellejero - Golgona Anghel, Fora Da Filosofia - As Formas Dum Conceito em Sartre, Blanchot, Foucault e Deleuze PDFDocumento113 páginasEduardo Pellejero - Golgona Anghel, Fora Da Filosofia - As Formas Dum Conceito em Sartre, Blanchot, Foucault e Deleuze PDFEduardo PellejeroAinda não há avaliações
- O Romantismo RevolucionárioDocumento209 páginasO Romantismo Revolucionáriomarlon sáAinda não há avaliações
- Passagens Celan - José EduardoDocumento129 páginasPassagens Celan - José Eduardoandrade.marianaAinda não há avaliações
- A Canção de Hyperion - Friedrich HölderlinDocumento2 páginasA Canção de Hyperion - Friedrich HölderlinJoseph ShafanAinda não há avaliações
- Franklin Querela Do TeatroDocumento16 páginasFranklin Querela Do TeatrorenatoAinda não há avaliações
- A Arte Árabe e A Teologia IslâmicaDocumento6 páginasA Arte Árabe e A Teologia IslâmicaSamuel M. GalvãoAinda não há avaliações
- Dissertação Brenno FerreiraDocumento113 páginasDissertação Brenno FerreiraBrenno Jadvas Soares FerreiraAinda não há avaliações
- David LapoujadeDocumento4 páginasDavid LapoujadeRicardo MacêdoAinda não há avaliações
- Marcelo Antonelli, Deleuze, Três Perspectivas Sobre o NiilismoDocumento18 páginasMarcelo Antonelli, Deleuze, Três Perspectivas Sobre o NiilismoFilosofia PaulistaAinda não há avaliações
- Renato KirchnerDocumento259 páginasRenato KirchnerMarina Coelho Santos100% (1)
- DAMISCH. O Desaparecimento Da ImagemDocumento16 páginasDAMISCH. O Desaparecimento Da ImagemRenato MenezesAinda não há avaliações
- Nietzche e A Represenatação Do Dionisíaco - Roberto MachadoDocumento28 páginasNietzche e A Represenatação Do Dionisíaco - Roberto MachadoRicardo Pinto de SouzaAinda não há avaliações
- Deleuze e A Imanência Da ConsciênciaDocumento14 páginasDeleuze e A Imanência Da ConsciênciaRicardo ValenteAinda não há avaliações
- Pierre Aubenque PDFDocumento12 páginasPierre Aubenque PDFRenato BarbosaAinda não há avaliações
- ADORNO, Theodor W. Anotações Sobre Kafka in Prismas - Crítica Cultural e Sociedade - (Ocr)Documento18 páginasADORNO, Theodor W. Anotações Sobre Kafka in Prismas - Crítica Cultural e Sociedade - (Ocr)cowboywsAinda não há avaliações
- Jacques Derrida amava as mulheres: sobre o esquecimento de Simone de BeauvoirNo EverandJacques Derrida amava as mulheres: sobre o esquecimento de Simone de BeauvoirAinda não há avaliações
- Escrever a Mágoa: Cruzamento entre Nietzsche e DerridaNo EverandEscrever a Mágoa: Cruzamento entre Nietzsche e DerridaAinda não há avaliações
- Condutas de risco: dos jogos de morte ao jogo de viverNo EverandCondutas de risco: dos jogos de morte ao jogo de viverAinda não há avaliações
- Rasaboxes em Jogo!Documento19 páginasRasaboxes em Jogo!Débora ZamarioliAinda não há avaliações
- A Presenca Feminina No Imaginario Dos Artistas Bra PDFDocumento4 páginasA Presenca Feminina No Imaginario Dos Artistas Bra PDFFanny SiqueiraAinda não há avaliações
- Pingouin Jogo Da Velha AbelhinhasDocumento11 páginasPingouin Jogo Da Velha AbelhinhasVerónica Lara100% (5)
- Apostila Teoria MusicalDocumento33 páginasApostila Teoria MusicalLucas SilvaAinda não há avaliações
- Relação Alunos 2022 OkDocumento31 páginasRelação Alunos 2022 Okflavio2015Ainda não há avaliações
- Aristoteles e DanteDocumento17 páginasAristoteles e Danted9wcwx8gdcAinda não há avaliações
- Pennac Daniel Como Una Novela-Convertido - Es.ptDocumento163 páginasPennac Daniel Como Una Novela-Convertido - Es.ptAna Flávia Martins100% (1)
- Leandro JunqueiraDocumento16 páginasLeandro JunqueiraNúbya Campelo MoreiraAinda não há avaliações
- Contexto Histórico Das Vanguardas EuropeiasDocumento9 páginasContexto Histórico Das Vanguardas EuropeiasFran RochaAinda não há avaliações
- Atividades 3ºANODocumento61 páginasAtividades 3ºANORosangela Soares100% (1)
- Entendas As Seis Dimensoes de Conhecimento para o Ensino de ArtespdfDocumento3 páginasEntendas As Seis Dimensoes de Conhecimento para o Ensino de ArtespdfLuci SerafimAinda não há avaliações
- CV - Coletivo KokirDocumento2 páginasCV - Coletivo KokirSheilla SouzaAinda não há avaliações
- Revista Phillolugus - Ano 9 N26 Maio 2003Documento179 páginasRevista Phillolugus - Ano 9 N26 Maio 2003Claudia LeiteAinda não há avaliações
- Regulamento 46 Salao Scpsa-2Documento3 páginasRegulamento 46 Salao Scpsa-2Fefa LinsAinda não há avaliações
- Gustav Mahler - Das Lied Von Der ErdeDocumento9 páginasGustav Mahler - Das Lied Von Der ErdeCoral Prata Encanto & VozAinda não há avaliações
- As Vidas Sucessivas - Albert de RochasDocumento448 páginasAs Vidas Sucessivas - Albert de Rochastupan84Ainda não há avaliações
- Lista de Recomendação de Rodas de SambaDocumento3 páginasLista de Recomendação de Rodas de SambaThais ZimbweAinda não há avaliações
- Ricardo ReisDocumento9 páginasRicardo ReisMafaldaJoanaOliveiraAinda não há avaliações
- O Que É Arte PDFDocumento5 páginasO Que É Arte PDFSamuel Aparecido SantosAinda não há avaliações
- A Morte Como ConselheiraDocumento4 páginasA Morte Como ConselheiraThatiane AlbuquerqueAinda não há avaliações
- Bernoulli 6 Dia 1Documento36 páginasBernoulli 6 Dia 1Danilo SalesAinda não há avaliações
- Professor de CientistasDocumento62 páginasProfessor de CientistasMariana Ritter RauAinda não há avaliações
- Estudo de Os MaiasDocumento37 páginasEstudo de Os MaiasMARIAJBEZERRAAinda não há avaliações
- Ementa UDESC 2023 Processo SeletivoDocumento20 páginasEmenta UDESC 2023 Processo SeletivoHelder OliveiraAinda não há avaliações
- O Sítio Dos Lagares (Lisboa) - Um Espaço PluriculturalDocumento16 páginasO Sítio Dos Lagares (Lisboa) - Um Espaço PluriculturalRosário BeatoAinda não há avaliações
- Benjamin de Oliveira e A Consolidação Do Circo-TeatroDocumento418 páginasBenjamin de Oliveira e A Consolidação Do Circo-TeatroUsuario InativoAinda não há avaliações
- Artes de ExuDocumento112 páginasArtes de Exuaragaomfabio1974Ainda não há avaliações
- RLM CeiscDocumento10 páginasRLM CeiscJosé Franco Nunes100% (1)